-
 Pourquoi Jean Moulin, alias Rex, alias Max, a-t-il été dénoncé ? Cette question autour des fissures idéologiques au sein de la résistance traverse le roman de Dan Franck. Jean Moulin a-t-il été victime de ces champs de bataille politique ? A-t-il été livré aux autorités nazies pour faire prévaloir dès 1943 un projet de reconstruction de la France différent de celui qu’il portait ?
Pourquoi Jean Moulin, alias Rex, alias Max, a-t-il été dénoncé ? Cette question autour des fissures idéologiques au sein de la résistance traverse le roman de Dan Franck. Jean Moulin a-t-il été victime de ces champs de bataille politique ? A-t-il été livré aux autorités nazies pour faire prévaloir dès 1943 un projet de reconstruction de la France différent de celui qu’il portait ?René Hardy, alias Didot, a été accusé après guerre de cette dénonciation. Deux fois jugé, deux fois acquitté. Mais un juge en retraite ne peut se satisfaire de cette ombre sur l’assassinat de Jean Moulin. Il convoque dans un face-à-face imaginaire René Hardy, pour reprendre l’enquête et démêler les témoignages, les approximations et les silences. Et on suit pas à pas Max, René Hardy et les chefs de la résistance dans tous les évènements qui précèdent le drame de Caluire. Le ton est engagé. Le rythme est haletant, au fil d’une enquête serrée, à la recherche de ce point de basculement. Pour le juge, ce jour de Caluire est celui d’une pierre noire dans l’histoire de la Libération en construction.
Dan Franck nous embarque dans la quête obsessionnelle de ce juge qui crie en écho à notre société désenchantée que les idéaux et les espoirs ont toujours leur sens pour ne pas sombrer dans le cynisme, l’abandon de la démocratie et de la justice sociale.
« À vingt ans, songe encore le juge, René Hardy lisait Le Populaire. Il était membre de la Ligue des droits de l’homme. Il fit même un passage éclair au Parti communiste. Comme Doriot, Déat et leurs amis. A l’époque, on franchissait aisément la ligne jaune avant de reprendre la route en sens contraire. Aujourd’hui, de même. Passé commun, présents composés.
Au fil des années, le juge a vu beaucoup de ses amis s’écarter des lignes qui étaient les leurs dans leur jeunesse. Il a fini par s’éloigner d’eux, doucement, sans violence, comme un bateau dérivant seul. Ils se retrouvaient jadis dans les manifestations contre : contre les barricades d’Alger, contre l’assassinat de Martin Luther King, contre la guerre au Vietnam, contre l’assassinat de Salvador Allende… L’âge les a peu à peu poussés sur les bas-côtés des rassemblements. Faute d’être allés où que ce soit, ils sont revenus de tout. Naguère prompts à lever le poing, ils se sont assis sur les combats de leur jeunesse. Après les avoir dépréciés, ils les ont niés. Le pays, la Nation, les hymnes patriotiques sont devenus dans leur bouche des concepts défendables. Hier, ils condamnaient l’invasion de la baie des Cochons. Plus tard, ils ont applaudi à l’occupation de l’Irak, admis le néolibéralisme comme le stade indépassable et moderne de l’impérialisme naguère tant combattu. Ils ne descendent plus dans la rue, pas plus le 1er mai que pour la défense des sans-droits. Contre l’extrême-droite, éventuellement car ils retrouvent là l’odeur de leurs anciens combats, omettant de s’avouer que celui-ci ne comporte aucun risque tant s’est généralisée la désignation de boucs émissaires hideux. Ils ont oublié les deux Pierre, Goldman et Overney. Ils applaudissent 1936 et la semaine de quarante heures mais estiment que les trente-cinq heures, soixante ans après, sont une aberration économique. C’est ainsi qu’ils jugent, selon ce critère unique : l’économie. Les conquêtes sociales ne les intéressent plus. Ils sont réalistes : ils demandent le possible. Ils ne rêvent pas, espèrent peu, l’utopie leur apparaît comme un enfantillage. Certains votent à droite tout en revendiquant une appartenance à la gauche. C’est celle-ci qui a trahi, disent-ils, non eux-mêmes. Dans le meilleur des cas, ils sont devenus les premiers gardiens du temple qu’ils fracassaient dans leur jeunesse. Au pire, ils mêlent leurs voix, devenues souveraines, à celles qu’applaudiraient René Hardy et ses camarades s’ils vivaient encore. Gauche et droite assemblées. Rouges et bruns. Riposte laïque et Bloc identitaire ».
Sa lecture donne envie d’aller chercher plus loin sur ce point de basculement, sur ces tensions intérieures parmi des combattants aux idées si disparates… il donne envie d’aller ouvrir le témoignage de Daniel Cordier, Alias Caracalla, que l’on dévore… (voir le livre de Daniel Cordier).
BBLR
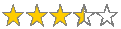
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Le roman s’ouvre sur la mort du père. Et c’est dans un autre cimetière que Jean-Yves Cendrey enterre ce père qui l’a humilié, frappé, terrorisé pendant toute son enfance. Jusqu’au jour de la révolte.
Le roman s’ouvre sur la mort du père. Et c’est dans un autre cimetière que Jean-Yves Cendrey enterre ce père qui l’a humilié, frappé, terrorisé pendant toute son enfance. Jusqu’au jour de la révolte.A partir de cette lettre contre l’autorité tyrannique, l’auteur nous conduit progressivement jusque dans le village de X, en Normandie, parmi ses habitants, ses voisins, effleurés dans leur médiocrité, leur soumission et leur silence face à l’inacceptable.
L’« affaire » de X, des dizaines d’enfants violés et humiliés pendant des années par un enseignant qui profite de la complaisance des hommes et des femmes du lieu, d’institutions hermétiques et sourdes aux appels de gamins dont ils ont la charge. C’est ce silence assourdissant qui crisse sous les pages de cette histoire.
Dans une écriture portée par la colère, l’affaire et le procès de X font ressortir l’oubli d’enfants broyés par une éducation nationale au rouleau compresseur. Bien que l’auteur emprunte le nom de Raoul Rose pour nous faire entrer dans le village de X, il ne peut s’extraire de sa place, centrale, dans ce drame. Celle du crieur public sur une place désertée.
Une plume aiguisée à lire et à suivre… pour en découvrir un peu plus.
BBLR

 votre commentaire
votre commentaire
-
 Nous sommes dans les années 1990, peu de temps après l’effondrement de l’empire soviétique. Dans ces années fric, la finance et les « affaires » internationales aspirent les hommes. Et dans un grand restaurant parisien, un serveur africain est violemment frappé par un riche client américain. Personne ne réagit. Ni le couple russe qui se disloque comme le bloc de l’est, ni la femme de cet américain violent, ni les deux jeunes traders aux aspirations opposées. Au centre de ce fait divers oublié des médias, le jeune serveur, Sila, qui a fui son pays en ruines, incarne le craquellement des idéaux et des faux-semblants de ces destins croisés, jusqu’à leur basculement après la crise financière de 2008.
Nous sommes dans les années 1990, peu de temps après l’effondrement de l’empire soviétique. Dans ces années fric, la finance et les « affaires » internationales aspirent les hommes. Et dans un grand restaurant parisien, un serveur africain est violemment frappé par un riche client américain. Personne ne réagit. Ni le couple russe qui se disloque comme le bloc de l’est, ni la femme de cet américain violent, ni les deux jeunes traders aux aspirations opposées. Au centre de ce fait divers oublié des médias, le jeune serveur, Sila, qui a fui son pays en ruines, incarne le craquellement des idéaux et des faux-semblants de ces destins croisés, jusqu’à leur basculement après la crise financière de 2008.Mené sur un rythme haletant, le récit de Sila et de ces vies mêlées traduit le désenchantement contemporain. Le monde du règne individualiste où ceux « sans désir propre » adoptent le désir socialement ordonné. Celui de l’ironie comme première étape d’abandon de ses espoirs, à l’image de Lev, professeur opposant à la dictature communiste qui se laisse dériver vers la corruption des nouveaux oligarques russes :
« Dans la vie, le problème, c’est de se réinventer. De devenir un autre être. D’autant que lorsqu’on cherche à se réinventer, le vrai travail se produit, celui de la perpétuation, la puissante force qui pousse à être toujours soi-même, de sorte que les métamorphoses se nouent et se dénouent pour arriver au terrible constat : nous sommes toujours nous-mêmes mais plus profondément. Et il est bien possible que le fantôme de Lev n’ait été qu’une illusion, l’oligarque perçant déjà sous le professeur. La causticité, l’ironie comme première mouture du désenchantement, avant le cynisme, l’amertume et la cruauté. La longue chaîne de la dégradation ».
Fabrice Humbert traduit bien ce monde du paraître, des « perdants » et des « gagnants », de « gens rapides ne discutant que de stupidités ». Un monde où les mots n’ont plus le même sens pour les uns et pour les autres, ceux recouvrant des réalités auxquelles on croit, même à tort, et ceux qui sont des armes, destinés à convaincre et obtenir. Un monde où les mots ne correspondent plus aux choses, qu’il s’agisse de la dictature communiste ou de l’oligarchie libérale. En effet, lorsque les termes de « démocraties populaires » servent à nommer des dictatures, lorsque l’invocation permanente au « nous » et au « peuple » recouvre les intérêts de quelques-uns dans le monde communiste finissant, ne sommes-nous pas en droit de nous poser les mêmes questions à propos du vocabulaire employé dans nos « démocraties libérales », dirigées par un capitalisme débridé ?
Ce roman captivant qui souhaiterait embrasser notre société mondialisée demeure à sa superficie. Il laisse un sentiment d’inachevé et de fatalisme. Les résistances qui se dressent sont ignorées dans ce récit où les hommes et les femmes se soumettent finalement et capitulent face à des forces qui semblent les dépasser.
BBLR

 votre commentaire
votre commentaire
-
 En 2009, pendant six mois, Florence Aubenas part pour Caen se fondre dans la masse des demandeurs d’emploi. Avec pour tout bagage officiel un bac, elle cumule les emplois précaires et les petits boulots épuisants dans le domaine que Pôle Emploi considère le plus approprié : agent de propreté (c’est-à-dire femme de ménage). Elle y côtoie d’autres femmes qui essaient de s’en sortir tant bien que mal en ces temps de crise où l’employeur est roi et où il faut donc savoir baisser la tête et trimer. Certaines de ces femmes ont des cœurs en or, mais la plupart ont surtout la démarche épuisée de celles qui se lèvent tôt pour ne gagner pas grand-chose et qui multiplient les heures pour joindre les deux bouts.
En 2009, pendant six mois, Florence Aubenas part pour Caen se fondre dans la masse des demandeurs d’emploi. Avec pour tout bagage officiel un bac, elle cumule les emplois précaires et les petits boulots épuisants dans le domaine que Pôle Emploi considère le plus approprié : agent de propreté (c’est-à-dire femme de ménage). Elle y côtoie d’autres femmes qui essaient de s’en sortir tant bien que mal en ces temps de crise où l’employeur est roi et où il faut donc savoir baisser la tête et trimer. Certaines de ces femmes ont des cœurs en or, mais la plupart ont surtout la démarche épuisée de celles qui se lèvent tôt pour ne gagner pas grand-chose et qui multiplient les heures pour joindre les deux bouts.Dans ce monde, il faut s’adapter à des réalités bien concrètes. Notamment, la notion du temps est importante : « Dans les bus, il faut s’habituer à nettoyer une vitre sur deux. C’est ennuyeux parce qu’on voudrait laver tous les carreaux pareil, on a été élevé comme ça, c’est normal. Ce n’est pas possible, on n’a pas le temps, les employeurs calculent les heures de travail au plus juste ». Bien sûr il y a des hommes de ménage, mais il y a des tâches exclusivement féminines : « Les hommes passent l’aspirateur, l’autolaveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traversées de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC ». Le travail est harassant et les heures, y compris supplémentaires, ne se comptent plus : « J’ai un coup de fatigue, je ne vois nulle part où m’asseoir une minute, à part les toilettes. J’ai faim et soif. Deux heures de travail sur place sont payées : j’en mets trois, mais je me garde bien de le signaler, pas plus que je ne l’ai fait pour mon dépassement horaire dans les bureaux hier soir ».
La concurrence est telle qu’on ne peut pas se permettre de refuser le moindre boulot. « Si tu refuses une fois, tu es foutue, disparue, à la trappe. La boîte ne te rappelle jamais. Il y en a plein qui attendent derrière nous. » Il faut se contenter de se qu’on a, « tu te souviens comment c’était dur quand on n’avait rien ? » Pôle Emploi joue-t-il son rôle ? On est en droit d’en douter si l’on écoute la responsable d’une agence qui tance une conseillère choquée par des patrons qui imposent leurs tarifs horaires à la baisse : « “Ne commencez pas à décourager les employeurs, agissez comme ils vous le demande, ne les contredisez pas. Les offres ne sont pas faites selon vos désirs à vous, mais selon les leurs.” De toute façon, il n’y a pas de contrôle pour les employeurs, seulement pour les employés ». Et ce qui compte, c’est faire du chiffre : « Pôle Emploi n’aime pas que des gens se présentent directement, sans passer par eux : si par hasard ils étaient choisis, le recrutement ne compterait pas pour les statistiques positives de leur agence ». Pourquoi réunit-on certains demandeurs d’emploi ? Parce que « les chiffres du chômage doivent s’améliorer quoi qu’il arrive. Cette réunion en était un des moyens. On convoque une catégorie de chômeurs, cadres, RMistes, peu importe. Une partie ne viendra pas, et sans justificatif, c’est statistique. “Ce n’est pas grave”, avait tempéré le conseiller. Ils peuvent se réinscrire après, s’ils veulent, mais cela permet de faire chuter les chiffres, même pour quelques jours ».
Florence Aubenas nous décrit une crise de l’emploi, mais aussi une crise des valeurs humaines.
GLR
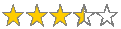
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Primo Levi a été déporté à Auschwitz en février 1944 ; il a commencé à penser à écrire son expérience concentrationnaire alors qu’il était encore dans le camp, le « Lager », et il a terminé ce livre en janvier 1947. Un témoignage à chaud sur la sombre froideur mortelle du Lager, écrit avec une chaleur humaine palpable et une simplicité lumineuse.
Primo Levi a été déporté à Auschwitz en février 1944 ; il a commencé à penser à écrire son expérience concentrationnaire alors qu’il était encore dans le camp, le « Lager », et il a terminé ce livre en janvier 1947. Un témoignage à chaud sur la sombre froideur mortelle du Lager, écrit avec une chaleur humaine palpable et une simplicité lumineuse.Primo Levi est fait prisonnier par la Milice fasciste en décembre 1943 ; il a 24 ans. C’est en entrant dans les wagons qui devaient les mener au Lager que Levi et ses 650 compagnons d’infortune furent confrontés à l’absurde : « C’est là que nous reçûmes les premiers coups : et la chose fut si inattendue, si insensée, que nous n’éprouvâmes nulle douleur ni dans le corps ni dans l’âme, mais seulement une profonde stupeur : comment pouvait-on frapper un homme sans colère ? ». Les Allemands ou ces Allemands ? La confusion est possible pour les survivants et leurs proches. La sortie des wagons plombés fut rythmée par « ces aboiements barbares naturels aux Allemands quand ils commandent ».
La première vision du camp qui restera gravée à jamais : « une grande porte surmontée d’une inscription vivement éclairée (aujourd’hui encore, son souvenir me poursuit en rêve) : ARBEIT MACHT FREI, le travail rend libre ». Après la séance de désinfection et rasage, « pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte : la démolition d’un homme. En un instant, dans une intuition quasi prophétique, la réalité nous apparaît : nous avons touché le fond ». Qui sera cet homme dépossédé ? « ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité : car il n’est pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même ». « Mon nom est 174 517 ». Pas d’échappatoire, « d’ici, on n’en sort que par la cheminée ».
Pourtant, la dignité reste un impératif vital : « ici, se laver tous les jours dans l’eau trouble d’un lavabo immonde est une opération pratiquement inutile du point de vue de l’hygiène et de la santé, mais extrêmement importante comme symptôme d’un reste de vitalité, et nécessaire comme instrument de survie morale ». Prendre soins ou reprendre conscience ?
 Le K.B., Krankenbau, l’infirmerie : « le K.B., c’est le Lager moins l’épuisement physique. Aussi quiconque possède encore une lueur de raison y reprend-il conscience ». « C’est dans cette baraque du K.B., au cours de cette parenthèse de paix relative, que nous avons appris combien notre personnalité est fragile, combien, beaucoup plus que notre vie, elle est menacée ». Au camp, nous voilà « morts à nous-mêmes avant de mourir à la vie, anonymement. Nous ne reviendrons pas. Personne ne sortira d’ici, qui pourrait porter au monde, avec le signe imprimé dans sa chair, la sinistre nouvelle de ce que l’homme, à Auschwitz, a pu faire d’un autre homme. » Il n’y a pas assez de mots, on n’a pas eu assez de temps pour en créer : « Si les Lager avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d’une âpreté nouvelle ; celui qui nous manque pour expliquer ce que c’est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec, pour tous vêtements, une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la fin est proche ».
Le K.B., Krankenbau, l’infirmerie : « le K.B., c’est le Lager moins l’épuisement physique. Aussi quiconque possède encore une lueur de raison y reprend-il conscience ». « C’est dans cette baraque du K.B., au cours de cette parenthèse de paix relative, que nous avons appris combien notre personnalité est fragile, combien, beaucoup plus que notre vie, elle est menacée ». Au camp, nous voilà « morts à nous-mêmes avant de mourir à la vie, anonymement. Nous ne reviendrons pas. Personne ne sortira d’ici, qui pourrait porter au monde, avec le signe imprimé dans sa chair, la sinistre nouvelle de ce que l’homme, à Auschwitz, a pu faire d’un autre homme. » Il n’y a pas assez de mots, on n’a pas eu assez de temps pour en créer : « Si les Lager avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d’une âpreté nouvelle ; celui qui nous manque pour expliquer ce que c’est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec, pour tous vêtements, une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la fin est proche ».Par le paradoxe d’une inhumanité à visage humain, Levi nous rappelle que « nous découvrons tous tôt ou tard dans la vie que le bonheur parfait n’existe pas, mais bien peu sont ceux qui s’arrêtent à cette considération inverse qu’il n’y a pas non plus de malheur absolu » et que « ce sont justement les privations, les coups, le froid, la soif qui nous ont empêchés de sombrer dans un désespoir sans fond ». Et les malheurs se superposent plus qu’ils ne s’additionnent, « car la nature humaine est ainsi faite, que les peines et les souffrances éprouvées simultanément ne s’additionnent pas totalement dans notre sensibilité, mais se dissimulent les unes derrière les autres par ordre de grandeur décroissante ». Lorsqu’on se met à penser, ce qui est exceptionnellement possible, « pendant quelques heures, nous pouvons être malheureux à la manière des hommes libres ». Survivre n’est pas un don mais appartient à la nature humaine ; « les moyens que nous avons su imaginer et mettre en œuvre pour survivre sont aussi nombreux qu’il y a de caractères humains ». Celui qui est au camp depuis quelques mois acquière la sagesse du « vieux prisonnier » : « notre sagesse, c’était de “ne pas chercher à comprendre”, de ne pas imaginer l’avenir, de ne pas nous mettre en peine pour savoir quand et comment tout cela finirait : de ne pas poser de questions, et de ne pas nous en poser ». Un homme prie après n’avoir pas été sélectionné pour la chambre à gaz ; « est-ce qu’il ne sait pas, Kuhn, que la prochaine fois ce sera son tour ? Est-ce qu’il ne comprend pas que ce qui a eu lieu aujourd’hui est une abomination qu’aucune prière propitiatoire, aucun pardon, aucune expiation des coupables, rien enfin de ce que l’homme a le pouvoir de faire ne pourra plus réparer ? Si j’étais Dieu, la prière de Kuhn, je la cracherais par terre ». Dans le camp, demain n’a plus de sens : « savez-vous comment on dit “jamais” dans langage du camp ? “Morgen früh”, demain matin ».

La foi en l’homme reste cependant possible à travers des rencontres singulières. De corvée pour aller chercher la soupe accompagné de Jean, un Alsacien totalement bilingue français-allemand, Primo Levi vole en chemin quelques instants de liberté en lui apprenant quelques phrases en italien. Quelles phrases ? Des bribes de souvenirs de Dante, La Divine Comédie. Lui vient alors « une fulgurante intuition, et qui contient peut-être l’explication de notre destin, de notre présence ici aujourd’hui… » : « Jusqu’à tant que la mer fût sur nous refermée ». Primo Levi fait d’autres rencontres salvatrices. C’est « à Lorenzo que je dois d’être encore vivant aujourd’hui, non pas tant pour son aide matérielle que pour m’avoir constamment rappelé, par sa présence, par sa façon si simple et facile d’être bon, qu’il existait encore, en dehors du nôtre, un monde juste, des choses et des êtres encore purs et intègres (…) ; quelque chose d’indéfinissable, comme une lointaine possibilité de bonté, pour laquelle il valait la peine de se conserver vivant ». « C’est à Lorenzo que je dois de n’avoir pas oublier que moi aussi j’étais un homme ».
GLR
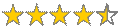
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Ora vient de rompre avec son mari, Ilan, parti en Amérique du sud avec son fils aîné, Adam. Son plus jeune fils de 20 ans, Ofer, risque sa vie au sein de l’armée israélienne. Aussi décide-t-elle, comme une évidence, de s’échapper de Jérusalem et de rompre tout contact avec le monde extérieur pour que son fils échappe à un destin tragique. Elle espère ainsi conjurer le mauvais sort : « en se sauvant de chez elle le marché sera ajourné, même provisoirement, du moins le croit-elle – celui que l’armée, la guerre et l’État risquent de lui imposer sous peu, voire cette nuit même. Ce marché arbitraire qui l’oblige, elle, Ora, à accepter d’apprendre de leur bouche la nouvelle du décès de son fils, de sorte qu’elle leur prête main-forte pour mener le processus complexe et pénible à son terme logique, et en validant cette mort, elle se fait en quelque sorte complice du crime. » C’est cette logique qu’elle veut casser dans une fuite calculée et salvatrice.
Ora vient de rompre avec son mari, Ilan, parti en Amérique du sud avec son fils aîné, Adam. Son plus jeune fils de 20 ans, Ofer, risque sa vie au sein de l’armée israélienne. Aussi décide-t-elle, comme une évidence, de s’échapper de Jérusalem et de rompre tout contact avec le monde extérieur pour que son fils échappe à un destin tragique. Elle espère ainsi conjurer le mauvais sort : « en se sauvant de chez elle le marché sera ajourné, même provisoirement, du moins le croit-elle – celui que l’armée, la guerre et l’État risquent de lui imposer sous peu, voire cette nuit même. Ce marché arbitraire qui l’oblige, elle, Ora, à accepter d’apprendre de leur bouche la nouvelle du décès de son fils, de sorte qu’elle leur prête main-forte pour mener le processus complexe et pénible à son terme logique, et en validant cette mort, elle se fait en quelque sorte complice du crime. » C’est cette logique qu’elle veut casser dans une fuite calculée et salvatrice.Où doit-elle aller pour fuir ? « - Allons-y ! - Où ça ? - Au fin fond du pays. - Pour moi, il y a un bail que nous avons touché le fond ». Elle part en randonnée à travers la Galilée en compagnie d’Avram, un amour de jeunesse intimement lié à Ilan et à Ofer. Ora et Avram vont faire renaître Ofer, elle à travers ses souvenirs, lui à travers son écoute. Une écoute qui ne lui est pas naturelle au départ, tant Avram a sombré dans la solitude, mais qu’il va développer. « Les familles, c’est de l’algèbre pour moi. Tant de variables, de parenthèses, de multiplications par des puissances, toutes ces complications, ce besoin constant d’être en relation avec tous les autres membres de cette famille, à n’importe quel moment, de jour comme de nuit, même en rêve. C’est comme recevoir en permanence des décharges électriques, ou vivre dans un éternel orage ».
Que reste-t-il de cette mère qui a porté à bout de bras son mari et ses deux enfants ? Que reste-t-il d’Ora, « la super maman ? Une chiffe molle, voilà ce qu’elle est ! Une éponge très efficace. Pendant vingt-cinq ans, elle n’a cessé d’essuyer tout ce qui suintait de ses trois hommes, chacun à sa façon, ce qu’ils déversaient au fil des ans, jour après jour, dans le microcosme familial ».
David Grossman nous livre une vision des soldats amis et ennemis loin d’être manichéenne. Ainsi, Ilan observe-t-il un pilote égyptien qui s’est éjecté de son avion en flammes et vient de gagner le sol : « Des soldats égyptiens se jetèrent à son cou, comme s’ils voulaient le protéger des tirs éventuels en provenance du fortin ennemi. Les Israéliens observaient la scène dans un morne silence, non dénué d’envie. Ilan frotta sa figure sale. Durant des milliers d’heures qu’il avait passées à écouter les soldats égyptiens dans le bunker de Bavel, traduisant jour et nuit leurs propos, épiant la routine militaire, les gestes quotidiens, les blagues, les plaisanteries obscènes, les secrets les plus intimes, jamais il n’avait senti, comme aujourd’hui, en regardant étreindre leur camarade, à quel point ils étaient réels, des créatures vivantes, faites de chair et de sang, dotées d’une âme ».
Quant à Avram, c’est un ours plein d’autodérision. Dans un passé encore très présent où il était encerclé dans un fortin par l’armée égyptienne, il avait moins peur d’être tué qu’il ne redoutait la façon de l’être : « Ils ont incendié le fort. Les hommes, l’équipement, la cuisine, nos bardas, ce qui leur est tombé sous la main. Ils se sont pointés avec des lance-flammes et ils ont mis le feu partout. Je les entendais. Tout a brûlé »… et ils peuvent revenir à tout moment terminer le travail : « la pendaison peut provoquer l’éjaculation, c’est connu, mais au lance-flammes, j’ai de sérieux doutes ». Avram écrit sur des dizaines de carnets ses pensées ou des nouvelles. La plus courte de ses nouvelles : « Le jour de ma naissance, ma vie changea du tout au tout ».
A travers une écriture ciselée à plusieurs voix, le cheminement des protagonistes s’entremêlent, dans leurs âpres souvenirs et sur les chemins escarpés de Galilée. Le récit de David Grossman n’a pas permis à son propre fils cadet de tomber au Sud-Liban en août 2006, aux dernières heures de cette guerre inutile, alors que l’auteur était en train d’achever ce roman. Le roman est traduit par la toujours très appréciée Sylvie Cohen.
GLR
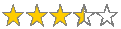
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Conrad Lang (« Koni ») est le régisseur de la résidence secondaire des Koch, riche famille d’industriels suisses. Conrad a été pour ainsi dire élevé dans cette famille, « fils naturel d’une employée de maison des Koch » ; il était le faire valoir, le souffre douleur, le jouet et l’ombre du fils Thomas (« Tomi »).
Conrad Lang (« Koni ») est le régisseur de la résidence secondaire des Koch, riche famille d’industriels suisses. Conrad a été pour ainsi dire élevé dans cette famille, « fils naturel d’une employée de maison des Koch » ; il était le faire valoir, le souffre douleur, le jouet et l’ombre du fils Thomas (« Tomi »).A la soixantaine, Conrad est porté sur l’alcool, son refuge. La villa des Koch part en fumée du fait de sa négligence. Dès lors, Elvira, la mère de Thomas, veut couper les ponts avec ce gênant personnage ; elle lui octroie un revenu en échange de son éloignement. Pour Conrad, c’est l’occasion d’un nouveau départ, de l’arrêt de l’alcool et de la rencontre avec l’âme sœur. Mais bien vite des troubles de la mémoire viennent mettre à mal sa nouvelle vie. A mesure qu’il perd ses repères immédiats, sont libérés les souvenirs lointains de son enfance. Des souvenirs que tout le monde a oublié, des souvenirs de plus en plus précis qui commencent à inquiéter Elvira. Avec l’aide bienveillante de Simone, la belle-fille de Thomas, Conrad parviendra-t-il à retrouver des repères dans un monde qui se rétracte ? « Small World ! Comme le monde est petit ! ».
Ce roman nous plonge dans les affres de l’appât du gain, où la bonne société bourgeoise montre son hideuse face. Il explore aussi la lente et inexorable descente aux enfers de la maladie d’Alzheimer ; mais la maladie peut aussi permettre de voir le monde sous un angle nouveau. Un monde où Tonikoni et Konitomi s’entremêlent.
Un roman à lire d’une seule traite, avant ou après avoir vu la très belle adaptation au cinéma de Bruno Chiche en 2011, Je n’ai rien oublié, avec le désormais Belge Russe Gérard Depardieu et le toujours magnifique Franco-Danois Niels Arestrup.
GLR
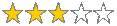
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Achak a 6 ans quand il quitte son village natal, Marial Bai, au Sud-Soudan, fuyant les attaques des cavaliers Murahaleen, arabes sanguinaires et esclavagistes de la tribu des Baggara. Lui, petit Dinka, n’a jamais connu que la tranquillité de son village autour de ses frères et sœurs, de sa mère attentive, de ses belles-mères bienveillantes et de son père, commerçant aisé. Il se retrouve sur les routes accompagnant une cohorte d’enfants abandonnés, les Enfants perdus du Soudan, marchant sans relâche pour échapper aux pillards, aux soldats du gouvernement de Khartoum et aux rebelles de l’Armée populaire de libération du Soudan de John Garang. Dans ce pays en guerre, la solidarité africaine est mise à mal et il est bien difficile de faire face à la faim (ou bien de mourir après avoir mangé de l’éléphant cru), aux bêtes sauvages nocturnes (croqués par un lion), à la conscription forcée, aux affres des camps de réfugiés en Ethiopie (Pinyudo) puis au Kenya. « Au Soudan, mourir est un jeu d’enfant. Surtout pour un enfant. »
Achak a 6 ans quand il quitte son village natal, Marial Bai, au Sud-Soudan, fuyant les attaques des cavaliers Murahaleen, arabes sanguinaires et esclavagistes de la tribu des Baggara. Lui, petit Dinka, n’a jamais connu que la tranquillité de son village autour de ses frères et sœurs, de sa mère attentive, de ses belles-mères bienveillantes et de son père, commerçant aisé. Il se retrouve sur les routes accompagnant une cohorte d’enfants abandonnés, les Enfants perdus du Soudan, marchant sans relâche pour échapper aux pillards, aux soldats du gouvernement de Khartoum et aux rebelles de l’Armée populaire de libération du Soudan de John Garang. Dans ce pays en guerre, la solidarité africaine est mise à mal et il est bien difficile de faire face à la faim (ou bien de mourir après avoir mangé de l’éléphant cru), aux bêtes sauvages nocturnes (croqués par un lion), à la conscription forcée, aux affres des camps de réfugiés en Ethiopie (Pinyudo) puis au Kenya. « Au Soudan, mourir est un jeu d’enfant. Surtout pour un enfant. »En offrant à l’homme le bétail, Dieu lui dit : « choisis entre ce troupeau, qui est mon cadeau, et le Quoi ». L’homme opta pour le bétail, synonyme de santé et de bonheur. C’était le bon choix : Dieu testait l’homme (cette histoire est racontée par son père). Qu’est-ce que le Quoi ? « Personne ne sait ».
Eggers nous permet de comprendre le cheminement d’Achak à travers son regard. Et justement, « les êtres humains se divisent en deux catégories : ceux qui sont encore capables de voir avec leurs yeux d’enfant et les autres. » Bientôt les Enfants perdus se dirigent vers Bilpam, en Ethiopie, un but qu’ils ne comprennent pas et pour cause : « Un Ethiopie, on ne savait pas du tout ce que c’était. “C’est un pays. Comme le Soudan est un pays” dit Dut. “Si c’est pareil, pourquoi c’est ailleurs ?” demanda Deng ». Mais Achak et les Enfants vont rapidement déchanter : « L’Ethiopie ne représentait rien et on y était pas plus en sécurité qu’au Soudan, sauf que ce n’était pas le Soudan et que j’étais très loin des miens ». Achak voit en Ethiopie un homme blanc pour la première fois : « j’ai suivi leurs regards et je suis tombé sur une absence d’homme. Un homme à l’envers, un homme qui avait été gommé ».
Eggers nous éclaire aussi sur bien des aspects de ce conflit qui ont pu nous échapper. « Ce conflit a accouché de racistes dans les deux camps. Les dirigeants de Khartoum ont savamment attisé ce foyer de racisme. Ils ont fait ressurgir, et même parfois créé de toutes pièces de nouvelles haines. En ont découlé des actes d’une brutalité sans précédent ».
Chassés de Pinyudo par les Ethiopiens à la chute de Mengistu, Achak échappe miraculeusement à mille morts pour se retrouver réfugié à Kakuma, au Kenya, « sur une terre si poussiéreuse et désolée qu’aucun Dinka n’aurait jamais songé à s’y installer ». « Notre chez nous pour un an, puis deux, puis cinq et dix ans. Dix ans, là où personne, sauf les plus désespérés, n’envisagerait de passer un après-midi ». « Kakuma était un no mans’ land. D’ailleurs, on nous l’avait dit, en kenyan kakuma signifie “nulle part” ».

Achak a eu la chance de partir vers d’autres horizons, vers l’Amérique, pour y étudier. Pourra-t-il un jour revenir dans son Soudan natal ? « C’est le plus incroyable des retournements de situation que nous, qui avons été trimballés de camp en camp et qui en avons laissé la moitié sur le carreau, soyons désormais considérés comme l’espoir de la nation. »
Beaucoup plus qu’un documentaire, Eggers nous fait partager le témoignage poignant de Valentino Achak Deng dans cette partie de l’Afrique où les conflits jettent sur les routes ses enfants vers… en fait vers Quoi ?
GLR
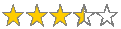
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Voici l’histoire d’Antoine qui débute pendant l’été 1951 à Pont-Saint-Esprit. L’histoire d’un petit boulanger tranquille qui se trouve propulsé dans le monde du LSD et de la guerre froide, après avoir mangé un morceau de “pain maudit”. Un monde où Antoine croise le chemin de Lucy.
Voici l’histoire d’Antoine qui débute pendant l’été 1951 à Pont-Saint-Esprit. L’histoire d’un petit boulanger tranquille qui se trouve propulsé dans le monde du LSD et de la guerre froide, après avoir mangé un morceau de “pain maudit”. Un monde où Antoine croise le chemin de Lucy.Voici un récit empli de poésie. Un récit construit sur une musique diphonique saisissante qui enchaîne les rythmes… de la lenteur du village de Pont-Saint-Esprit à la cadence de la folie qui emporte Antoine vers sa disparition. Dans une écriture très visuelle, Claro nous enchante par son alchimie unique des mots, par sa voix.
La construction ciselée alterne brillamment entre Lucy et Antoine, entre les germes et les disparitions, le soleil et l’éclipse. Nous entrons dans ces années 1950-60 de manière décapante depuis le village sorti des âges, le LSD et l’héroïne, les hippies américains sur fond de guerre froide jusqu’à l’introduction du business du porno dans un 69 parisien.
On peut regretter quelques manques sur cet arrière-fond de la guerre froide, sur cette action de la CIA qui reste floue. L’entrée en matière pourrait par ailleurs sembler très lente, voire hermétique, si on ne se laissait pas aspirer par cette voix puissante.
BBLR
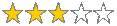
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Smokey Nelson attend dans les couloirs de la mort du pénitencier de Charlestown son exécution pour le quadruple meurtre qu’il a commis il y a près de 20 ans. Ce sont successivement les voix des acteurs de ce drame qui alternent pour évoquer à la fois des bribes de leurs souvenirs, de leur hantise mais aussi des bouts d’Amérique et de leur vie, de leurs espoirs. Tous vont se trouver aux prises de cet évènement, dans cette ville proche d’Atlanta, dans le sud des États-Unis.
Smokey Nelson attend dans les couloirs de la mort du pénitencier de Charlestown son exécution pour le quadruple meurtre qu’il a commis il y a près de 20 ans. Ce sont successivement les voix des acteurs de ce drame qui alternent pour évoquer à la fois des bribes de leurs souvenirs, de leur hantise mais aussi des bouts d’Amérique et de leur vie, de leurs espoirs. Tous vont se trouver aux prises de cet évènement, dans cette ville proche d’Atlanta, dans le sud des États-Unis. On rencontre tout d’abord Sydney Blanchard qui se rend sur la tombe de son idole et double Jimmy Hendrix avant de partir de Seattle pour se rendre dans sa Louisiane natale. Sydney Blanchard est noir comme Smokey Nelson. Et il a été faussement accusé des crimes et emprisonné pendant quelques temps, lui, le noir qui aurait pu être condamné en lieu et place de Smokey Nelson. Et on suit Sydney Blanchard tout au long de son monologue et dialogue avec sa chienne adorée, dans sa diatribe contre la société américaine mais aussi sa description de la Nouvelle-Orléans, sa vie et ses amours. Pearl Watanabe, originaire de Honolulu, est à l’inverse de Sydney une femme sereine qui cultive la vie zen. C’est elle qui a découvert la scène du crime dans le motel des environs d’Atlanta où elle travaillait alors. Traumatisée par cette journée d’octobre 1989, elle est repartie vivre dans son île d’Hawaï mais s’apprête à rejoindre sa fille dans ce sud des États-Unis qu’elle a fui, aux derniers jours de vie de Smokey Nelson. Deux points de vue différenciés entre la mère et sa fille sur la vie américaine se font écho. Mais déjà on découvre Ray Ryan qui s’apprête à quitter son domaine dans les montagnes de Géorgie avec son fils Tom pour aller assister à l’exécution de l’assassin de sa fille, de ses deux petits-enfants et de son gendre. Il attend avec satisfaction que la justice divine soit rendue dans un long prêche qu’il entend de Dieu à son égard. Profondément conservateur et intolérant, il décrit sa petite société étriquée qui s’organise autour de lui, le patriarche fidèle à Dieu. Enfin Smokey Nelson, autour duquel gravitent ces vies, raconte ses dernières heures avant l’exécution.
Catherine Mavrekakis présente dans ce roman polyphonique différentes voix de l’Amérique actuelle. Elle sait merveilleusement enchaîner les points de vue autour d’une même affaire qui hante les États-Unis, autour de cette peine de mort qui fait rejoindre sans jamais les confronter directement les situations d’un républicain ultrareligieux et intolérant avec celle d’un noir américain qui porte un regard désabusé sur la société ou celle d’une femme en quête de sérénité dans ce monde violent. Catherine Mavrekakis nous emporte dans ces multiples microcosmes en nous faisant vivre les pensées des uns et des autres au sein des familles, des conflits, des incompréhensions entre une mère jugée « fataliste » et « mystique » et une fille qui multiplie les activités pour ne pas avoir à penser à la réalité de sa vie. C’est un régal d’entrer ainsi de plein pied dans la société américaine, tout en maintenant en permanence et sur le fil une analyse psychologique fine des acteurs en présence. L’écriture est sensible et d’une profonde acuité. Le style varie avec bonheur selon les positions des acteurs, alternant le monologue rythmé de Sydney avec sa chienne, les sensations douces et différenciées entre Pearl et sa fille puis le discours imprécatoire de Dieu tel qu’il est reçu par Ray Ryan. Parfois cependant les alternances semblent se répéter. Les voix se font écho mais restent cloisonnées, ce qui est certainement le point de vue attendu de l’auteure pour décrire une société multiculturelle mais en même temps très close dans ses relations. Un bon moment de lecture qui donne envie de découvrir d’autres livres de cette auteure elle-même issue du melting-pot américain, d’un père grec et d’une mère française et qui vit aujourd’hui à Montréal et écrit en français.
BBLR
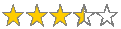
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Voilà la vie de Yersin, découvreur du bacille de la peste, dans un texte bien peu romancé. L’auteur puise l’essentiel de ses sources dans l’abondante correspondance de Yersin avec sa mère Fanny et sa sœur Emilie.
Voilà la vie de Yersin, découvreur du bacille de la peste, dans un texte bien peu romancé. L’auteur puise l’essentiel de ses sources dans l’abondante correspondance de Yersin avec sa mère Fanny et sa sœur Emilie.Ce Suisse bilingue français-allemand est d’abord étudiant en Allemagne à Marburg puis à Berlin, devient médecin chercheur à Paris, où il est naturalisé Français, auprès de Roux et de Pasteur à l’Institut qui va vite prendre ce nom. Ce découvreur de la toxine diphtérique décide de devenir voyageur puis explorateur. Il prend la mer comme médecin de bord pour la compagnie des Messageries Maritimes, affecté en Asie sur la ligne Saigon-Manille, puis sur la ligne de Haiphong reliant Saigon et Hanoi. « Le premier point où l’on s’arrête après Saigon est Nha Trang » écrit-il. « On prononce Nia Trang » précise-t-il. Il y prendra régulièrement ses quartiers pendant plus de 50 ans où il joue le rôle du « médecin des pauvres ». Après deux ans de navigation, Yersin s’ennuie, s’installe à Nha Trang et, de là, part en exploration dans la jungle durant des semaines. « Le voilà explorateur et arpenteur, appointé par le gouverneur général ». À ce « nouveau Livingstone » taciturne et solitaire, « on lui demande en échange d’étudier sur son passage le tracé de nouvelles voies pour le commerce, de signaler les lieux propices à l’élevage, d’inventorier les richesses forestières et minérales ». Les antiseptiques pasteuriens lui permettront de survivre aux petites écorchures de la jungle, et surtout à une blessure thoracique provoquée par une lance après un combat contre des brigands. Roux et Pasteur le convainquent de lâcher son bâton de pèlerin et de reprendre l’éprouvette en l’envoyant enquêter à Hong-Kong où sévit une effroyable épidémie de peste. Il n’a alors que 31 ans. Yersin observe, note, photographie, autopsie à l’insu des autorités anglaises, examine au microscope. A partir d’un bubon, « Yersin est le premier homme à observer le bacille de la peste ». Yersinia pestis. Plus tard à Canton, « Yersin est le premier médecin à sauver un pestiféré ». Yersin constate le rôle des rats comme principal vecteur, mais c’est un autre pasteurien, Simond, envoyé à Bombay pour prendre la suite de Yersin, qui découvre que la puce est le véritable vecteur de la peste. Yersin retourne à Nha Trang où il élève des troupeaux pour produire du sérum contre la peste et pour étudier d’autres maladies infectieuses. En 1902, Paul Doumer, alors gouverneur général d’Indochine, demande à son ami Yersin de diriger à Hanoi une école de médecine et un laboratoire rattaché à l’Institut Pasteur. Il y restera 3 ans avant de retrouver son Nha Trang. Il y deviendra, entre autres, producteur de caoutchouc et de quinquina qui lui permettent de s’enrichir. Il confie « la recherche médicale », « la recherche vétérinaire » et « les quinquinas » à des collaborateurs triés sur le volet pour se consacrer à la météorologie et à l’astronomie, passant « du microscope au télescope ». Yersin finira sa vie à Nha Trang, en Indochine occupée par les Japonais, pendant l’occupation allemande de la France.
J’ai été trop descriptif ? Patrick Deville aussi. Et le choléra dans tout ça ? Peut-être l’auteur a-t-il hésité à faire un livre sur Pacini ou sur Koch, et son indécision entre deux maux nous a valu ce titre.
En page 111, on trouve ce joli pléonasme : « épizooties animales ». Et ailleurs, un joli exemple de paradoxe : « le paradoxe de l’universalité française, pour un Suisse, déjà dans leur Déclaration : cette idéologie française qui parait toujours à ce point curieuse aux étrangers qu’elle montre bien, par là même, qu’elle ne l’est pas tant que ça, universelle ». Et pour le lecteur, le paradoxe, c’est d’apprendre beaucoup de choses sur ce personnage peu connu qu’était Yersin tout en restant peu convaincu par le style de l’auteur. Tout comme le lecteur que je suis, « en vieil épidémiologiste, Yersin n’oublie pas que le pire est toujours le plus sûr. »
GLR

 votre commentaire
votre commentaire
-
 Octave Mirbeau nous dit en préambule avoir repris le journal d’une femme de chambre, Célestine, en s’efforçant de garder sa voix. Mais… où est la voix de la femme derrière Célestine, qui ne peut résister, comme toute femme n’est-ce pas, à la chair, à ces mâles passions ? On peine à entrer dans la tête stéréotypée de cette femme avec l’esprit de Mirbeau, de domestique, de dominée, dans cet univers juste glauque.
Octave Mirbeau nous dit en préambule avoir repris le journal d’une femme de chambre, Célestine, en s’efforçant de garder sa voix. Mais… où est la voix de la femme derrière Célestine, qui ne peut résister, comme toute femme n’est-ce pas, à la chair, à ces mâles passions ? On peine à entrer dans la tête stéréotypée de cette femme avec l’esprit de Mirbeau, de domestique, de dominée, dans cet univers juste glauque.Mirbeau parvient en revanche à dépouiller au scalpel les relations maîtres-domestiques, la chosification de l’autre. La grande bourgeoise, dont les trois enfants jouent sur le gazon, interdisant à son jardinier et sa femme d’avoir un enfant… « il ne manquerait plus que ça, vous n’avez qu’à faire attention… sinon c’est la porte ! »
Maîtres et domestiques dans une petite ville de Normandie, où le vice semble seul établi, derrière l’hypocrisie et les convenances inconcevables. Mais le groupe des dominés, tout autant que celui des dominants, reste une bouillie informe, uniforme. Seules les passions antisémites et conservatrices semblent avoir bonne presse auprès des domestiques. Seul le sexe semble dominer les bonnes.
Parfois, on semble toucher du doigt ce sentiment de n’être que le meuble du maître, ce rapport de dépendance absolu. Mais bien vite on ne suit plus. Le viol et le meurtre d’une petite fille émergent puis restent en suspension. Célestine semble avoir découvert le meurtrier mais elle est emportée dans sa passion charnelle. Les muscles de l’homme dominent son esprit… On ne voit pas Célestine mais Octave regardant une domestique. Pensant à sa place. Il peut retranscrire ces situations d’humiliation, ces positions d’esclavage, telles qu’il les a vues, entendues en 1900. Mais il n’est pas à cette place, celle de Célestine. Il la regarde seulement depuis son fauteuil.
BBLR

 votre commentaire
votre commentaire
-
 Comment écrire avec vérité ? Une vérité sensible, tactile presque, au fil des pages, sur les déchirures de ses parents dans le regard d’un enfant. Cet enfant qui, à cet instant de la fuite du père est accaparé par les joies et les tristesses d’un jeu de personnages célèbres… Vie à hauteur de l’enfant qu’il était alors et reste encore. Et la valise donnée par son père bien plus tard. Une valise de cuir qui recèle les secrets d’un homme. Les rêves d’un homme qui aurait voulu être écrivain mais n’était pas prêt à abandonner les douceurs de sa vie pour s’enfermer et connaître les affres et l’insécurité de l’écriture.
Comment écrire avec vérité ? Une vérité sensible, tactile presque, au fil des pages, sur les déchirures de ses parents dans le regard d’un enfant. Cet enfant qui, à cet instant de la fuite du père est accaparé par les joies et les tristesses d’un jeu de personnages célèbres… Vie à hauteur de l’enfant qu’il était alors et reste encore. Et la valise donnée par son père bien plus tard. Une valise de cuir qui recèle les secrets d’un homme. Les rêves d’un homme qui aurait voulu être écrivain mais n’était pas prêt à abandonner les douceurs de sa vie pour s’enfermer et connaître les affres et l’insécurité de l’écriture.Orhan Pamuk et la maison empoussiérée de sa grand-mère qui ne vit plus que dans sa chambre, dans son lit. Orhan Pamuk et la douleur de sa mère rejetée. Et pourtant la vie est là, dans cet enfant qui regarde par la fenêtre le courant d’Istanbul. La vie dans sa collection de cartes quand le drame se déroule… une séparation vue comme un arrière-fond à la centralité du jeu des enfants.
Orhan Pamuk aborde aussi son acte d’écriture. Le sentiment de provincialité et le souci d’authenticité dominent son regard sur la valise de son père et son action lorsqu’il est assis à sa table d’écriture. Ce sont ces douleurs secrètes qui pulsent son écriture. Et Orhan Pamuk nous offre sa vision de l’écrit non vain. Pour lui, c’est « parler des choses que tout le monde sait sans en avoir conscience »… « Le plaisir de parcourir en s’étonnant un monde familier ». Oui, il parle de ma vie, de mon monde, s’exclame-t-on lorsqu’une page nous saisit dans notre intimité qui ne parvient pas à se verbaliser.
Enfin Orhan Pamuk témoigne ici d’une reconnaissance essentielle pour son père qui lui a ouvert sa valise d’écrivain pour qu’il s’en empare, lui. Reconnaissance « de n’avoir pas été un père ordinaire, distribuant des ordres et des interdictions, qui écrase et punit et de m’avoir toujours respecté et laissé libre ». Laisser libre. Orhan Pamuk tient là l’acte d’amour, qui construit au lieu de fournir un plan préétabli auquel on se sent souvent obligé de se conformer, comme les autres, tout en ayant un sentiment d’irréalité de soi. Ce n’est pas ce que nous pensions de la vie, mais on est bien obligé…
Orhan Pamuk ajoute : « j’ai parfois cru que mon imagination pouvait fonctionner librement comme celle d’un enfant, parce que je ne connaissais pas la peur de perdre, contrairement à de nombreux amis de mon enfance et de ma jeunesse ». Son père, en le laissant libre a écarté de sa voie cette peur qui ronge tant nos générations, celle de perdre le plan qu’on nous a donné dès notre enfance, qui dessine chaque étape de notre vie.
Et j’aimerais laisser ici quelques uns de ses mots, comme des notes de musique sur sa partition d’écrivain :
« Pourquoi écrivez-vous ? » Et il répond : « j’écris parce que j’en ai envie. J’écris parce que je ne peux pas faire comme les autres un travail normal. J’écris pour que des livres comme les miens soient écrits et que je les lise. J’écris parce que je suis très fâché contre vous tous, contre tout le monde. J’écris parce qu’il me plaît de rester enfermé dans une chambre, à longueur de journée. J’écris parce que je ne peux supporter la réalité qu’en la modifiant. J’écris pour que le monde entier sache quel genre de vie nous avons vécue, nous vivons, moi, les autres, nous tous, à Istanbul, en Turquie. J’écris parce que j’aime l’odeur du papier et de l’encre. J’écris parce que je crois par-dessus tout à la littérature, à l’art du roman. J’écris parce que c’est une habitude et une passion. J’écris parce que je suis sensible à la célébrité et à l’intérêt que ça m’apporte. J’écris pour être seul. J’écris dans l’espoir de comprendre pourquoi je suis à ce point fâché avec vous tous, avec tout le monde. J’écris parce qu’il me plaît d’être lu. J’écris en me disant qu’il faut que je finisse ce roman, cette page que j’ai commencée. J’écris en me disant que c’est ce que tout le monde attend de moi. J’écris parce que je crois comme un enfant à l’immortalité des bibliothèques et à la place qu’y tiendront mes livres. J’écris parce que la vie, le monde, tout est incroyablement beau et étonnant. J’écris parce qu’il est plaisant de traduire en mots toute cette beauté et la richesse de la vie. J’écris non pas pour raconter des histoires, mais pour construire des histoires. J’écris pour échapper au sentiment que je ne peux atteindre tel lieu auquel j’aspire, comme dans les rêves. J’écris parce que je n’arrive pas à être heureux, quoi que je fasse. J’écris pour être heureux. »
Une part, celle de l’écrire, est à cueillir ici… à prolonger aussi…
BBLR
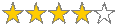
 votre commentaire
votre commentaire
-
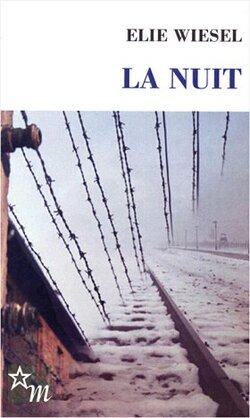 Elie Wiesel a écrit La Nuit en 1958, c’est-à-dire 14 ans après avoir été déporté à Auschwitz et Birkenau à l’âge de 16 ans. « Si de ma vie je n’avais eu à écrire qu’un seul livre, ce serait celui-ci » commence-t-il sa préface de la nouvelle édition, retraduite du Yiddish par son épouse 48 ans après la première parution. Cette préface est éclairante sur les intentions de l’auteur qui tente de comprendre et de faire comprendre la raison de son témoignage.
Elie Wiesel a écrit La Nuit en 1958, c’est-à-dire 14 ans après avoir été déporté à Auschwitz et Birkenau à l’âge de 16 ans. « Si de ma vie je n’avais eu à écrire qu’un seul livre, ce serait celui-ci » commence-t-il sa préface de la nouvelle édition, retraduite du Yiddish par son épouse 48 ans après la première parution. Cette préface est éclairante sur les intentions de l’auteur qui tente de comprendre et de faire comprendre la raison de son témoignage.Quels mots choisir pour dire l’indicible ? « Lesquels employer pour raconter le dernier voyage dans des wagons plombés vers l’inconnu ? Et la découverte d’un univers dément et froid où c’était humain d’être inhumain ». Le témoignage peut paraître vain puisque « seuls ceux qui ont connu Auschwitz savent ce que c’était. Les autres ne le sauront jamais ». Et pourquoi nous est-il, nous les lecteurs, si difficile de comprendre ? « Est-ce parce que le témoin s’exprime si mal ? La raison est différente. Ce n’est pas parce que, maladroit, il s’exprime pauvrement que vous ne comprendrez pas ; c’est parce que vous ne comprendrez pas qu’il s’exprime si pauvrement ». Elie Wiesel a écrit pour que le lecteur n’oublie pas. « Oublier les morts serait les tuer une deuxième fois ».
Lire La Nuit, c’est se poser des questions sans vouloir trouver de réponses. D’ailleurs, les questions sont plus importantes que les réponses, comme Elie Wiesel l’a appris très jeune alors qu’il était encore pieux : « chaque question possédait une force que la réponse ne contenait plus… L’homme s’élève vers Dieu par les questions qu’il lui pose. Voilà le vrai dialogue. L’homme interroge et Dieu répond. Mais ses réponses, on ne les comprend pas ».
« Jamais je n’oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et sept fois verrouillée. Jamais je n’oublierai cette fumée. Jamais je n’oublierai les petits visages des enfants dont j’avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n’oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n’oublierai ce silence nocturne qui m’a privé pour l’éternité du désir de vivre. Jamais je n’oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n’oublierai cela, même si j’étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. »
GLR
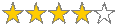
 votre commentaire
votre commentaire
-
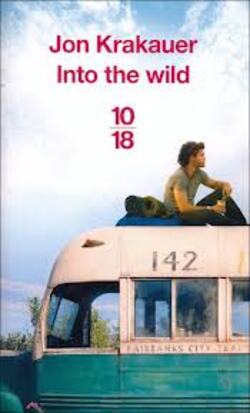 Christopher McCandless a le feu. Porté par un idéal de pureté et de nature, il quitte sa famille et son milieu bourgeois en 1990, dès son diplôme universitaire en poche. Christopher vit sa quête d’absolu. Il offre ses économies à une association caritative et part sans un sou dans une traversée des Etats-Unis, qui le mènera jusqu’au cœur des forêts de l’Alaska, vers un idéal de retour en soi et de survie dans un milieu naturel qui lui sera fatal…
Christopher McCandless a le feu. Porté par un idéal de pureté et de nature, il quitte sa famille et son milieu bourgeois en 1990, dès son diplôme universitaire en poche. Christopher vit sa quête d’absolu. Il offre ses économies à une association caritative et part sans un sou dans une traversée des Etats-Unis, qui le mènera jusqu’au cœur des forêts de l’Alaska, vers un idéal de retour en soi et de survie dans un milieu naturel qui lui sera fatal…John Krakauer dresse un très beau portrait de ce jeune assoiffé d’absolu, qui cherche à vivre en entière conformité avec ses principes. En intégrant ce destin parmi tous ceux qui ont également cherché à se dépasser pour vivre hors d’une civilisation qui ne répondait pas à leur quête, en l’éclairant de toutes ses lectures de Tolstoï à Thoreau, en passant par Boris Pasternak, John Krakauer nous offre une histoire universelle et éternelle. Celle de vivre son idéal, non de dominer mais de vivre avec, dans la nature. Celle de se retrouver soi, de vivre réellement, après avoir plongé dans les origines et l’intégrité du monde. Celle de choisir sa vie au lieu de la subir. Celle d’essayer de vivre son rêve, ce que bien peu font.
Laissons un passage de Walden ou la vie dans les bois de Thoreau, souligné par Christopher McCandless, exprimer bien mieux cette recherche humaine :
« Si le jour et la nuit deviennent tels que vous les saluez joyeusement, et si la vie produit une senteur pareille à celle des fleurs et des plantes aromatiques, si elle est plus souple, plus étincelante, plus immortelle, en cela réside votre réussite. La nature tout entière vous acclame et vous devez momentanément vous accorder à vous-même votre bénédiction. Les plus grands biens et les plus grandes valeurs sont loin d’avoir été reconnus. Nous en venons facilement à en douter. Bientôt, nous les oublions. Ils sont pourtant la plus haute réalité… La vraie moisson de ma vie quotidienne est quelque chose d’aussi intangible et d’aussi indescriptible que les teintes du matin et du soir. C’est un peu de poussière d’étoile, c’est un morceau d’arc-en-ciel que j’ai attrapé »
BBLR
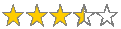
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Je connaissais la verve d’Albert Londres dans « Terre d’ébène ». Sa description acérée du colonialisme, sa plume qui dresse en quelques traits les portraits saisissants de quelques colonies d’Afrique dans les années 1920… Et j’ai retrouvé au fil des rayonnages d’une merveilleuse librairie de Toulouse, Terra Nova, quelques trésors encore inconnus pour moi de ce journaliste hors pair !
Je connaissais la verve d’Albert Londres dans « Terre d’ébène ». Sa description acérée du colonialisme, sa plume qui dresse en quelques traits les portraits saisissants de quelques colonies d’Afrique dans les années 1920… Et j’ai retrouvé au fil des rayonnages d’une merveilleuse librairie de Toulouse, Terra Nova, quelques trésors encore inconnus pour moi de ce journaliste hors pair !Parmi ces trésors, « Le juif errant est arrivé », ou la pérégrination d’un nomade à travers l’Europe et jusqu’à la Terre Promise, sur les pas des communautés juives. Un petit diamant ciselé et visionnaire écrit en 1930 !
Albert Londres part de Paris. Il suit un vieux rabbin rencontré par hasard dans le train jusqu’au quartier juif de Whitechapel à Londres. C’est à suivre son expédition sur les traces des juifs disséminés entre Tchécoslovaquie, Pologne et Russie qu’il nous invite, jusqu’à traverser les eaux pour atteindre la Palestine. Ce récit d’Albert Londres, comme toujours, n’est pas qu’un simple reportage : il est une réalité vivante, mouvante et émouvante qui s’étend devant nos yeux. En quelques phrases aiguisées, il saisit l’essence d’un temps, d’un peuple, le destin d’un homme qui souhaite relever ses frères d’un joug qui semble figé dans l’éternité. Théodore Herzl est mort, son rêve vit.
Albert Londres a des yeux qui voient la misère des juifs de l’est, maintenus dans les montagnes des Marmaroches ou dans le ghetto de Lwow, ne parlant que le yiddish, plongés dans le Talmud, ne pouvant travailler, ne pouvant que survivre… encore et toujours étrangers dans ces nations. Albert Londres saisit les contrastes entre les quartiers juifs de Londres et d’Europe de l’ouest et les communautés de l’est. Là où pour les uns, la question se pose de savoir si le cœur d’Israël bat toujours, les autres vivent repliés, écartés, face au seul regard de Dieu. Albert Londres rencontre de jeunes sionistes. Il les accompagne à travers les ghettos, questionnant avec eux les habitants sur leur désir de Jérusalem. Pour beaucoup, seul le Messie pourra annoncer cette nouvelle, et elle n’est pas encore arrivée. Pour d’autres, il est trop tard : « Messieurs, j’ai mis 73 ans à charmer les Européens, à d’autres de charmer les Arabes ! »
La plume d’Albert Londres devient prophétique lorsqu’elle accoste sur les terres de Palestine. A sa question, « Juif errant, es-tu arrivé ? », Albert Londres esquisse en 1930 une réponse d’une brûlante actualité. Mais n’en disons pas plus, lisez ce livre jusqu’à ces toutes dernières pages…
BBLR
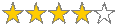
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Le titre est sympathique… l’accroche de l’histoire tentante. Le vieil Allan Karsson ne souhaite pas fêter son centième anniversaire dans la maison de retraite où il réside. Pour l’occasion, il entend bien boire un coup – ce qui lui est interdit par la sœur Alice, sergente en chef du lieu. Aussi prend-t-il la tangente la veille de la fête. C’est chaussé de ses plus belles charentaises qu’il se rend à la gare routière pour la destination inconnue que ces maigres économies lui permettront d’atteindre. Mais les choses s’enchaînant de manière inattendue (comme toujours semble-t-il avec Allan), il se retrouve embarqué dans un road-movie décapant. Avec une valise que lui a confié un petit délinquant et qui contient… rien moins que 50 millions de couronnes. Dans une cavale aux rebondissements incessants, Allan Karlsson, qui n’est pas le vieil arthritique sans histoire qu’il semble paraître, rencontre des personnages plus déjantés les uns que les autres, d’un vendeur de saucisses surdiplômé à une femme accompagnée de son éléphante… Ce roman entend manier humour noir et décalé tout en restant dans un ton joyeux et tendre. Les personnages saisis au fil des rencontres pourraient prendre de l’épaisseur, tout autant que l’histoire.
Le titre est sympathique… l’accroche de l’histoire tentante. Le vieil Allan Karsson ne souhaite pas fêter son centième anniversaire dans la maison de retraite où il réside. Pour l’occasion, il entend bien boire un coup – ce qui lui est interdit par la sœur Alice, sergente en chef du lieu. Aussi prend-t-il la tangente la veille de la fête. C’est chaussé de ses plus belles charentaises qu’il se rend à la gare routière pour la destination inconnue que ces maigres économies lui permettront d’atteindre. Mais les choses s’enchaînant de manière inattendue (comme toujours semble-t-il avec Allan), il se retrouve embarqué dans un road-movie décapant. Avec une valise que lui a confié un petit délinquant et qui contient… rien moins que 50 millions de couronnes. Dans une cavale aux rebondissements incessants, Allan Karlsson, qui n’est pas le vieil arthritique sans histoire qu’il semble paraître, rencontre des personnages plus déjantés les uns que les autres, d’un vendeur de saucisses surdiplômé à une femme accompagnée de son éléphante… Ce roman entend manier humour noir et décalé tout en restant dans un ton joyeux et tendre. Les personnages saisis au fil des rencontres pourraient prendre de l’épaisseur, tout autant que l’histoire.Mais - parce qu’il y a un mais - le résultat est bien loin d’être à la hauteur de l’annonce. Le récit se répète, l’humour tourne de plus en plus en rond… les péripéties antérieures d’un Allan Karlsson complètement apolitique dans les tourments de l’histoire se mêlent lourdement à la cavale. Le récit tombe dans la mièvrerie tandis que les aventures d’Allan Karlsson avant son retour en Suède deviennent de plus en plus pathétiques. Certes, garder un ton décalé et fourmillant d’humour sur plus de 500 pages n’est pas simple. Mais de là à s’ennuyer et vouloir en finir avec cette histoire...
BBLR
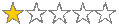
 votre commentaire
votre commentaire
-
 « Et ma mère tomba à genoux. » La France entre dans la Ve République au moment où la famille Blick s’effondre à la mort du frère aîné de Paul, le narrateur. L’histoire d’Une vie française se confond avec le parcours de cette république de de Gaulle à Chirac : « Il faut s’imaginer la France d’alors, une 403 bleu marine ou grise, intérieur en velours ras, de Gaulle au volant, les deux mains sur le cercle, Yvonne à ses côtés, le sac à main sur les genoux, et nous, nous tous, derrière, en proie aux nausées des promenades dominicales, à l’ennui vertigineux d’un avenir déjà démodé. (…) La France ressemblait à ces familiales au dessin un peu raide, ces berlines de petits notaires ou d’employés de l’Etat, tristes à périr, conduites sans excès ni fantaisie par un général catholique toujours prompt à rétrograder les vitesses dans l’ordre de la grille, et qui, le reste du temps, vivait dans les téléviseurs Grandin. Je vous parle d’un pays aujourd’hui bien plus englouti que l’Atlantide… »
« Et ma mère tomba à genoux. » La France entre dans la Ve République au moment où la famille Blick s’effondre à la mort du frère aîné de Paul, le narrateur. L’histoire d’Une vie française se confond avec le parcours de cette république de de Gaulle à Chirac : « Il faut s’imaginer la France d’alors, une 403 bleu marine ou grise, intérieur en velours ras, de Gaulle au volant, les deux mains sur le cercle, Yvonne à ses côtés, le sac à main sur les genoux, et nous, nous tous, derrière, en proie aux nausées des promenades dominicales, à l’ennui vertigineux d’un avenir déjà démodé. (…) La France ressemblait à ces familiales au dessin un peu raide, ces berlines de petits notaires ou d’employés de l’Etat, tristes à périr, conduites sans excès ni fantaisie par un général catholique toujours prompt à rétrograder les vitesses dans l’ordre de la grille, et qui, le reste du temps, vivait dans les téléviseurs Grandin. Je vous parle d’un pays aujourd’hui bien plus englouti que l’Atlantide… »Et nous voilà embarqués au volant d’une de ces voitures des années 60, de ses écoles sans fantaisie, du purgatoire de l’adolescence, aux côtés d’un copain déjanté qui vous fait découvrir un monde insoupçonné de transgression en même temps qu’un univers terriblement solitaire. Jean-Paul Dubois nous emmène sur des chemins corsetés ou débraillés avec un égal humour désabusé, pour observer, le nez au vent, depuis la vitre de la 403 le monde qui l’environne et change au fil des ans.
Parce qu’Une vie française dans les années 60 est aussi celle d’un jeune libertaire qui passe son bachot en 1968, qui découvre les libertés vite barricadées de cette révolution politique, sociale et sexuelle dans le chaud mois de mai. Jean-Paul Dubois nous emporte dans les remous de ses familles qui adoptent les masques de leurs époques, de mai 68 aux années 80 « où il fallait être mort pour ne pas avoir d’ambition » : « L’argent avait l’odeur agressive et prémerdeuse des déodorants pour toilettes. Tous ceux que ce fumet incommodait étaient priés de n’en point dégoûter les autres. Et de se mettre sur le côté. » Les mots sont justes et cinglent sur cette période du fric à gogo et de l’esprit d’entreprise.
Dans ce roman d’un contemporain décalé, nous sommes aspirés dans l’esprit et l’histoire de notre époque. On est saisi par ce temps qui emporte loin des rêves adolescents, sans même s’en apercevoir. Devenu photographe de l’immobilité, l’observateur se décale de plus en plus. Les chutes suivent les brusques ascensions. La vie de Paul Blick est soumise aux secousses permanentes de notre époque hypomaniaque. L’évènement de 2002, l’éviction de Lionel Jospin au 1er tour de la présidentielle « m’avait frappé. Il m’avait permis de mesurer la vanité du monde moderne, cet univers outrageusement actif, bardé de capteurs, fonçant tête baissée sur les fantômes de ses certitudes, effaçant ses erreurs comme autant d’artefacts, négligeant le recul, méprisant la lenteur, oublieux, amnésique et voyou. »
Ce roman décape nos vies françaises étriquées avec le choix de mots qui pointent et appuient au bon endroit, pour se rappeler et ouvrir nos yeux. Mais une vie française n’est pas qu’ironie et acidité. Il est aussi le tonneau de nos questions, de nos petites existences. Il effleure la force de nos sensibilités. Une vie française est un roman de nos vies à lire.
BBLR
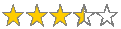
 votre commentaire
votre commentaire
-
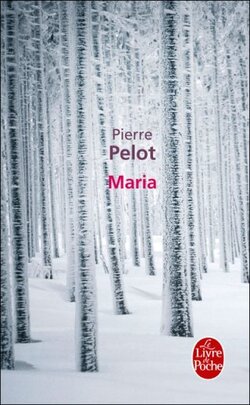 Un homme se rend dans un village des Vosges. Il pleut. Il vient de loin pour rencontrer une vieille dame qui vit aujourd’hui en maison de retraite, Maria. En route il entend cette vieille dame conter l’histoire des lieux dans une émission locale. Mais que vient-il chercher auprès de Maria ? Que sait-il d’elle, de son passé, de la guerre ?
Un homme se rend dans un village des Vosges. Il pleut. Il vient de loin pour rencontrer une vieille dame qui vit aujourd’hui en maison de retraite, Maria. En route il entend cette vieille dame conter l’histoire des lieux dans une émission locale. Mais que vient-il chercher auprès de Maria ? Que sait-il d’elle, de son passé, de la guerre ?A travers ce court récit, Pierre Pelot restitue le parfum lourd et dur de ces forêts denses où la parole s’est perdue, où l’histoire se déroule en milliers d’années dans la voix de Maria alors qu’un passé proche semble s’être oublié. L’histoire des Vosges alterne avec les souvenirs de Maria et cet inconnu qui vient vers elle. Pierre Pelot construit son roman des réminiscences lointaines jusqu’à aujourd’hui de manière simplement adroite. Il laisse ici un récit sensible où on entre à pas feutrés, un récit qui crisse sous nos pieds comme la neige qui vient de tomber.
BBLR
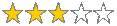
 votre commentaire
votre commentaire
-
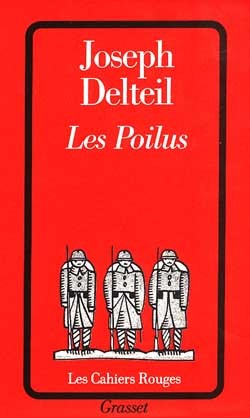 La dédicace est déjà un monument « Aux morts, pour qu’ils vivent ! Aux vivants, pour qu’ils aiment ! »
La dédicace est déjà un monument « Aux morts, pour qu’ils vivent ! Aux vivants, pour qu’ils aiment ! »Et lorsque je tourne la page, la préface m’enchaîne tout autant à poursuivre la lecture, à tourner une autre page… « J’ai une tête épique (…) Aussi longtemps qu’il y aura des battements de cœur dans ma poitrine, aussi longtemps qu’il y aura un peu de bleu au zénith, aussi longtemps qu’il y aura des printemps sous le ciel et qu’il y aura des femmes au monde, je crierai : A bas la guerre ! »… Mais cette tête épique écrit pourtant bien un roman épique sur les poilus écrit huit ans après la Grande Guerre que Delteil a fait, dans un régiment de tirailleurs sénégalais. Roman sur la geste des Poilus anonymes tout autant que sur l’arrière incarnée dans la femme, la « Poilue », cet ouvrage n’est ni un témoignage, ni un roman historique. Etonnant, l’ouvrage de Delteil est chargé d’émotion pour ces soldats tout autant que d’humour. Parce que si Delteil est opposé à la Guerre et soutient le pacifisme du président Wilson, « il y a quelqu’un qui est en dehors et au-dessus de la guerre : c’est le Poilu ». Delteil « chante le Poilu », il « chante l’homme ».
La langue de Joseph Delteil chante et ses mots vibrent. Ils savent trouver l’espace juste dans les paysages de Narbonne à Limoux écrasés par la chaleur du mois de juillet 1914 ; ils savent renvoyer l’écho de l’avenir des hommes de ce pays. A cet instant de la mobilisation « le département de l’Aude sue »… « Tout a un air étroit et ardent, un air de piques. Chaque plante est une baïonnette ».
Un roman étonnant, détonnant dans les tonnerres de la guerre et des poilus. Une langue d’un passé, à redécouvrir.
BBLR
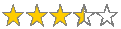
 votre commentaire
votre commentaire
-
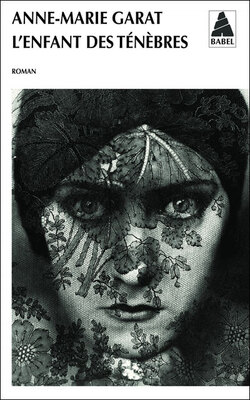
 Impressionnante trilogie. Trois volumes (c’est le bon terme) de respectivement plus de 1 200, 900 et 1 000 pages, cela peut rebuter plus d’un lecteur. Et pourtant, on est happé trois fois par cette grande fresque où la petite histoire familiale sert de support pour brosser la grande Histoire du 20e siècle. Il y a un fil conducteur pour ces trois romans : l’essor de la femme moderne, indépendante, maîtresse de son destin.
Impressionnante trilogie. Trois volumes (c’est le bon terme) de respectivement plus de 1 200, 900 et 1 000 pages, cela peut rebuter plus d’un lecteur. Et pourtant, on est happé trois fois par cette grande fresque où la petite histoire familiale sert de support pour brosser la grande Histoire du 20e siècle. Il y a un fil conducteur pour ces trois romans : l’essor de la femme moderne, indépendante, maîtresse de son destin.Le premier tome se situe en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale. Le personnage principal, Gabrielle Demachy, est une jeune femme intrépide à la recherche de son cousin et premier amour, Endre, ingénieur disparu depuis cinq ans en Birmanie. Avec l’appui inattendu d’un employé du ministère de la Guerre, elle suit la piste d’un certain Pierre Galay, médecin qui fut en mission en Birmanie. Elle réussit à s’introduire dans la famille Bertin-Galay, célèbres biscuitiers, et devient la préceptrice de la petite Camille, fille de Pierre Galay. C’est le début d’une aventure périlleuse où se mêlent l’espionnage, les complots, le crime, la passion et l’amour. Les personnages sont dépeints avec talent, ancrés dans une époque où se côtoient la paisible vie rurale et les bouleversements de la vie urbaine, avec ses découvertes scientifiques et ses avancées industrielles.
Le deuxième tome se déroule en 1933-1934, dans le contexte de l’arrivée au pouvoir du national-socialisme allemand qui laisse planer l’ombre d’un nouveau conflit. Vingt ans après, le roman est cette fois centré sur Camille Galay, revenant de New-York pour retrouver le Paris de son enfance. Elle va notamment y rencontrer Simon Lewenthal, directeur des usines Bertin-Galay et collectionneur de tableaux de maîtres.

Le troisième tome se déroule en 1963. Cette fois, trente ans plus tard, c’est Christine Lewenthal, la troisième génération, qui se trouve au premier plan, bientôt entourée de jeunes gens indépendants : Antoine le projectionniste de ciné-club qui nage dans le bidonville de Nanterre comme un poisson dans l’eau, Alex l’historien qui a découvert un document bouleversant, Viviane en rupture avec son député de père autour duquel se multiplient les morts suspects. Tous ces personnages vivent avec leur temps et se projettent dans l’avenir. Mais le passé resurgit des décombres, laissant apparaître de hideux fantômes. Et cette plongée dans le passé est la condition nécessaire pour affronter l’avenir : « qu’est-ce que penser à demain si l’on ne sait rien du passé ? »
L’écriture d’Anne-Marie Garat a la précision du scalpel, même si la précision entraîne quelque lassitude. Le vocabulaire parfois un peu désuet est en parfaite harmonie avec l’atmosphère bourgeoise du début du 20e siècle, et donc bien adapté au premier tome. Ce vocabulaire reste inchangé pour les 2 tomes suivants, ce qui donne un petit air anachronique parfois curieux : « peu me chaut ton œil comminatoire » sied difficilement au Paris des années soixante.
GLR
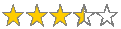
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Désirée vient de perdre son mari. Benny vient de perdre sa mère. Elle est bibliothécaire, intello, maigrelette, s’habille en gris souris et habite un petit appartement tout blanc en ville. Il est paysan, beauf, grassouillet, affublé d’un blouson voyant et vit pour sa ferme et ses 24 vaches laitières. L’unique point commun entre ces deux êtres si différents : les tombes de leur proche se côtoient. Non, ils ont un deuxième point commun : ils ont un don pour s’entourer des bonnes personnes. Désirée a une amie intime de bon conseil, Märta, en dévotion pour un bel amant égoïste qui ne la mène qu’à la déprime. Et Benny n’a pas le temps d’avoir d’autres amis qu’un couple, Bengt-Göran et Violette, encore plus beauf que lui.
Désirée vient de perdre son mari. Benny vient de perdre sa mère. Elle est bibliothécaire, intello, maigrelette, s’habille en gris souris et habite un petit appartement tout blanc en ville. Il est paysan, beauf, grassouillet, affublé d’un blouson voyant et vit pour sa ferme et ses 24 vaches laitières. L’unique point commun entre ces deux êtres si différents : les tombes de leur proche se côtoient. Non, ils ont un deuxième point commun : ils ont un don pour s’entourer des bonnes personnes. Désirée a une amie intime de bon conseil, Märta, en dévotion pour un bel amant égoïste qui ne la mène qu’à la déprime. Et Benny n’a pas le temps d’avoir d’autres amis qu’un couple, Bengt-Göran et Violette, encore plus beauf que lui.« Ça vous dirait… de venir faire un tour au cimetière ? Alors là, je suis sûre que vous dites ça à toutes les filles ! » La rencontre dans un cimetière entre une maigre carpe et un rustre lapin peut-elle changer la destinée de ces deux solitaires ? « On va aussi bien ensemble que la merde et les pantalons verts ». Sans doute, au moins pour un temps, selon la loi inébranlable qui veut que les opposés s’attirent au moment de choisir entre opéra et traite des vaches. Les ovules de Désirée ne sont tourneboulés que par ce fermier, blaireau dont la seule lecture assidue est cantonnée aux petites annonces du journal local. Une relation qui va être à l’opposé de celle qu’elle avait avec son défunt mari et qu’elle résume ainsi : « les hommes existent, ou n’existent pas, c’est surtout une question de savoir combien de côtelettes il convient d’acheter pour le dîner ». Et ce pragmatisme est bien partagé par Benny : « dans ma famille, c’est simple, on ne frappe pas les femmes. Pas parce qu’on est particulièrement chevaleresque, j’imagine, plutôt parce qu’on ne veut pas gâcher une main d’œuvre précieuse ».
Un roman plein d’humour, de dérision et de fraîcheur : un bol d’air frais nous arrivant de Suède.
GLR
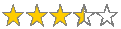
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Frédéric, journaliste, sillonne le monde dans les zones les plus improbables. En reportage dans le désert entre l’Éthiopie et la Somalie en guerre, il rencontre Ayanleh Makeda, double champion olympique de marathon, tombé en disgrâce à la suite d’un contrôle antidopage. Relégué au rôle de sentinelle, ce bel athlète n’est pas homme à regarder en arrière. Vision européenne d’un « fatalisme africain » ?
Frédéric, journaliste, sillonne le monde dans les zones les plus improbables. En reportage dans le désert entre l’Éthiopie et la Somalie en guerre, il rencontre Ayanleh Makeda, double champion olympique de marathon, tombé en disgrâce à la suite d’un contrôle antidopage. Relégué au rôle de sentinelle, ce bel athlète n’est pas homme à regarder en arrière. Vision européenne d’un « fatalisme africain » ?Frédéric, cherche à comprendre les motivations de cet homme pour la course, les circonstances de son ascension puis de sa chute en allant vers ceux qui l’ont accompagné. Il va en particulier à la rencontre de sa femme Tirunesh et de sa masseuse-ostéopathe Hanna. A travers ces femmes, il va petit à petit réunir les pièces du puzzle, comprendre comment Ayanleh a pu vivre pour la course dès son plus jeune âge, gérer des marathons où il côtoyait les plus grands, devenir l’un des leurs, s’installer à Paris avec Tirunesh et ses enfants dans un monde si différent de son Ethiopie natale, sillonner les capitales du monde entier, et retourner vers la case départ sans haine et sans regret. Comprendre la force et la fragilité du champion : « un athlète de très haut niveau, c’est une composition de muscles sur le point de se déchirer ». Pour Ayanleh, après la nuit viendra de nouveau le jour : « “Sentinelle, où en est la nuit ?” “Le matin va venir et de nouveau la nuit”. Isaïe, chapitre 21 ».
L’histoire d’un homme exceptionnel par sa grâce et son élégance et pourtant si humble, vu par un grand reporter qui pourrait être Jean Hatzfeld, ou ne pas l’être. Un auteur qui, à mon avis, excelle cependant plus dans le récit que dans le roman.
GLR
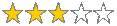
 votre commentaire
votre commentaire
-
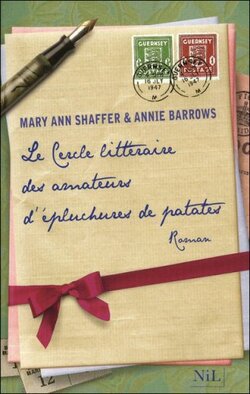 Au lendemain de la guerre, en janvier 1946, l’écrivaine anglaise Juliet enchaîne les séances de dédicaces pour la vente de son dernier roman et elle se demande bien quel pourrait être le sujet du suivant. Elle reçoit alors la lettre énigmatique d’un habitant de Guernesey, Dawsey Adams. Faisant référence à un cercle des amateurs de littérature et de tourte aux épluchures de patates institué à cause d’un cochon rôti caché aux autorités allemandes, ce courrier intrigue la jeune Juliet qui à travers sa correspondance avec Dawsey et tous les membres du cercle (plus les voisins et une partie des habitants de Guernesey) nous introduit dans un monde insulaire décalé. Ce microcosme soumis à l’occupation allemande s’est trouvé rapproché et soudé par le cercle. La littérature s’est immiscée dans la vie de tous ses membres sous les aspects les plus variés, depuis les écrits de Sénèque jusqu’aux Hauts de Hurlevent, et leur a presque fait oublier « la noirceur du dehors ». Et ce sont deux réelles amoureuses de la littérature qui sont les auteurs de ce roman lorsqu’elles font écrire à Juliet qui adresse à Dawsey la correspondance de l’auteur dont il s’est épris, Charles Lamb :
Au lendemain de la guerre, en janvier 1946, l’écrivaine anglaise Juliet enchaîne les séances de dédicaces pour la vente de son dernier roman et elle se demande bien quel pourrait être le sujet du suivant. Elle reçoit alors la lettre énigmatique d’un habitant de Guernesey, Dawsey Adams. Faisant référence à un cercle des amateurs de littérature et de tourte aux épluchures de patates institué à cause d’un cochon rôti caché aux autorités allemandes, ce courrier intrigue la jeune Juliet qui à travers sa correspondance avec Dawsey et tous les membres du cercle (plus les voisins et une partie des habitants de Guernesey) nous introduit dans un monde insulaire décalé. Ce microcosme soumis à l’occupation allemande s’est trouvé rapproché et soudé par le cercle. La littérature s’est immiscée dans la vie de tous ses membres sous les aspects les plus variés, depuis les écrits de Sénèque jusqu’aux Hauts de Hurlevent, et leur a presque fait oublier « la noirceur du dehors ». Et ce sont deux réelles amoureuses de la littérature qui sont les auteurs de ce roman lorsqu’elles font écrire à Juliet qui adresse à Dawsey la correspondance de l’auteur dont il s’est épris, Charles Lamb :« Je pense qu’elle vous en apprendra plus sur lui qu’aucune biographie. E.V. Lucas me paraît trop sérieux pour qu’il cite mon passage préféré de Lamb : “Bzzz, bzzz, bzzz, boum, boum, boum, fuit, fuit, plonk, plonk, ding, ding, ding, ploc ! Je finirai certainement condamné. J’ai bu à l’excès deux jours durant. Je retrouve mon sens moral au dernier stade de la tuberculose et ma foi vacille.” C’est par ces écrits que j’ai connu Lamb, et j’ai honte d’avouer que je n’ai acheté ce livre que parce que j’avais lu quelque part qu’un certain Charles Lamb avait rendu visite à son ami Leigh Hunt, emprisonné pour avoir diffamé le prince de Galles. Au cours de cette visite, Lamb a aidé Hunt à peindre un ciel bleu avec des nuages blancs sur le plafond de sa cellule, et un rosier grimpant sur l’un des murs (…) Il a aussi appris à la benjamine de Hunt à réciter le Notre-Père à l’envers. Il est naturel de vouloir en savoir le plus possible sur un tel homme. C’est ce que j’aime dans la lecture. Un détail minuscule attire votre attention et vous mène à un autre livre, dans lequel vous trouverez un petit passage qui vous mènera vers un troisième livre. Cela fonctionne de manière géométrique, à l’infini, et c’est du plaisir pur ».
Dans ce roman joyeusement fantasque, Mary Ann Shaffer, ancienne bibliothécaire et libraire décédée en 2008, nous livre avec sa nièce Annie Barrows des portraits attachants et tendrement croqués, autour de Dawsey et du pilier de ce cercle Elizabeth. Choisir le genre épistolaire pour ce roman est une réelle originalité, tant il permet de dévoiler sans jamais lasser lieux, habitants, vieux conflits et non-dits de ces îles anglo-normandes. Et l’humour décalé et typiquement British qui empreint ce livre de bout en bout permet d’aborder tout autant la guerre ou les camps sans lourdeur. Si ce livre peut paraître un peu lisse sur les personnages et la guerre, on a tant de plaisir à le lire qu’on en oublie l’absence d’aspérités, et tant pis pour les grincheux !
BBLR
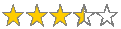
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Rithy Panh s’est trouvé emporté à l’âge de 13 ans avec toute sa famille dans la cruauté et la folie des Khmers rouges. L’élimination est à la fois le récit de son histoire et celui de sa confrontation avec Duch.
Rithy Panh s’est trouvé emporté à l’âge de 13 ans avec toute sa famille dans la cruauté et la folie des Khmers rouges. L’élimination est à la fois le récit de son histoire et celui de sa confrontation avec Duch.Déjà quelques années avant, le cinéaste Rithy Panh s’était au cours de sa préparation du film S21 –La Machine de mort khmère rouge, entretenu avec les gardiens et les bourreaux qui avaient nié le droit d’être un homme aux prisonniers. Et Rithy Panh demande à Duch aussi « s’il cauchemarde, la nuit, d’avoir fait électrocuter, frapper avec des câbles électriques, planter des aiguilles sous les ongles, d’avoir fait manger des excréments, d’avoir consigné des aveux qui sont des mensonges, d’avoir fait égorger ces femmes et ces hommes, les yeux bandés au bord de la fosse, dans le grondement du groupe électrogène. Il réfléchit puis me répond, les yeux baissés : “Non”. Plus tard, je filme son rire. »
Tout est là, dans cette rencontre impossible entre Rithy Panh, qui a vécu et raconte la famine sous les khmers, le déplacement, les travaux forcés, la mort, l’enfer des vivants, et Duch, le responsable de S21 qui lui demande au cours d’un entretien : « c’est combien l’heure ? » sur le mode de la plaisanterie, qui disserte sur Marx et le matérialisme historique, qui esquive, se contredit en ne reconnaissant ni les victimes ni ses camarades : « Peu à peu, Duch a retrouvé la parole, mais il ne restait que le mensonge ». Rithy Panh saisit qu’il entraîne Duch à son procès par la série d’entretiens qu’il a avec lui, mais aussi que Duch souhaiterait qu’ils se comprennent, qu’ils rient ensemble. Duch semble chercher le reflet de sa propre humanité à travers ces entretiens. Si la rencontre est impossible, le récit de cette confrontation est puissant. Rithy Panh nous plonge en parallèle dans ce que fut le Kampuchéa démocratique, la folie de « donner à la classe haïe un nom plein d’espoir : nouveau peuple » tout en l’éliminant… (lire la suite sur la page spéciale Duch et les Khmers rouges).
BBLR
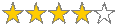
 votre commentaire
votre commentaire
-
 De la rencontre de ses parents aux onze enfants qui en naissent, du soleil de Bizerte à l’appartement de Neuilly jusqu’à leur chute à la cité noire, Lionel Duroy nous fait vivre avec intensité la vie chaotique de sa famille. Si les Dunoyer de Pranassac semblent toujours faire les choix politiques les plus hasardeux de la Guerre de 39-45 à celle d’Algérie, Lionel Duroy peint surtout avec beaucoup de sensibilité LA Famille, les places qu’elle assigne aux enfants, selon les traits que leur visage a hérités : « celui-ci c’est un vrai Duvernois » et « ah ! celui-là c’est un parfait Dunoyer… ». Place donnée ou refusée, Lionel Duroy excelle à nous faire saisir les souffrances de cette construction familiale, le degré d’amour variant selon les lois de la génétique…
De la rencontre de ses parents aux onze enfants qui en naissent, du soleil de Bizerte à l’appartement de Neuilly jusqu’à leur chute à la cité noire, Lionel Duroy nous fait vivre avec intensité la vie chaotique de sa famille. Si les Dunoyer de Pranassac semblent toujours faire les choix politiques les plus hasardeux de la Guerre de 39-45 à celle d’Algérie, Lionel Duroy peint surtout avec beaucoup de sensibilité LA Famille, les places qu’elle assigne aux enfants, selon les traits que leur visage a hérités : « celui-ci c’est un vrai Duvernois » et « ah ! celui-là c’est un parfait Dunoyer… ». Place donnée ou refusée, Lionel Duroy excelle à nous faire saisir les souffrances de cette construction familiale, le degré d’amour variant selon les lois de la génétique…Dans la famille Dunoyer de Pranassac, il y a tout d’abord la mère… une belle femme qui vit dans le souvenir de son père, rêve de luxe et de convenances sociales. Une femme qui aime aussi un mari prêt à tout pour satisfaire ses exigences. Toto, le père, qui garde un sang-froid incroyable face à toutes les difficultés accumulées qu’il a lui-même souvent générées. Toto qui ne sait pas s’imposer ni s’opposer mais qui continue de vivre, qui garde le sourire pour ses enfants, qui peint et repeint les murs avec ténacité selon les goûts de sa femme. Et puis il y a les nombreux frères et sœurs… et les choix de vie qui s’imposent selon le dessein familial et les circonstances :
« Comment ai-je pu, moi qui avais tant aimé la philo, m’inscrire en première année de licence de droit ? Nicolas fait de même. Il me semble que c’est Frédéric qui nous en convainc, sous le prétexte que nous devons rapidement décrocher un diplôme qui nous permette de gagner le plus d’argent possible (pour sortir Toto de la merde, et ne pas y tomber à notre tour).
Le jour, je suis surveillant au cours Sévigné pour rembourser notre dette, et le soir je suis à l’université de Nanterre à écouter des professeurs qui parlent la même langue que les huissiers et ont le même regard implacable et désincarné sur la vie, sur le commerce entre les hommes. (…) Je suis triste et déprimé d’être tombé chez ces gens, surtout quand je me remémore ma félicité en classe de terminale, mon émotion pour Sisyphe dans l’ombre duquel je devinais Toto. Cependant, je continue de suivre les cours, me demandant que faire de ma vie. Et comme souvent, dans de telles circonstances, la vie décide pour nous… ».
Lionel Duroy retrace ce parcours d’enfant balloté dans une famille en crise et ce moment de rupture avec l’idéologie familiale. C’est cet instant où le choix apparaît, où « je me surprends à rêver, à entendre des phrases se former dans ma tête, s’enchaîner, composer bientôt tout un paragraphe, toute une page peut-être, qui me semble exprimer quelque chose de si essentiel, ou de si beau, que j’essaie aussitôt de le retranscrire »… Lionel Duroy dessine le parcours d’un adulte dont l’enfant crie sans parvenir à s’entendre parler… un peu comme l’écriture se perd jusqu’à trouver son chemin : « Cependant, le temps de trouver un crayon et du papier, je l’ai perdu, ou parfois le temps d’écrire la première phrase j’ai perdu tout le reste. Comme si ces mots, ou ces images, étaient enfouis si profondément en moi qu’ils n’affleuraient que dans certaines situations particulières, certains moments de détachement, d’inattention ou de grâce, avant de m’échapper aussitôt entraperçus. Cela me désespère et, en même temps, me remplit d’espoir. »
L’écriture vient, du journalisme au roman… mais c’est avant tout le roman familial que doit écrire l’enfant qui crie encore. Au risque de perdre les siens, de déchirer les liens. Et « Le chagrin » reste le livre d’une tristesse. Ce récit mélancolique porte le poids d’un destin familial dont l’auteur cherche à démonter la mécanique.
On se laisse happer par Le Chagrin, dans cette histoire si personnelle mais aussi universelle. Juste une question : pourquoi chercher à relier sa nouvelle vie à son histoire familiale. ? Cette dernière part est un peu le morceau surajouté comme si Lionel Duroy voulait retisser le roman familial décousu en y intégrant les mailles de sa nouvelle famille restée inconnue aux siens.
BBLR
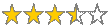
 votre commentaire
votre commentaire
-
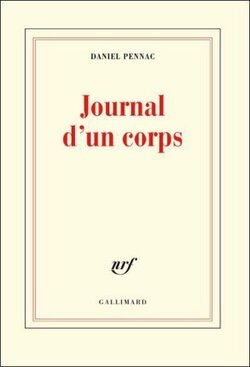 En 1936, à « 13 ans, 1 mois et 4 jours », un jeune garçon écrit dans un cahier qu’il tiendra jusqu’à sa mort, à l’âge de 87 ans : « Papa disait : Tout objet est d’abord objet d’intérêt. Donc mon corps est un objet d’intérêt. Je vais écrire le journal de mon corps »
En 1936, à « 13 ans, 1 mois et 4 jours », un jeune garçon écrit dans un cahier qu’il tiendra jusqu’à sa mort, à l’âge de 87 ans : « Papa disait : Tout objet est d’abord objet d’intérêt. Donc mon corps est un objet d’intérêt. Je vais écrire le journal de mon corps »Il décide d’écrire le journal de son corps « parce que tout le monde parle d’autre chose ». Parce que le corps semble ne jamais être pris en considération alors même qu’il parle tant, qu’il exprime nos sentiments, qu’il imprime notre mémoire affective, la démarche branlante de la Violette tant aimée du narrateur tout autant que le souvenir, les habitus de nos êtres proches. Et Daniel Pennac sait entendre ces corps souvent corsetés par l’éducation. Ainsi décrit-il avec tendresse l’évolution du corps de sa fille soumise à l’apprentissage de l’écriture :
« Lison est à l’âge où l’enfant engage son corps entier dans le dessin. C’est tout le bras qui dessine : épaule, coude et poignet. Toute la surface de la page est requise (…). Dessin en expansion. Dans un an, l’apprentissage de l’écriture aura raison de cette ampleur. La ligne dictera sa loi. Épaule et coude soudés, poignet immobile, le geste se trouvera réduit à cette oscillation du pouce et de l’index qu’exigent les minutieux ourlets de l’écriture. Les dessins de Lison pâtiront de cette soumission à qui je dois ma calligraphie de greffier, si parfaitement lisible. Une fois qu’elle saura écrire, Lison se mettra à dessiner de petites choses qui flotteront dans la page, dessins atrophiés comme jadis les pieds des princesses chinoises ».
Nous suivons avec plaisir le narrateur dans les lectures de son corps et de celui des autres. Et nous découvrons avec humour que le langage du corps est commun entre les hommes, universel. Pourtant nous nous sentons souvent à l’étroit dans le notre, uniques dans nos perceptions et parfois un peu seuls dans nos complexes ou nos désolations… Daniel Pennac sait nous communiquer le lien corporel qui nous unit aux différents âges de nos vies. Ainsi l’entrée en adolescence du fils du narrateur est-elle en résonnance directe avec nos souvenirs d’avant et nos questions de maintenant… un peu comme si Daniel Pennac nous tapotait la main. On se sent un peu moins seuls et on en rit aussi quand il raconte les relations entre un père et son fils :
« 45 ans, 1 mois, 2 jours… Après un dîner silencieux Bruno part se coucher sans un mot, avec, au visage, une absence d’expression qui se voudrait expressive. La situation se répète souvent, ces temps-ci. Nous sommes en adolescence. Nous nous souhaitons un faciès qui nous dispense de la corvée orale. Nous travaillons le silence signifiant. Nous promenons notre visage comme une radioscopie de notre âme. Hélas, les visages ne disent rien. A peine des fonds de toile où se mire la susceptibilité du père. Qu’ai-je donc fait à mon fils pour mériter cette tête d’enterrement ? se demande le père que cette énigme infantilise ; encore un peu il s’écrierait : C’est pas juste ! (…) Parle, mon fils, parle. Crois-moi, c’est encore ce qu’on a trouvé de mieux pour se faire comprendre ».
Daniel Pennac, j’aime toujours autant !
BBLR
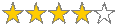
 votre commentaire
votre commentaire
-
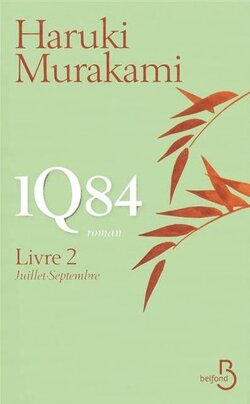
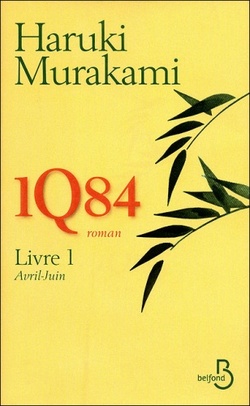 La référence à 1984 de George Orwell est évidente pour expliquer le titre de ce roman. En 3 tomes d’un peu plus de 500 pages chacun, Murakami nous campe une histoire d’amour (impossible ?) entre les deux protagonistes. Tous deux ont 30 ans en cette année 1984 et vivent à Tokyo. Elle, Aomamé, est une belle jeune femme professeur de gymnastique dans un club de sport plutôt select. Lui, Tengo, est professeur de math et romancier à ses heures.
La référence à 1984 de George Orwell est évidente pour expliquer le titre de ce roman. En 3 tomes d’un peu plus de 500 pages chacun, Murakami nous campe une histoire d’amour (impossible ?) entre les deux protagonistes. Tous deux ont 30 ans en cette année 1984 et vivent à Tokyo. Elle, Aomamé, est une belle jeune femme professeur de gymnastique dans un club de sport plutôt select. Lui, Tengo, est professeur de math et romancier à ses heures.Ils ne se connaissent pas… ou plutôt si, ils se sont croisés à l’âge de 10 ans sur les bancs de l’école. Elle suivait alors souvent sa mère, fervente adepte d’une secte, les Précurseurs, lors de ses portes-à-portes consacrés au prosélytisme. Lui suivait alors souvent son père, collecteur de redevance de la NHK (qui gère les radios et télévisions publiques japonaises) lors de ses portes-à-portes impitoyables pour débusquer les contrevenants.
Aomamé pénètre par hasard (peut-être pas ?) dans un monde parallèle qui se déroule pendant l’année 1Q84 (Q et 9 se prononcent de la même façon en japonais). Il y brille deux lunes. Une mission lui est allouée : éliminer le gourou de la secte des Précurseurs. Sa mission accomplie, Aomamé devra se terrer dans un appartement en lisant Proust.
Tengo se voit confier la mission de réécrire le livre de la très jeune Ériko Fukaéri, La chrysalide le l’air, qui décrit un monde où il est question de « Little people », de DAUGHTER/MOTHER, de PERCEIVER/RECEIVER. Ce livre écrit par une ancienne adepte de la secte devient un best-seller. Sa mission accomplie, Tengo devra essayer de renouer des liens avec son père dans la Ville des Chats.
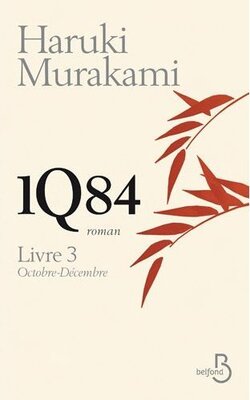
Entre ces deux protagonistes, un troisième personnage, le disgracieux mais ingénieux Ushigawa, tente de retrouver l’un en suivant l’autre. Aomamé et Tengo mènent leurs histoires en parallèle. Et pourtant leur seul désir profond n’est-il pas de se trouver ? Ce pourrait être la seule possibilité de se retrouver dans le monde réel. « Chacun de nous a nommé ce monde avec des mots différents. Moi, je l’ai appelé “l’année 1Q84”, et Tengo “La Ville des Chats”. Ces termes désignent cependant une même réalité. »
L’écriture de Murakami est fluide, souvent charnelle, toujours imagée, et les comparaisons et les métaphores sont omniprésentes, souvent inattendues voire insolites (« Autour d’eux, la ville nocturne s’écoulait comme un courant marin coloré par des protozoaires luminescents »). Un problème de taille sur ce triptyque : pourquoi 3 tomes là où un seul aurait été suffisant, en évitant parfois la dilution ? Et un bémol sur le fond : je suis moins transporté par ce livre que par le parcours initiatique décrit dans une œuvre puissante comme Kafka sur le rivage.
GLR
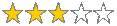
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Ô temps, suspends ton vol… Oui le temps paraît suspendu lorsqu’à la libération du camp d’Auschwitz Primo Lévi se trouve embarqué par l’Armée Rouge dans un voyage parfois surréaliste sur les routes d’Europe centrale, ponctué de brusques avancées puis de longs arrêts inexpliqués. La Trêve est ce parcours transitoire et presque initiatique entre l’indicible du camp et le retour chez soi, le difficile retour à la vie après que l’anormal soit devenu la normalité. Le train semble avancer vers la Roumanie, le lieu où les panneaux sont écrits dans une langue qui sent presque l’Italie, mais son parcours est erratique et il s’enfonce vers le nord de la Russie avec ce groupe mêlé de rescapés, de paysans exilés, de voleurs et de fous.
Ô temps, suspends ton vol… Oui le temps paraît suspendu lorsqu’à la libération du camp d’Auschwitz Primo Lévi se trouve embarqué par l’Armée Rouge dans un voyage parfois surréaliste sur les routes d’Europe centrale, ponctué de brusques avancées puis de longs arrêts inexpliqués. La Trêve est ce parcours transitoire et presque initiatique entre l’indicible du camp et le retour chez soi, le difficile retour à la vie après que l’anormal soit devenu la normalité. Le train semble avancer vers la Roumanie, le lieu où les panneaux sont écrits dans une langue qui sent presque l’Italie, mais son parcours est erratique et il s’enfonce vers le nord de la Russie avec ce groupe mêlé de rescapés, de paysans exilés, de voleurs et de fous.Dans ce récit picaresque et rempli d’humour, Primo Levi nous décrit à la fois une Armée Rouge soumise à la loi du hasard, à la désorganisation la plus totale, mais dont les hommes et les femmes vivent aussi dans une communauté très soudée, vibrante et vivante, remplie de soubresauts et de joie enfantine. Primo Lévi nous fait vivre la libération, la folie de ces journées de fête où les Russes se tombent dans les bras les uns des autres, embrassent toute personne rencontrée sur le chemin, alternent des spectacles plus loufoques les uns que les autres… il nous raconte aussi comment s’organise le convoi de retour en suivant un schéma extérieur à toute logique. Les Russes oublient souvent de nourrir ses occupants ou fournissent des rations alternant entre une semaine d’huile et une semaine de charcuterie surabondante… C’est la pagaille ! Mais ce livre nous offre une joyeuse pagaille… un moment suspendu de réapprentissage de la vie dans un monde en ruine rempli de rencontres improbables.
Improbable cette rencontre avec un Grec haut en couleurs. Et tout aussi improbable de se retrouver à discuter avec un prêtre polonais dans la seule langue qui leur permette de se comprendre : le latin. Lorsqu’avec son ami italien il se retrouve à imiter la poule qu’il convoite devant des villageois russes incrédules, en grattant le sol, en caquetant dans un caquètement qui semble visiblement éloigné de celui des poules russes tant l’incompréhension demeure entre Russes et Italiens… tous ces moments magnifiquement décrits avec un humour tendre par Primo Lévi marquent ce temps suspendu. Mais ce temps est une parenthèse… le retour n’est pas facile lorsque Primo Lévi dit en traversant l’Autriche qui le rapproche de son pays, « je sentais le numéro tatoué sur mon bras crier comme une plaie ». Primo Lévi revient à la réalité, mais qu’est devenue sa réalité quand réapparaît ce rêve interminable à intervalles plus ou moins rapprochés ?
« C’est un rêve à l’intérieur d’un autre rêve, et si ses détails varient, son fond est toujours le même. (…) Le rêve intérieur, le rêve de paix est fini, et dans le rêve extérieur, qui se poursuit et me glace, j’entends résonner une voix que je connais bien. Elle ne prononce qu’un mot, un seul, sans rien d’autoritaire, un mot bref et bas ; l’ordre qui accompagnait l’aube à Auschwitz, un mot étranger et redouté : debout, « Wstawać »
Vers quelle réalité revient celui qui a traversé l’innommable ? La Trêve avant le retour reste cette magnifique traversée, témoignage, naufrage et passage. Embarquez-vous sans hésiter !
BBLR
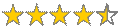
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Oskar est un petit garçon extrêmement curieux de tout et incroyablement imaginatif. Il est ouvert à la vie et au monde passionnant qui l’entoure. Il doit surmonter la mort de son père survenu le pire jour dans l’une des tours jumelles. Un père si proche de son fils, si intelligent et intuitif dans ses rapports avec ce fils qu’il semble impossible de combler cette disparition. Mais il n’y a pas disparition d’un être tellement présent dans le cœur et l’esprit.
Oskar est un petit garçon extrêmement curieux de tout et incroyablement imaginatif. Il est ouvert à la vie et au monde passionnant qui l’entoure. Il doit surmonter la mort de son père survenu le pire jour dans l’une des tours jumelles. Un père si proche de son fils, si intelligent et intuitif dans ses rapports avec ce fils qu’il semble impossible de combler cette disparition. Mais il n’y a pas disparition d’un être tellement présent dans le cœur et l’esprit.Oskar ce lance dans une quête pour comprendre le message que lui a laissé son père, une quête régénératrice qui l’oblige à dépasser ses peurs, à aller vers l’autre et l’inconnu, à retrouver ses proches. Pour Oskar, « la vie est une difficulté insurmontable ». Oskar n’est pas le seul à chercher ou à se chercher : un grand-père et une grand-mère, chacun de leur coté, doivent revenir sur leur passé pour comprendre et faire comprendre leur présent, offrant en présent à l’enfant leur amour. L’un est persuadé qu’« on ne peut rien aimer plus qu’on aime ce qui nous manque » et avoue « J’ai si peur de perdre ce que j’aime que je refuse d’aimer quoi que ce soit » ; l’autre se demande « pourquoi quiconque s’avise-t-il de faire l’amour » et constate « J’ai perdu quelque chose que je n’ai jamais eu ».
Chacun des trois personnages montrent leur personnalité à travers la forme matérielle que prend l’écriture, faisant de ce livre un jeu de miroir pour comprendre ces êtres. Oskar a le franc parler d’un enfant plein de pensées mais sans arrière-pensées et toujours attentif aux autres, plein d’humour, volontaire ou non, dans son observation du monde : « le truc hallucinant, c’est que j’ai lu dans National Geographic qu’il y a plus de gens vivants aujourd’hui qu’il n’en est mort dans toute l’histoire de l’humanité. Autrement dit, si tout le monde voulait jouer Hamlet en même temps, ce serait impossible, parce qu’il n’y a pas assez de crânes ! ». Oskar a une logique à toute épreuve qui attendrit ses interlocuteurs : « Les humains sont le seul animal qui rougit, qui rit, qui a une religion, qui fait la guerre et qui embrasse avec les lèvres. Alors en un sens, plus on embrasse avec les lèvres, plus on est humain ».
GLR
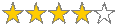
Voir aussi l’opinion sur le film de Stephen Daldry « Extrêmement fort et incroyablement près »
 votre commentaire
votre commentaire




