-
Autour d’Annie Ernaux - Janvier et mars 2012
Après avoir lu L’Autre Fille (cf. Livres), j’ai vu que la bibliothèque municipale avait plusieurs ouvrages d’Annie Ernaux dans ses rayonnages, à commencer par « La vie extérieure 1993-1999 » et le « journal du dehors » écrit de 1985 à 1992. J’ai alors découvert qu’Annie Ernaux décrivait la ville de banlieue que je côtoie tous les jours. Et c’était un plaisir de lire ses parcours, ses visions de MA ville, des impressions similaires, une histoire même plus ancienne que celle de mon arrivée dans cette cité qui ne cesse de sortir et de ressortir de terre. Apparemment, en discutant autour de moi, tout le monde savait qu’Annie Ernaux vivait depuis plus de vingt ans dans la ville toujours nouvelle pour moi, sauf moi.
Au-delà même de la proximité du journal, j’ai aimé son regard sur l’extérieur, depuis les inscriptions du RER jusqu’aux propos dans les files d’attente du supermarché des 3 Fontaines… Celle qui disait qu’elle ne voyait sa jeunesse que dans les livres, que tout pour elle était littérature me semblait voir tant de choses. On pouvait même deviner son regard en train de regarder.
La découvrant à rebours d’elle-même, j’ai voulu connaître autre chose que la quotidienneté de ce regard aigu sur ce qui l’entoure. Et La place du père, d’une génération et d’une classe a suivi, avant les souvenirs de Les années photographiés, et L’évènement marquant pour une jeune femme dans la période précédant la légalisation de l’avortement… J’ai désiré lire plus, peut-être même tout, et dans une librairie j’ai vu les grands yeux, les cheveux en cascade, le demi-sourire de la jeune fille qui posait. Elle me disait : « tu me cherchais ? ». De grandes lettres noires annonçaient « Écrire la vie » et au-dessus en rouge Annie ERNAUX. L’édition Quarto Gallimard a regroupé dans un même volume, vous savez cette collection avec des feuilles très fines et douces, une très grande partie des textes d’Annie Ernaux, ainsi qu’un complément d’une quarantaine de pages de son journal et de photos qui accompagnent ses mots et manifestent des conditions de la construction de son écriture.
Écrire la vie, c’est peut-être ça. Ce n’est pas Écrire SA vie mais la vie à un moment de l’histoire, la vie enveloppée de son identité, de son éducation, de son corps et des autres. Comme l’écrit l’auteur sur la première page de cet ouvrage : « j’ai toujours écrit à la fois de moi et hors de moi, le « je » qui circule de livre en livre n’est pas assignable à une identité fixe et sa voix est traversée par les autres voix, parentales, sociales, qui nous habitent (….). »
C’est donc à un tour d’horizon des écrits d’Annie Ernaux que je vous convie sur cette page.
Et pour cela, partons de l’extérieur par cercles concentriques.
Commençons alors par Journal du dehors tenu de 1985 à 1992 et La vie extérieure, 1993-1999.
Journal du regard sur l’extérieur,
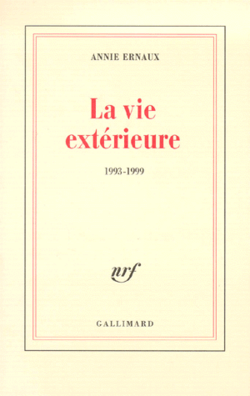
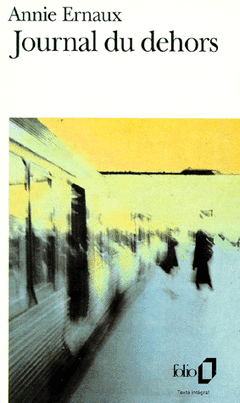 sur le monde dehors. D’abord dans un lieu, une ville de banlieue en chantier. La ville est toute jeune lorsqu’Annie Ernaux s’y installe. Elle est née des champs. Elle s’est construite de bric et de broc, de tout ce qu’on a appelé modernité à un instant donné. Des trajets et une vie pensés à travers l’automobile. Un temple de la consommation rassemblant tous les désirs d’achats en un même lieu couvert, chauffé, idéal… Mais cette ville est aussi champ, étangs, rivière, parcours et horizons ouverts. Cette ville, il faut laisser Annie Ernaux la parcourir. Espace et habitudes. Et ce n’est que plus de vingt ans après son arrivée qu’elle le fait, un jour d’armistice entre cette ville « nouvelle » et le temps :
sur le monde dehors. D’abord dans un lieu, une ville de banlieue en chantier. La ville est toute jeune lorsqu’Annie Ernaux s’y installe. Elle est née des champs. Elle s’est construite de bric et de broc, de tout ce qu’on a appelé modernité à un instant donné. Des trajets et une vie pensés à travers l’automobile. Un temple de la consommation rassemblant tous les désirs d’achats en un même lieu couvert, chauffé, idéal… Mais cette ville est aussi champ, étangs, rivière, parcours et horizons ouverts. Cette ville, il faut laisser Annie Ernaux la parcourir. Espace et habitudes. Et ce n’est que plus de vingt ans après son arrivée qu’elle le fait, un jour d’armistice entre cette ville « nouvelle » et le temps :« 1997. 11 novembre. Silence absolu, là où je me trouve en ce moment, ma maison, point dans l’espace indéterminé de la ville nouvelle. Expérience : parcourir par la mémoire le territoire qui m’entoure, décrire et délimiter ainsi l’étendue de l’espace réel et imaginaire qui est le mien dans la ville.
Je descends jusqu’à l’Oise –voici la maison Gérard Philipe-, la traverse, survole la base de loisirs de Neuville, reviens sur port-Cergy, file vers l’Essec, les quartiers des Touleuses et des Maradas, passe le pont d’Éragny –je suis dans le complexe Art de Vivre– revenant par l’autoroute A15, bifurquant à travers champs pour atteindre Saint-Ouen-l’Aumône, le cinéma Utopia et l’abbaye de Maubuisson. Je survole Pontoise en tous sens, pousse jusqu’à Auvers-sur-Oise, monte la côte de l’église, vers le cimetière, la tombe de Van Gogh sous le lierre. Je reviens par la même route le long de l’Oise, brève incursion à Osny.J’entame les grandes avenues menant au centre de Cergy-Préfecture : les Trois-Fontaines, la tour Bleue, le théâtre, le conservatoire et la bibliothèque. Je suis la ligne du RER et la chevauchée de pylônes jusqu’à Cergy Saint-Christophe, la grande horloge de la gare. Je me promène dans la rue qui conduit à la tour Belvédère et aux colonnes de l’esplanade de la Paix, d’où se dévoile un immense horizon, avec en fond, les ombres de la Défense et de la Tour Eiffel. Pour la première fois, j’ai pris possession de l’espace que je parcours pourtant depuis vingt ans. » (La vie extérieure, p. 86-88).
Dans ces journaux « non intimes », Annie Ernaux essaye de capter l’esprit du dehors, de la ville nouvelle anonyme et cosmopolite. Une ville où tout le monde vient d’ailleurs. Une ville du mouvement, de la foule Saisie des lieux de connexion, dans les gares et les RER, dans les supermarchés de l’immense centre commercial 3F où les jeunes se donnent rendez-vous. Annie Ernaux a souhaité n’être qu’un regard, se rétracter pour voir, ne pas dire « je ». Mais elle reste présente parce que son regard saisit les situations à merveille. Comme les rapports entre les caissières et les clientes :
« 1994. 15 novembre. Les caissières d’Auchan disent bonjour au moment exact où, ayant donné au client d’avant son ticket de caisse, elles empoignent votre premier article sur le tapis roulant. On a beau se trouver dans leur champ de vision, juste en face d’elles, depuis parfois plus de cinq minutes, c’est seulement à ce moment où elles commencent d’enregistrer vos courses qu’elles semblent vous découvrir. Cette étrange et rituelle cécité révèle qu’elles ne font qu’obéir à une consigne de politesse obligatoire. Au regard du marketing, nous existons seulement dans le moment où s’échangent des paquets de lessive et des yaourts contre de l’argent. » (La vie extérieure, p. 46-47).
Son regard relié agrippe aussi les humiliations et les restitue en mots, comme la honte infligée à une caissière devant la foule des clients :
« 1986. Samedi, à super M, la caissière est âgée – par rapport aux autres, qui ont moins de vingt-cinq ans – et lente. La cliente, quarantaine, simplicité recherchée, lunettes fines, demande une rectification : son ticket de caisse n’est pas juste. Il faut appeler une surveillante qui, seule, pourra faire enregistrer l’erreur et la modification de l’erreur par la machine. C’est fait. La surveillante s’en va. La caissière passe à une autre cliente. La petite femme à lunettes, qui était toujours là, en train de revérifier son compte, interpelle à nouveau la caissière : « il y a encore quelque chose qui ne va pas. » La caissière abandonne la cliente qu’elle était en train d’enregistrer. Nouvelles explications de la petite femme qui montre à la caissière son ticket. Celle-ci le prend et le regarde, sans comprendre. Elle ré-appelle la surveillante. La petite femme déballe toutes les marchandises contenues dans son caddie, la surveillante pointe au fur et à mesure tandis que la caissière reprend sa cliente en cours. L’opération de déballage et de pointage terminée, la surveillante se tourne vers la caissière en lui mettant le ticket sous le visage : « Sur le ticket de la dame, il y a 57 F. Aucun produit ne correspond à 57 F. D’autre part quatre piles de transistor à 17F ne sont pas tapées. » La caissière ne dit rien. La surveillante recommence : « Vous voyez bien qu’il y a une erreur. Cinquante francs. » La caissière ne regarde pas la surveillante. Elle est grise, grande et plate, ses mains qui ont quitté la machine enregistreuse pendent le long du corps. La surveillante insiste : « Vous voyez bien tout de même ! » Tous les clients qui font la queue entendent. Un peu plus loin, la petite femme attend son dû, sans expression sous ses cheveux bien coiffés. Face à la puissance anonyme de Super-M, elle se dresse comme la consommatrice sûre de son droit. La vieille caissière qui s’est remise à taper sans un mot, n’est qu’une main qui ne doit pas se tromper, ni au profit de l’un, ni au profit de l’autre. » (Journal du dehors, p. 24-25)
Annie Ernaux entend les rapports de classes sociales qu’elle ne cesse de ressentir, les instruments de domination dans le langage et les corps. Les journaux de l’extérieur sont donc aussi ce décryptage des places, des mots des politiques et des médias. Ainsi retranscrit-elle le langage politique affecté :
« 1996. 13 janvier. Les hommes politiques, et à leur suite les journalistes, disent un col’loque, un som’met, boursouflant ces mots vides pour leur donner de l’importance. Ils prononcent aussi la dernière lettre, « il faut’ » et accentuent les liaisons, « il-a-toujours-z-été ». Cette prononciation politico-médiatique ressemble à celle des instituteurs lisant une dictée à leurs élèves. Chirac, Juppé et les autres semblent vouloir éduquer le peuple, lui apprendre l’orthographe et le bon usage de la langue » (La vie extérieure, p. 64)
Un an plus tard les choses n’ont pas changé. Le discours sur l’entreprise et les vertus du libéralisme est alors à son sommet et Annie Ernaux saisit ce moment à travers les propos de son infatigable promoteur :
« 1997. 4 mars. À la radio, Alain Madelin répondait aux questions des auditeurs, lesquels disaient : Les salaires baissent, ma pension baisse, je n’ai plus de travail, Renault vient de supprimer des emplois. À chacun Madelin répondait invariablement, « il faut créer une entreprise ! ». Il faut prononcer « créï-er ! » : il faut créï-er !cré-ïer ! Sur le ton de quelqu’un s’adressant à des demeurés. Tançant triomphalement son interlocuteur : « J’entends la peur dans votre propos, monsieur ! » Il faut en effet être de la dernière couardise pour ne pas créer une entreprise quand on est au chômage, avec deux loyers de retard et une menace de saisie immobilière.
À un moment, Madelin brandit ses origines, « mon père était OS, je connais les feuilles de paie ». Comme s’il était le même que le petit garçon d’autrefois, dans une cité ouvrière.
Ce discours, insultant les gens et la raison, était tenu par un ancien ministre, sans que personne intervienne pour en dénoncer le mépris et l’imposture. Les auditeurs n’avaient pas la possibilité de « l’insulter » en retour – danger que le micro leur soit coupé – en lui demandant combien il gagnait, où il habitait, quelle entreprise il avait lui-même « créïée ». Une fois de plus, le média rendait légitime les propositions pourtant absurdes, d’une voix autorisée. J’avais la haine (c’est pourquoi j’écris ces lignes) ». (La vie extérieure, p. 77-78)
Peut-être les commentaires sur les affiches de publicité nous renvoient-ils davantage encore à cette période de la réussite sociale qui s’étale sans vergogne. Affirmation de la loi du plus fort, également le plus conforme aux normes d’une époque, peut-être le plus vide :
« 1989. Dans l’ordinateur individuel, une publicité. Page de droite, trois hommes et une femme. Deux hommes en costume, la femme en robe noire, sexy. Le troisième homme a le visage plus flou, porte un pantalon de velours, un pull rouge, vaguement soixante-huitard. Sous ces silhouettes, il est écrit : Nous allons vous expliquer pourquoi nous avons réussi. La page tournée, on retrouve les personnages. Le premier dit : « j’ai réussi parce que je lis L’ordinateur individuel et parce que mon père est président-directeur général ». Les deux personnages suivants utilisent le même discours d’humour cynique. Le quatrième, l’homme au pull rouge, a disparu. Celui dont l’échec était inscrit dans la tenue ringarde, l’attitude cool (les autres étaient droits, énergiques) a disparu du paysage de la réussite : néantisé, NUL. Ce mot est apparu avec le libéralisme des années quatre-vingt. Il définit le sous-homme selon ce temps. » (Journal du dehors, p. 90-91)
Ce journal est celui de deux yeux ouverts sur nos réalités dans ces années 1980-90, sur notre quotidien sensible. Mais Annie Ernaux ne peut penser hors d’elle-même, hors de la littérature. Elle s’aperçoit qu’elle « cherche toujours les signes de la littérature dans la réalité » (journal du dehors, p. 46)
Les limites de la littérature imposées par nos conventions informulées sont également tombées pour moi à la lecture de ces journaux non intimes. Oui, il est possible d’écrire sur notre quotidien sensoriel, sur ces affiches qui témoignent d’une époque, d’un état d’esprit, sur ces discours qui nous paraissent surannés, sur ce que nous respirons tous les jours sans même nous en rendre compte et qui forment notre langage et notre corps à un temps donné.
Écrire la vie
« Écrire la vie est un présent et un futur, non un passé ».
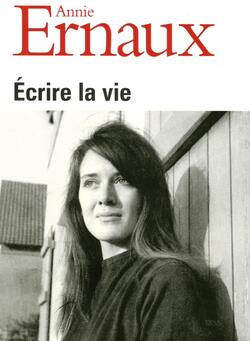 Ce sont les premiers mots d’Annie Ernaux pour introduire la somme de ses écrits rassemblés ici. Pourtant ces textes sont ceux d’un passé, d’hier ou de plus loin même. Tous ces livres et ces journaux écrits, accompagnés de photos manifestent la naissance, l’évolution d’une écriture sur la vie jusqu’au moment où elle a écrit le dernier. Surtout ce « photojournal », ce texte composite est nouveau et autre, « troué, sans clôture, porteur d’une autre vérité que ceux qui suivent ».
Ce sont les premiers mots d’Annie Ernaux pour introduire la somme de ses écrits rassemblés ici. Pourtant ces textes sont ceux d’un passé, d’hier ou de plus loin même. Tous ces livres et ces journaux écrits, accompagnés de photos manifestent la naissance, l’évolution d’une écriture sur la vie jusqu’au moment où elle a écrit le dernier. Surtout ce « photojournal », ce texte composite est nouveau et autre, « troué, sans clôture, porteur d’une autre vérité que ceux qui suivent ».Des photos, des textes du journal qui ne suivent pas l’ordre du temps, mais des réminiscences, des allers-retours entre hier et aujourd’hui. Qui n’a pas ressenti cette jubilation du monde qui s’ouvre à un certain moment de la vie, le goût du jour, l’absorption de toute les lumières et des sons, ce vertige du possible qui n’a plus jamais ensuite la même saveur : « Je pense à un autre soir de juin, le 28 juin 1961, dans un train, le soir était rose, j’étais presque seule. (…) La vie devant moi était une grande lumière, je ferais des choses extraordinaires, en littérature, bien sûr. Je n’aurais plus jamais cette sorte d’ouverture, d’espérance heureuse. Quand j’ai écrit réellement, j’ai su que c’était tout le contraire de cette allégresse (20 juin 1988) ».
Et quelques phrases pour approcher de l’écrivain Annie Ernaux. Fragments dispersés entre 1970 et 2005 ;deux pages sur son passé anglais« Tous les participants du colloque se sont jetés dans les musées, et moi à North Finchley, dans ma vie passée. Je ne suis pas culturelle, il n’y a qu’une chose qui compte pour moi, saisir la vie, le temps, comprendre et jouir (janvier 1989) ». Et toujours dans un retour sur soi à Boisgibault en 1979 « J’ai regardé des photos et ça ne m’apprend rien, c’est par la mémoire et l’écriture que je retrouve, les photos disent à quoi je ressemblais, non ce que je pensais, elles disent ce que j’étais pour les autres, rien de plus ».
« Je ne suis pas sortie de ma nuit »
Et puis il y a … « je ne suis pas sortie de ma nuit », l
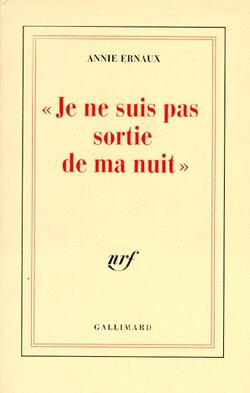 a dernière phrase écrite par sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer… Annie Ernaux raconte au jour le jour sa relation avec sa mère qui se trouve dans une maison de retraite, avec cette maladie, jusqu’à la mort.
a dernière phrase écrite par sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer… Annie Ernaux raconte au jour le jour sa relation avec sa mère qui se trouve dans une maison de retraite, avec cette maladie, jusqu’à la mort.Non pas un témoignage sur les conditions de vie dans un « long séjour » mais un rapport quotidien avec une mère qui garde longtemps la mémoire de sa fille, qui revient aux obsessions de sa jeunesse, qui part petit à petit. Dans son écriture concise et attentive, Annie Ernaux saisit ces instants d’affaiblissement des corps et des esprits. Elle rappelle, au-delà de l’apparence, de l’horreur, la profonde humanité du vieillissement que nous essayons tant d’écarter de nos vies… Un bref passage : « avril, samedi 14. Elle mange la tarte aux fraises que je lui ai apportée, en piquant les fruits au milieu de la crème. “Ici, je ne suis pas considérée, on me fait travailler comme une négresse, on est mal nourris.” Ses obsessions, la peur des pauvres que j’ai oubliée. En face de nous, une femme décharnée, spectre de Buchenwald, est assise, très droite, avec des yeux terribles. Elle relève sa chemise, on voit la couche-culotte appliquée sur son sexe. Les mêmes scènes à la télé font horreur. Pas ici. Ce n’est pas l’horreur. Ce sont des femmes ».
Sa mère lui a appris l’orgueil et le refus d’être humiliée, elle était aussi son confesseur, emplie des conventions, des devoirs, de la religion, du poids d’une classe sociale marquée par la valeur de l’effort, du refus de prendre en compte son propre corps. Pas assez de distance entre cette fille et sa mère, « de l’identification », des regards respectifs trop proches, des mondes trop loin et incompris, de la peur. « octobre, dimanche 28. (…) Images de moi, à seize ans : les garçons, l’espérance de l’amour fou, continuelle. Et puis, elle, “garde-folle” : “Tu es trop jeune ! Tu as bien le temps !” On n’a jamais le temps ». Capture des mots surprenants, un peu fous… des mots qui comprennent, qui suivent au-delà du délitement du cerveau, la pensée et la vie des êtres aimés. L’éloignement de la raison rapproche par certains moments de l’essentiel, de la complicité et de la joie simple d’Être … les instants de grâce, d’éloignement des peurs :
« novembre, dimanche 17. La vieille de la chambre de ma mère était assise près d’elle. Tableau très doux d’une connivence secrète, parfaite entre elles. L’étonnante lumière d’une scène biblique d’un peintre du Quattrocento. Une joie d’essence indicible. Ma mère dit à la femme en me montrant : “La reconnais-tu ?” La femme bafouille à son habitude, depuis longtemps elle ne s’exprime plus clairement. Cela n’a pas d’importance, qu’elles se comprennent en paroles ou non. Je me suis assise en face d’elles, j’ai donné à manger un éclair à ma mère – l’autre femme n’en voulait pas -, puis un autre. (…) Je lui lave la bouche avec un gant de toilette. Elle me regarde et me demande : “Est-ce que tu es heureuse ?” »
BBLR
