-
L’article suivant paraît dans La presse de Gray datée du 17 janvier 1970.
Les rues de la ville. Qui est-ce ? Moïse LÉVY (coupure de presse)

Les illustres personnalités grayloises dont on a donné le nom à certaines rues de la ville (Louis Jobard, Augustin Cournot, Moïse Lévy, etc) sont en général peu connues, principalement chez les jeunes.
A leur intention nous publions dans les colonnes de « La Presse de Gray » sous la rubrique « Qui est-ce ? » un portrait-flash sur chacune de ces personnalités.
Aujourd’hui : Moïse Lévy.
Moïse LEVY, né à Gray le 12 avril 1863, décède à Paris le 24 février 1944, Conseiller municipal de Gray depuis 1892, il fut élu Maire en 1912, Conseiller général en 1920, Vice-Président au Conseil Général de la Haute-Saône, Sénateur de la Haute-Saône en 1935.
Il avait, dès cette époque, pressenti l’évolution de la société agricole vers la Société industrielle moderne, la nécessité de l’entraide sociale, l’importance du tourisme.
Son action tendit à créer à Gray des activités et des bases destinées à faciliter la mutation économique et sociale de la ville au cours de ce XXme siècle.
INDUSTRIE :
Il amena dans l’actuel district de Gray plusieurs industries dont certaines existent encore, le Tissage Sauvegrain, l’I.R.C.B., les Usines Gouvy sur les terrains desquelles sont installés les Etablissements Mischler et Coste, la Centrale électrique reprise par Electricité de France.
ŒUVRES SOCIALES :
Le Refuge Maternel de l’Est, sa Pouponnière et sa Maison d’enfants fut l’œuvre à laquelle il attacha son nom ; l’Hôpital de Gray l’a reprise en 1961 ; et, sur une partie de son parc, une école maternelle est en cours de construction. Le dispensaire anti-tuberculeux vit le jour sous ses auspices ; il développa l’Hôpital de Gray et l’Hospice de Vieillards Cournot-Changey, dont il fut l’un des fondateurs.
TOURISME :
Il fut le premier Président du Syndicat d’Initiative de Gray et l’un des fondateurs de la Fédération des Syndicats d’Initiative de Franche-Comté et des Monts-Jura.
Il créa la plage de Gray, développée et modernisée par ses successeurs.
oOo
Il laissa à sa ville natale la marque de son travail et le souvenir de l’amour qu’il lui portait. Il ne l’abandonna jamais, même aux tristes heures de juin 1940, lors de la prise de la ville par les troupes Allemandes. Son attitude à cette époque fut, en tous points, exemplaire.
Le 15 juin vers 6 heures du matin il fut appelé par le colonel allemand, place du 4-Septembre et y reçut l’envahisseur.
Le 16 juin, alors que les Allemands avaient interdit aux pompiers de Gray de continuer à lutter contre le feu sous prétexte que l’on manquait d’eau, M. Lévy, sous sa responsabilité, donna au Capitaine Pélot, commandant les Sapeurs - Pompiers, l’ordre écrit de continuer à éteindre les incendies que les obus incendiaires avaient provoqués partout.
Chassé de toutes ses fonctions d’ordre des Allemands qui jugeaient absolument indésirable sa présence dans la ville et la région qui l’avaient élu maire et sénateur, puis expulsé de sa maison, après un séjour, 18 rue des Casernes à Gray, il regagna son appartement parisien rue Daubigny.
Il y resta sans interruption jusqu’à son décès en 1944, dans sa 81me année quelques mois avant la Libération, et après que la Gestapo fut venue le chercher par deux fois et eut renoncé à son arrestation en raison de son état de santé.
oOo
(La rue Moïse Lévy, anciennement rue du Magasin à fourrages, relie la place des Tilleuls au carrefour Ste-Anne).
 1 commentaire
1 commentaire
-
Hervé Maurey, arrière-petit fils de Moïse Lévy, écrit dans La presse de Gray daté du 19 septembre 1980 l’article suivant. Hervé Maurey deviendra sénateur de l’Eure en 2008.
Un graylois illustre MOÏSE-LEVY (1863-1944) (coupure de presse)

- Ancien Maire de Gray (1912-1940)
- Ancien Conseiller Général de Gray (1919-1940)
- Ancien Sénateur de la Haute-Saône (1935-1940)
Il y a 40 ans Monsieur Moïse Lévy destitué de ses fonctions et expulsé de chez lui par les allemands se voyait contraint de quitter sa ville natale pour Paris où Il devait y mourir. Les plus anciens graylois se souviennent encore, non sans émotion, de celui qui fût leur élu pendant près de 50 ans. Mais les plus jeunes ? Moïse Lévy n'est bien souvent pour eux qu'un nom de rue ou de groupe scolaire. C'est pourquoi il est bon de rappeler la vie d'un des personnages les plus marquants de notre histoire contemporaine.
Né le 12 avril 1863, Moïse Lévy est dès 1894, à l'âge de 31 ans, élu Conseiller Municipal de sa ville natale. En 1912 à la veille de la guerre il est élu Maire de Gray et le restera, avec seulement une brève interruption, jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Lorsque la guerre de 1914 éclate le Maire de Gray rejoint le 52° Territorial d'Infanterie dans les Vosges. Démobilisé pour raison de santé et nommé Lieutenant Honoraire d'infanterie il regagne alors sa ville.
Grâce a lui, Gray. bien que située dans la zone des armées, sera régulièrement ravitaillée. C'est ainsi qu'avec le matériel agricole de la ville. il assure la récolte non seulement des terres de la commune mais aussi de celles des mobilisés afin qu'aucune récolte ne soit perdue.
En même temps il s'efforce dès cette époque d'assurer la modernisation de l'économie grayloise par l'implantation d'industries. Sous son impulsion s'installent à Gray les tissages Sauvegrain. L'I.R.C.B., les usines Gouvy ainsi qu'une centrale électrique que reprendra l'E.D.F.
Le cadre de vie n'en fût pas pour autant délaissé, Moïse Lévy disait de sa ville natale: « Gray la Jolie », et s'employait à ce qu'elle soit telle. Il fit restaurer le magnifique toit de l'Hôtel de Ville de Gray et le théâtre. Le musée Baron-Martin reçut une impulsion nouvelle, son installation fût parfaite et ses collections enrichies par les nombreux dons qu'il obtint, dont celui de son ami Pigalle à qui l’on doit la remarquable collection de Prud’hon. D'un point de vue plus touristique, il convient de rappeler que c'est lui qui créa la plage de Gray ainsi que le Syndicat d'initiative de Gray dont il fût le premier président. Il fût, en outre l'un des fondateurs de la Fédération des Syndicats d'initiative de Franche-Comté et des Monts-Jura.
Mais là où son action fût sans aucun doute la plus remarquable, c'est sur le plan social. Moïse Lévy estimait, en effet, que la solidarité sociale devait dépasser celle prévue par la loi. C'est ainsi que toute sa vie il vint en aide à ceux qui en avaient besoin. S'il est impossible de citer tous les secours individuels qu'il fournit, toutes les pensions et toutes les aides qu'il versa, il convient tout du moins de rappeler les principales œuvres sociales dont il fût le fondateur.
Ainsi à une époque où les filles-mères étaient nombreuses et rejetées par la société, il fonde sur un terrain lui appartenant, le Refuge Maternel de l’Est, lequel doté d'une importante pouponnière recueille les mères et les enfants, luttant ainsi contre les abandons d'enfants et la mortalité infantile.
Il crée grâce à des subventions personnelles des cantines scolaires gratuites et un bureau d'aide aux enfants issus de familles dans le besoin afin que ceux-ci puissent aller à l'école.
Enfin il fonde le dispensaire anti-tuberculeux et participe à la création de l'Asile Coumot-Changey dont il sera l'administrateur.
Ces 50 années de dévouement lui valent d'être fait Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Instruction Publique et Commandeur du Mérite Social.
A sa tâche de Maire viendra s'ajouter dès 1919 celle de Conseiller Général du canton de Gray, puis en 1931 celle de Vice-Président du Conseil Général de la Haute-Saône.
Enfin en 1935, avec André MAROSELLI et le président du Sénat Jules JEANNENEY comme colistier, Moïse Lévy est élu Sénateur de la Haute-Saône. Désormais parlementaire, il dépose de nombreuses propositions qui deviendront des lois, portant ainsi au plan national l'action menée jusque là au niveau local.
En 1940, lorsque survient le deuxième conflit mondial, cet homme de près de 80 ans se partage avec une vitalité étonnante entre le Sénat, le Conseil Général, la mairie de Gray et les Oeuvres Sociales dont il est Président.
Le 15 juin les allemands entrent dans Gray. Resté à son poste Monsieur Moïse Lévy qui n'avait que 7 ans lorsque les prussiens envahirent Gray en 1870, a cette fois le triste devoir de recevoir l'occupant.
Vers 21 h. 30, le Général allemand convoque Monsieur Lévy place du 4-Septembre, « Vous youde » demande-t-il, question à laquelle le Maire de Gray répond par l'affirmative. Ainsi commencent les difficiles rapports du Sénateur-Maire avec l'occupant, lesquels ne feront que se dégrader.
Le 17 juin, le feu qui sévit depuis la veille atteint l'église. Les pompiers commencent à lutter contre l'incendie lorsqu'un sous-officier allemand donne l'ordre de cesser d'arroser sous prétexte qu'il manque de l'eau à l'hôpital. Ayant constaté qu'il n'en est rien, Monsieur Lévy tire une carte de visite de sa poche et écrit : « Moïse Lévy donne l'ordre, sous sa responsabilité personnelle, de continuer à lutter contre l'incendie ».
Les allemands s’inclinèrent mais jugèrent dès cet instant sa présence indésirable à la tête de la ville dont il était l'élu depuis 1894.
Le 20 juillet 1940 sur ordre des allemands, le Préfet de la Haute-Saône le relève de ses fonctions. Quelques jours plus tard les allemands lui donnent l'ordre de quitter sa maison en y laissant le mobilier, le linge et la vaisselle.
Chassé de ses fonctions et de sa maison à 77 ans, il reste cependant à Gray jusqu'au mois d'octobre. Il part ensuite pour Paris où la gestapo viendra à plusieurs reprises le chercher mais devra y renoncer en raison de l'état de santé dans lequel l'ont plongé tant d'épreuves, la dernière étant la déportation du plus jeune de ses fils.
Il meurt à Paris le 24 février 1944. Selon ses dernières volontés et dès que les circonstances le permirent, son corps fût ramené à Gray, la ville où il naquit, la ville à laquelle il consacra sa vie mais où il ne pût même pas mourir.
Hervé MAUREY
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les maires de Gray ont été décrits par Lucien LA RUCHE en 1965. Il dépeint essentiellement le portrait de son père, le sénateur-maire Moïse LÉVY.
L’exemplaire numéro 5 est dédié à son fils Francis et l’exemplaire numéro 10 à sa femme Germaine qu’il surnommait Cricri.
CONTRIBUTION à L'HISTOIRE de GRAY

(déposé à la Bibliothèque Municipale de Gray)
SILHOUETTES de MAIRES de GRAY
1900 - 1940
vues par Lucien LA RUCHE
tiré en 12 exemplaires n°s de 1 à 12
1965
Vous trouverez ici des souvenirs, jetés sur le papier de mémoire, sans documents (1). Si vous leur accordez un quelconque mérite, ils le doivent au recul du temps, qui apporte détachement et impartialité.
Il y avait vers 1900 à Gray deux partis politiques ou deux tendances d'esprit : réformiste et réactionnaire, d'à peu près égale force. Entre eux, les indépendants qui n'étaient inféodés à personne et qui en somme faisaient la majorité ; selon leur vote, ils apportaient la décision. Dans les élections, il fallait "mettre la main sur le flottant", dixit Couyba qui était un maître-manœuvrier.
Le Docteur Maurice SIGNARD était le type du républicain sincère, d'aspect un peu sévère. Foncièrement honnête et loyal.
Par doctrine, il voulait le développement de l'instruction publique. Sur le plan local, il fut aidé par an ami de toujours, Moïse LEVY, qui négocia pour la Ville, l'achat de la propriété Watelet où fut créée l'Ecole Supérieure de filles, ainsi que l'acquisition du Château où fut installé le Musée. Les adversaires de Moïse Lévy ne manquaient pas d'insinuer qu'il y avait un intérêt ; or, Moïse Lévy ne tira jamais profit d’aucune opération avec une quelconque administration. Les mêmes, dans leurs polémiques, traitaient Signard de Sectaire ; et Moïse Lévy le défendit vigoureusement dans des articles signés Biaise des Perrières.
A la mort de Signard, Couyba, sénateur, considéra l’arrondissement de Gray comme son fief. L'administration préfectorale était à sa dévotion. Les comités qu’il formait étaient composés d’amis manquant d’envergure, mais tout dévoués à sa personne. Charles Couyba était .un poète délicat et un chansonnier de talent ("Manon, voici le soleil…", sous le pseudonyme de Boukay) ; ses vers étaient mis en valeur par une musique charmante de Paul Delmet. Ayant le goût du théâtre et de la mise en scène, il voulut dans la politique locale jouer au dictateur : les "comitards" choisissaient les candidats aux élections, même aux élections consulaires.
C'est ainsi que Fernand RAGALLY devint maire de Gray. Ragally, qui était député, avait un abord franc, mains tendues, prêt à trinquer et à transmettre les sollicitations au grand patron. La formule de l’époque était : le "droit" pour tous et les faveurs pour les amis ; souvent les régimes changent, les méthodes restent et les systèmes ne varient guère.
Les électeurs moyens se reconnaissaient en lui et il pouvait sincèrement leur dire : "en votant pour moi, vous votez pour vous". Aimé à la campagne, où il y était bien connu de par sa profession de vétérinaire, il y était plus suivi qu'en ville. Il n’a jamais posé pour un maître d'éloquence ; à une réunion au théâtre, où Couyba n'arrivait pas à se faire entendre, Ragally reprenait son leit-motiv : "tout un chacun il faut qu'il puisse parler” ; et Couyba de hurler : "je ferai votre bonheur malgré vous”. But honorable, mais combien difficile à atteindre.
Comme maire de Gray, Ragally fit ce que faisaient alors les maires des petites villes avec les subventions de l'Etat : un hôtel des Postes et un nouvel abattoir.
Le règne de “la coterie”, comme on disait aimablement alors, ne pouvait s'éterniser. Couyba c'était fait nommer Conseiller général de Gray ; il avait demandé à son ami Fernand de faire l'échange de son canton rural contre celui de Gray ; mais Ragally n'accepta pas : il repoussa vertueusement son offre, ne voulant pas lâcher le sûr pour l'incertain.
Moïse Lévy, alors évincé du conseil municipal, fut poussé à l'action notamment par Drouot, avocat de talent qui cherchait la bagarre pour gagner un siège au Parlement (2). Moïse Lévy décida de se présenter au Conseil Général de Gray contre Couyba. Il faillit le battre. Du moins, les résultats des élections de la Ville de Gray lui donnèrent des espoirs pour les élections municipales. Il constitua une liste d'union des intérêts Graylois : c'est ainsi qu'avant 1914, il fit passer une majorité de sa liste et devint maire de Gray.
Moïse Lévy resta maire jusqu'à la seconde guerre mondiale avec quelques éclipses dues à des haines partisanes, et à des coalitions de toutes nuances. Les passions et les ambitions politiques n'ont rien à faire avec le bien public. De même, au conseil général où il avait été élu.aprés la guerre, il connut la disgrâce pendant un mandat, ayant été battu par le docteur Jacquot : il dut "en avaler des couleuvres” !
Il y a eu donc deux maires de Gray "de passage" occasionnels ou épisodiques, si vous le préférez.
FAIVRE, directeur de l'Ecole communale, a laissé la réputation d’un homme probe et honnête.
Couyba avait abandonné l’enseignement pour la carrière politique ; un ancien directeur d'Ecole, Philippe avait bien tenté de se jeter dans la politique. Et pourquoi cas moi, pouvait-il se dire ? Ses adversaires (qui n'en a pas ?) l’appelaient le mandarin, parce qu'il était fonctionnaire, entouré de fonctionnaires, soutenu par des fonctionnaires. Mais diriger correctement une école ne donne pas nécessairement les qualités de dynamisme qui sont nécessaires pour réveiller une ville endormie dans les souvenirs de son passé.
CHATEAU, était un homme d'aspect pacifique et s'occupait de sociétés locales, notamment de musique. Il menait ses propres affaires, avec difficultés et rien ne le prédisposait à la conduite des affaires publiques. Effacé, il n'avait pas de grands desseins.
Avant, pendant et après la guerre de 1914, MOISE LEVY, maire de Gray voulait être équitable avec tous ses concitoyens, qu’elle que soit leur opinion. Il avait comme amis, aussi bien un ouvrier socialiste comme le fontainier de la Ville Tholy que le curé de Gray Louvot, d'un libéralisme éclairé ; il eut des fidèles comme Brocard, Butaud, le docteur Brusset, Jules Pichat et bien d'autres.
Pour lui, être maire, c'était être le premier serviteur de la cité et en même temps, un animateur. Il eut des collaborateurs actifs : comme adjoints Georges Bresard, d'une vieille famille Grayloise (3) et Louis Cardon, qui s‘était fait lui-même ; comme agents voyers, Claude Pavet, puis Claudon ; comme secrétaires de mairie : Collot puis Benoit. A la Caisse d'Epargne : Coudry. Au refuge : Mme Pralon.
Il disait "Gray La Jolie" et il la voulait telle. Il veillait à la propreté des bâtiments et des rues (le toit de l'Hôtel de Ville fut restauré et le théâtre rénové) ; une plage sur la Saône fut aménagée ; et il voulait apporter à sa ville natale des éléments de prospérité.
La question de l’enseignement, de son développement se posait toujours à l'époque. Ce problème intéressait particulièrement Moïse Lévy : il aurait pu en effet être professeur, ayant obtenu le certificat de Cluny (sciences) (4), certificat qu’avait par exemple son ami Deckerr, excellent professeur de mathématiques au collège. Disciple de Jules Ferry, il était dévoué à l’école publique, qu'il voulait absolument neutre, du point de vue politique et religieux. Aimant les libertés, y compris la liberté de l'enseignement, il les voulait pour tous : il considérait que l’enseignement religieux, hors de l’école, dépendait uniquement de la volonté des parents et était de la seule compétence des prêtres.
Il fit agrandir l’Ecole Edmond Bour et créa des Ecoles maternelles. La question du collège ne se posait pas : son effectif étant très réduit : il n’était pas mixte alors et il y avait peu d’élèves venant de la campagne ; son agrandissement est devenu nécessaire après la libération en raison de la vague croissante de la natalité et du besoin d'instruction ressenti dans tous les milieux.
Le musée "Baron Martin de Gray” reçut une impulsion nouvelle. Son ami Pigalle, ancien Préfet, petit-fils du Baron Martin de Gray se passionna avec le maire, pour parfaire son installation ; il donna une collection de Prudhon (peintre qui vécut quelques années à Rigny) et des impressionnistes amis de lui-même et de Besnard. D’autres Graylois léguèrent au musée des peintures et du mobilier ancien, notamment Mme Billardet, Melle Petiet etc. ; le tout fut mis en valeur dans ce cadre magnifique. Moïse Levy fut aidé par des conservateurs dévoués : Roux, artiste-peintre, Emile Weber professeur de dessin au collège, puis Camille Rochard, bibliothécaire et professeur de latin au collège.
Moïse Levy avait un esprit clair, des idées pratiques et l'expérience des affaires. Avec opiniâtreté, il travailla au développement industriel de Gray, étant persuadé d’ailleurs que le progrès économique conditionnait le progrès social.
Il ne ménagea pas ses efforts pour installer à Gray des usines à une époque où les hommes politiques n’étaient guère axés sur ce problème : c’était le temps où Couyba, homme de lettres, avait été promu ministre du commerce, par la grâce de Caillaux.
Moïse Levy aida pendant la guerre de 1914 Félix Gouvy, de Dieulouard, à s'installer à Gray. Il décida Sauvegrain de Roanne à créer un tissage, puis l’I.R.C.B. de Saint-Vit à faire des ateliers aux Magasins Généraux. A la place du moulin qui brûla, il fit une centrale électrique.
Il rédigea une notice illustrée et traduite en anglais pour souligner les avantages qu’offrait Gray pour des fabriques de transformation, des entrepôts et commerces de réexpédition. Après son échec pour le passage par Gray de la ligne ferrée de Simplon, tous ses espoirs s’étaient portés sur la Saône. Gaston Gloriod, polémiste ardent, se moquait et disait : "Moïse croit avoir créé la Saône". Il y voyait la voie de notre salut.
S’il avait vécu après la seconde guerre mondiale, il aurait porté ses efforts de propagande sur l’axe fluvial du Rhône au Rhin par la Saône, reliant la méditerranée à la mer du Nord, en s’associant aux hommes clairvoyants de notre région, tels qu’Edgar Faure et Jeanneney, fils de l’ancien Président du Sénat. Cette réalisation n’est pas seulement utile pour Gray ; elle est nécessaire pour l’aménagement du territoire et pour la création en France d’un axe économique européen (5). Dès la libération, il aurait fait une zone industrielle inter-communale.
Il avait du cœur, un élan social généreux : il était la bonté même. Il accueillant chaleureusement les humbles, à qui il ne disait jamais : non ou impossible ; il leur donnait l’espoir et réussissait souvent dans des cas désolants, particulièrement difficiles.
Il fut le bras droit de Massin, notaire à Dijon, chargé par la famille Cournot-Changey de créer un Asile de Veillards.
Il fut l’ami d’Amédée Denis, d’Arc les Gray, qui, par son premier don à l’œuvre de l’allaitement maternel de Paris, permit de fonder aux Capucins le Refuge Maternel (auquel lui-même donna une propriété voisine pour les enfants en bas-âge) ; récemment l’œuvre de Paris fut absorbée par l’Assistance publique et le refuge passa alors aux Hospices de Gray.Il eut toujours la plus grande sollicitude pour les Hospices, en accord toujours avec la supérieure et les religieuses : c’est à son époque que date le legs de Madame Revon.
Ses préoccupations municipales, il les transporta sur le plan parlementaire, quand il fut élu sénateur sur la liste du Président Jeanneney. Il n’était pas un partisan et se ralliait à ce qui lui semblait équitable : "souvent les théories sont justes dans ce qu’elles affirment et fausses dans ce qu’elles nient".
Il s'intéressa spécialement aux artisans. Il déposa une proposition de loi, qu'il rapporta, pour limiter la création des salons de coiffure et mettre de l'ordre dans la profession. Elle devint une loi.
Emu par la grève des dockers de Marseille, menée par des étrangers, il déposa une proposition de loi pour les empêcher d’influencer les ouvriers français : face à la menace de guerre la cohésion nationale devait être resserrée.
Pour le commerce, il déposa une proposition de loi sur le Registre du Commerce, pour le rendre plus efficace, proposition qui fut reprise ultérieurement.
Il chercha à donner aux organisateurs économiques un plus grand rôle dans la politique économique du pays et l'élaboration des lois les concernant ; il déposa une proposition de loi, dont il fut rapporteur, pour créer une assemblée des Présidents de chambre de commerce : on en fit une loi.
Il ne perdait pas de vue les questions municipales : il déposa une proposition de loi pour l'inscription de l'acte de naissance : on en fit une loi.
La guerre arrêta son rôle parlementaire.
Nos revers militaires ne peuvent être imputés aux parlementaires, qui n’ont jamais refusé de crédit. Pour une bonne part, ils sont dus à nos trop vieux chefs militaires qui n'ont pas assez tenu compte des leçons de 1914 et qui n'ont pas crée des corps de chars et d'avions puissants et ayant entre eux une étroite liaison.
A son poste de maire, à l’arrivée des allemands à Gray, il fit son devoir ; c'est ainsi que malgré les instructions allemandes, il donna au Capitaine des Pompiers Pelot l’ordre écrit d’arrêter le feu Place de l’Hôtel de Ville.
Convoqué au Parlement à Vichy, il partit de Gray en auto, avec son fidèle Secrétaire Emile Bautz ; et vu les circonstances et non sans avoir pris conseil du Président de l’assemblée, et de nombreux amis comme le sénateur socialiste Bon, en dépit de l’entourage alarmant du ténébreux Laval, il vota les pouvoirs à Pétain pour la seule raison que, pratiquement, il n’y avait rien d’autre à faire, en attendant la délivrance du pays.
Il revient à Gray où il fut révoqué par le Préfet de ses fonctions de maire, puis expulsé de sa maison par les allemands. Il se réfugia à Paris et ne dut qu’à sont état de santé précaire de ne pas être déporté (il ne manquait pas de jouer à l’agonisant lors des visites de la Gestapo).
Il eut la tristesse de connaître la déportation de son fils René, qui lui ressemblait tant ; mais il n’apprit pas heureusement sa fin horrible à Auschwitz à la chambre à gaz.
Ce vieux lutteur qui avait combattu de toute son énergie pour Gray, cet animateur infatigable, ayant le don de persévérer, ce libéral indomptable, s’éteignit à Paris, où il était seul avec sa compagne ; elle l’a soutenu jusqu’au bout de son courage égal au sien (6).
Il n’eut pas la joie d’apprendre le débarquement allié en Normandie ; mais, à aucun moment, il ne désespéra. Il conserva toujours intacte sa foi dans les destinées de la Patrie et dans la sauvegarde de la civilisation (7).
Lucien LA RUCHE
1965.
NOTES
(1) Pris pendant l’occupation : vous pardonnerez donc les omissions involontaires.
(2) Le slogan de Drouot dans sa première campagne fut :
Couyba + Ragally = 1 + 0 = 1
Couyba + Drouot = 1 + 1 = 2
(3) Bresard remplaça le maire au début de la guerre de 1914. Moïse Lévy, lieutenant d’infanterie (territoriale) (qui avait refusé malgré sa classe d’être rayé des Cadres) rejoignit les troupes de couverture en avant de Toul et commanda une compagnie ; atteint de rhumatismes et immobilisé il fut hospitalisé à l’Hôpital Gamma de Toul ; puis réformé et nommé Lieutenant honoraire.
(4) Coudry, professeur au collège, lui avait dit : "tu ne peux réussir qu’en lettres".
(5) Voir article n° 36 du 12-2-1965, Journal "Les dépêches", Journal du centre-Est à Dijon.
(6) Des amis de la famille furent d’un dévouement total, et notamment Mademoiselle Berthe Coudry (la fille du professeur au collège), qui prêta son identité à Madame Moïse Lévy.
(7) Il a été déposé à la bibliothèque municipale de Gray, ses rapports et propositions au Sénat, nottament ceux numéros 451 et 550 de 1937, 166 de 1939, 186 de 1937, 328 de 1938 et 288 de 1938 ; ainsi que la copie de sa lettre au chef de l’Etat Pétain du 25 février 1941 où il "élève contre la loi du 3 Octobre 1940 ; importée de l’étranger, la protestation la plus énergique. Dans la patrie de la liberté, les Français retrouveront un jour la liberté de conscience".
 votre commentaire
votre commentaire
-
Chronologie des évènements
- La loi du 3 octobre 1940 portant satut des juifs paraît au Journal officiel du 18 octobre 1940.
- En février 1941, une circulaire demande aux parlementaires de préciser s'ils étaient d'ascendance juive.
- Le 25 février, le sénateur Moïse Lévy s'insurge contre cette circulaire auprès du Maréchal Pétain (Lettre à Pétain).
- La loi du 2 juin 1941 qui remplace la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs paraît au Journal officiel du 14 juin 1941.
- Par décret du 19 novembre 1941 "Déchéance de parlementaires", paru au Journal officiel du 27 novembre 1941, les députés et sénateurs juifs sont déchus de leurs mandats :
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat,
Sur le rapport de l’amiral de la flotte, vice-président du conseil, du garde des sceaux ministre secrétaire d’Etat à la justice, et du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur,
Vu la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 2,
Vu l’avis du commissaire général aux questions juives,
Décrétons :
Art. 1°. – Sont déchus de leur mandat de sénateur :
MM. Moïse Levy, Abraham Schrameck, Georges Ulmo.
Art. 2. – Sont déchus de leur mandat de député :
MM. Pierre Bloch, Léon Blum, Salomon Grumbach, Robert Lazurick, Lévy Alphandéry, Charles Lussy, Georges Mandel, Léon Meyer, Jules Moch.
Il convient de remarquer que les trois sénateurs déchus avaient voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Léon Meyer avait été le seul député déchu à voter ces pleins pouvoirs (voir ce site et l'extrait du JO).
Lettre du Sénateur Moïse Lévy au Maréchal Pétain, 25 février 1941 (Lettre à Pétain)
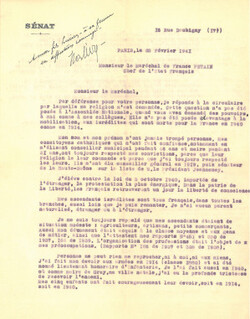
Monsieur le Maréchal,
Par déférence pour votre personne, je réponds à la circulaire par laquelle ma religion m’est demandée. Cette question n’a pas été posée à l’Assemblée Nationale, quand vous avez demandé des pouvoirs, à moi comme à mes collègues. Elle n’a pas été posée davantage à la mobilisation, aux israélites qui sont morts pour la France en 1940 comme en 1914.
Mon nom et mon prénom n’ont jamais trompé personne. Mes concitoyens catholiques qui m’ont fait confiance, notamment en m’élisant conseiller municipal pendant 46 ans et maire pendant 21 ans, ont toujours respecté mes convictions, parce que leur religion le leur commande et parce que j’ai toujours respecté les leurs. Ils m’ont élu conseiller général en 1919, puis sénateur de la Haute-Saône sur la liste de M. le Président Jeanneney.
J’élève contre la loi du 3 octobre 1940, importée de l’étranger, la protestation la plus énergique. Dans la patrie de la Liberté, les Français retrouveront un jour la liberté de conscience.
Mes ascendants israélites sont tous français, dans toutes les branches, aussi loin que je puis remonter. Je n’ai aucun parent naturalisé, étranger ou à l’étranger.
Je me suis toujours rappelé que mes ascendants étaient de situation modeste : agriculteurs, artisans, petits commerçants. Aussi mon dévouement était acquis à la classe moyenne et aux gens de métier, ainsi que l’attestent mes rapports N° 451 et 550 de 1937, 166 de 1939. L’organisation des professions était l’objet de mes préoccupations. (Rapports N° 186 de 1937 et 328 de 1938).
Personne ne peut rien me reprocher, ni à moi, ni aux miens. J’ai fait mon devoir aux armées en 1914 (classe 1880) et ai été nommé lieutenant honoraire d’Infanterie. Je l’ai fait aussi en 1940, où comme maire de Gray, ma ville natale, j’ai eu la profonde tristesse de recevoir l’ennemi.
Mes cinq enfants ont fait courageusement leur devoir, soit en 1914, soit en 1940.
J’ai défendu les droits de la famille autrement que par des discours, en participant à la création d’une maternité, d’une pouponnière, d’une maison d’enfants et d’un asile de vieillards.
Vous avez fait don à la France, Monsieur le Maréchal, de l’honneur des Français de religion israélite : l’histoire nous dira si les rigueurs de l’occupation en ont été adoucies.
Quels que soient les évènements (conformément à ma proposition de loi N° 288 de 1938 que je rappelle avec fierté), mon mot d’ordre sera toujours :
"Suivre le sens national, sans lequel rien ne se fait de grand, ni de durable, et répondre à l’appel de la Patrie."
Veuillez agréer, je vous prie,
Monsieur le Maréchal,
l’ expression de mes sentiments les plus respectueux.
Signature
M. Moise LEVY, Sénateur de la Haute-Saône.
Exemplaire dédicacé : A mon fils Lucien - à sa femme en affectueux hommage - Signature
 9 commentaires
9 commentaires
-
 C’est un livre court et dense. Un petit livre qui nous offre deux perspectives. D’abord, celle de la belle explication de l’auteur sur son amour de la langue yiddish qui en a fait l’un des rares Italiens capables de traduire le Nobel Issac Bashevis Singer : « Le yiddish ressemble à mon napolitain, deux langues de grande foule dans des espaces étroits ». La langue est bien la base de notre compréhension du monde, le véhicule par lequel on peut appréhender la vérité, èmet en langue hébraïque. Ainsi, « en hébreu èmet est féminin, mais devient masculin en yiddish, perdant en consistance. En hébreu elle est absolue, en yiddish elle est relative. » Là où le yiddish devra préciser que c’est la « pure vérité », il suffira en hébreu de dire que c’est la « vérité ».
C’est un livre court et dense. Un petit livre qui nous offre deux perspectives. D’abord, celle de la belle explication de l’auteur sur son amour de la langue yiddish qui en a fait l’un des rares Italiens capables de traduire le Nobel Issac Bashevis Singer : « Le yiddish ressemble à mon napolitain, deux langues de grande foule dans des espaces étroits ». La langue est bien la base de notre compréhension du monde, le véhicule par lequel on peut appréhender la vérité, èmet en langue hébraïque. Ainsi, « en hébreu èmet est féminin, mais devient masculin en yiddish, perdant en consistance. En hébreu elle est absolue, en yiddish elle est relative. » Là où le yiddish devra préciser que c’est la « pure vérité », il suffira en hébreu de dire que c’est la « vérité ».Dans une deuxième partie, De Luca explore les relations d’un couple rencontré par hasard, attablé dans une auberge alors que l’auteur travail sur une traduction en yiddish. Il s’agit d’une femme d’une quarantaine d’années et de son père, ancien criminel de guerre nazi, qui ne regrette rien de son passé, et dont le seul tort a été de perdre la guerre. Et il assume ses actes : « Je ne cherche pas à me justifier en disant que j’ai été contraint d’exécuter des ordres. Au Tribunal, j’ai entendu mes supérieurs se déclarer sous Befehlsnotstand, en état de contrainte, à la suite d’un ordre. Ces ordres, nous les avons démontés et remontés, comme on le fait avec les armes. Nous les avons huilés et lubrifiés pour qu’ils ne s’enrayent pas. Nous les avons exécutés avec l’efficacité de l’enthousiasme. Notre faute est plus impardonnable : c’est la défaite. »
Pendant de longues années, cet homme a fui l’Allemagne et s’est caché en Argentine, puis il est retourné dans sa ville natale, Vienne, tant il est vrai qu’« on se cache mieux dans sa propre région ». Après avoir su la vérité, la vérité vraie, sa fille est restée vivre avec son père, sans vouloir décortiquer les crimes de cet : « homme recherché pour crimes de guerre. Lesquels et combien : j’ai voulu l’ignorer. Je ne crois pas à l’importance des détails. Ils sont utiles dans un procès, mais pas pour une fille : la circonstance horrible devient atténuante car elle réduit le crime à des épisodes. En revanche, dépourvu de détails, le crime reste sans limites. » Un père qui a été lui-même confronté à la langue hébraïque : « Mon père a connu le mystère d’une lettre hébraïque qui, placée devant un verbe au futur, le transforme en temps passé. Il paraît qu’aucune autre grammaire au monde ne possède un tel atout. L’hébreu ancien traite le temps comme l’aiguille à tricoter la pelote de laine. Sa lettre vav en accroche un bout et le ramène en arrière. (…) mon père décida que c’était justement ce qui était arrivé au nazisme, la malédiction d’une lettre hébraïque avait inversé l’avenir du Troisième Reich à terme échu. »
GLR

 votre commentaire
votre commentaire
-
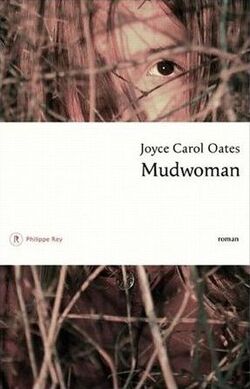 Deux petites filles élevées par une mère dérangée disparaissent. L’une d’elle, dont il est difficile de savoir s’il s’agit de l’ainée ou de la cadette, est sauvée in extremis de la boue des marais. Cette « mudgirl » deviendra « mudwoman », une brillante universitaire et bientôt la première femme présidente d’université. Une femme qui aura bien du mal à se défaire de ce lourd passé qui la rattrape et qui la hante.
Deux petites filles élevées par une mère dérangée disparaissent. L’une d’elle, dont il est difficile de savoir s’il s’agit de l’ainée ou de la cadette, est sauvée in extremis de la boue des marais. Cette « mudgirl » deviendra « mudwoman », une brillante universitaire et bientôt la première femme présidente d’université. Une femme qui aura bien du mal à se défaire de ce lourd passé qui la rattrape et qui la hante.Difficile pourtant de comprendre le lien entre ces destins, difficile de suivre les méandres de la vie de cette femme, de faire la part de ses cauchemars et de la réalité. Difficile de ne pas être dérouté par une fin qui nous laisse sur notre faim.
GLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Edgar Hilsenrath décrit froidement la (sur)vie quotidienne dans le ghetto ukrainien près du Dniestr, en territoire administré par les Roumains en 1942. Les propos sont très crus mais dépourvus des truculences et des provocations qui émaillaient le mémorable Le nazi et le barbier.
Edgar Hilsenrath décrit froidement la (sur)vie quotidienne dans le ghetto ukrainien près du Dniestr, en territoire administré par les Roumains en 1942. Les propos sont très crus mais dépourvus des truculences et des provocations qui émaillaient le mémorable Le nazi et le barbier.Il y a ici une description sobre et captivante d’êtres humains réduits à la vitale nécessité de tous les instants de rechercher un endroit pour dormir à l’abri du froid et des rafles, et de la nourriture pour tenter de ne pas crever de faim. Une survie faite de trocs incessants, où la solidarité n’existe pas ou bien se monnaie à prix fort, où la police impitoyable est constituée de juifs chanceux. Un monde où les êtres sont laissés dans un dénuement physique et moral extrême. Un monde où on a le choix de « mourir tranquillement » de faim, d’épuisement, de typhus, ou d’une balle. Un monde absurde où les morts, même ceux qui sont les plus chers, n’ont plus le loisir d’être respectés.
« Deux cadavres flottaient paisiblement sur le fleuve : un homme et une femme. La femme voguait un peu à l’avant de l’homme. On eût dit un jeu amoureux. L’homme essayait sans cesse d’attraper la femme, sans jamais y parvenir. Un peu plus tard, la femme dériva légèrement sur le bord et fit risette à l’homme, qui rendit son sourire, puis la rattrapa. Son corps heurta le corps de la femme. Les deux cadavres se mirent alors à tourner en cercle ; ils se collèrent un moment l’un à l’autre, comme s’ils voulaient s’unir. Puis, réconciliés, ils reprirent leur dérive. Le crépuscule s’épaississait. Le vent rafraîchissait les deux corps, avec la même tendresse que l’eau, les bergers et les champs de maïs de l’autre côté, sur la rive roumaine. Encore un jour absurde qui touche à sa fin. »
« Ranek était assis là et fixait le mort, comme envoûté. Il secoua la tête. Non, pas encore ! Ce n’est pas parce que tes jambes ne t’obéissent plus que tu vas abandonner. Allez, debout ! Mais ses jambes ne voulaient plus. Elles aussi, comme le mort, parlaient leur propre langue, mais sur un autre ton. Elles disaient : file-nous d’abord à bouffer ! Ensuite nous te porterons. »
… Un monde où deux êtres peuvent cependant trouver le bonheur du simple fait de n’être plus seuls au monde, ne serait-ce que pour un moment.
GLR

 votre commentaire
votre commentaire
-

Le film s’ouvre sur une cour de prison, une condamnation à mort qui résume la situation d’un Kurdistan libre mais s’affirmant par une répression absurde.
Baran, qui a combattu depuis l’âge de quinze ans pour l’indépendance, refuse d’entrer dans ce système policier. Mais il craint plus encore la tenace volonté de sa mère de le marier… et il accepte le poste que personne ne veut, dans les montagnes kurdes où seule la loi des seigneurs locaux s’impose. Comme Baran, l’indépendante institutrice Govend refuse le mariage pour aller enseigner dans ce petit village oublié.
Entre les deux personnages, ces montagnes d’une beauté à couper le souffle qui sont aussi les lieux de passage des trafics et des conflits avec les combattantes kurdes de Turquie (là aussi la résistance se décline largement au féminin). Des paysages pierreux et sauvages qui ne connaissent qu’un écho lointain de la paix. Dans le petit village régi par la tradition du mariage précoce et un code de l’honneur dicté par le puissant chef local, le célibat de la jeune institutrice, tout autant que la volonté de Baran de rétablir la loi dérangent…
Après son génial « Si tu meurs, je te tue » qui se déroulait à Paris, Hiner Saleem nous embarque dans la poésie des montagnes kurdes, au rythme du hang que tape Govend pour faire résonner un nouveau son contre les murailles fermées de la société villageoise. Hiner Saleem nous régale de ses dialogues et situations décalées, de sa liberté de ton pour dénoncer la situation des femmes tout autant qu’un code de l’honneur absurde. L’actrice Golshifteh Farahani est superbe, comme dans Syngué Sabour. Mais le mélange entre western spaghetti et critiques sociale et féministe, les combattantes kurdes gravures de mode et le scénario un peu attendu entre Govend et Baran, ne convainquent pas totalement et laissent un goût d’inachevé. Reste cependant dans notre mémoire le son du hang qui se répercute entre les montagnes kurdes.
BBLR

 1 commentaire
1 commentaire
-
Les élus ne devraient pas se comporter comme des oligarques libéraux. Or leur manière d’être et leurs discours sont souvent empreints de ce sentiment de classe et de cette idéologie.
G. Collomb, maire de Lyon interviewé ce matin sur France-Inter dans le 7/9, en a encore donné un exemple saisissant. Il ne parle pendant un moment que de questions financières, « le nerf de la guerre », toute la politique semblant se cantonner là. Il mentionne ensuite s’opposer à une augmentation trop rapide de la péréquation entre villes riches et villes pauvres, en justifiant cela par le fait que les grandes agglomérations assurent déjà pleinement cette péréquation, comme par exemple entre Lyon et Vaulx-en-Velin. Maintenant la mixité fonctionnerait bien à Vaulx-en-Velin grâce à cette péréquation venant de Lyon. Mais cela aussi signifie aussi que la décision de cette péréquation est faite par le plus gros, Lyon, pour Vaulx-en-Velin, c’est-à-dire finalement par le riche ou le puissant pour le pauvre et selon l’image de ce puissant.
Par ailleurs les zones rurales sont oubliées, mais elles seraient, selon G. Collomb, essentiellement encombrées de riches retraités. Faudrait-il quand même souligner qu’un grand nombre de zones rurales sont loin d’être seulement des zones de villégiature ?
A la question posée par un auditeur sur les choix faits par la ville concernant la construction d’un stade, M. Collomb répond de manière ironique ; « Mr semble bien au fait des enjeux de l’agglomération ! » Il renvoie encore -et comme bien souvent d’autres élus le font- les citoyens s’occuper de leurs affaires privées, comme si le champ politique n’était pas de leur ressort mais seulement le domaine des « professionnels ». Nous sommes tout à fait dans ce que Cornelius Castoriadis appelait « la privatisation » du politique, indiquant aux hommes du commun « Vaquez donc à vos affaires, braves gens, ne vous souciez pas du bien commun, c’est notre affaire, vous n’y comprenez rien ».
Enfin, un autre auditeur indique avoir sollicité G. Collomb par écrit pour proposer de lancer un débat sur le mariage pour tous dans la ville de Lyon. Il n’a pas reçu de réponse de la part de son élu, ce qui est le lot commun des citoyens qui interpellent leurs élus qui estiment souvent qu’une fois le bulletin de vote mis, ils n’ont plus de compte à rendre à leurs électeurs.
Lors de cette interview sur France-Internet, Mr Collomb n’a fait qu’exprimer son avis sur le mariage pour tous, ce qui n’était pas question posée, et il n’a pas du tout répondu sur la mise en place d’un débat public dans la ville.
La démocratie a largement besoin d’être rénovée pour que le débat collectif puisse enfin exister et non pas être accaparé par les « professionnels » de la politique. N’est-ce pas aussi de la responsabilité des journalistes d’assurer l’éthique de ce débat, et de rappeler a minima à l’élu qu’il n’a même pas répondu à la question ?
A quand un débat sur la question de la qualité de la vie démocratique ?
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
L’hymne à la joie, hymne de l’Europe, est muet. Pas de paroles, comme l’Europe qui ne s’exprime pas. Pourquoi ne pas imaginer des paroles ? Quel compositeur pourrait faire parler cette grande muette ? Pour exprimer ce que l’Europe pourrait être, en miroir de ce qu’elle n’est pas aujourd’hui.
BBLR

 votre commentaire
votre commentaire
-
De Margerie est invité ce matin sur France-Inter. Il nous dit qu’il suffit de changer de vocabulaire pour que le gaz de schiste devienne acceptable. Oui, le terme de fracturation fait peur, le problème est tout simplement là. Changeons-le. Adoptons le vocable de stimulation et tout ira mieux ! Cosmétique du vocabulaire pour faire avaler une pilule plus qu’amère.
Et ce soir nous avons droit à un « débat » sur le gaz de schiste sur la même radio. Deux invités favorables au gaz, le patron de l’industrie et un journaliste du Parisien, et un opposant isolé. Est-ce un débat ? Non, c’est un assaut de communication en faveur du gaz lancé depuis quelques temps sur nos ondes. Assaut de com. pour nous faire avaler ce gaz comme un futur désirable !
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Ruée vers le gaz et le pétrole de schiste… aux Etats-Unis, en Chine… ça y est, on a trouvé la nouvelle mine, le nouvel or…
Ou surtout le moyen de garder plus longtemps les yeux fermés sur la finitude de ressources que nous allons chercher toujours plus loin, en mettant toujours plus en danger notre ressource première, l’eau.
Chanson de Gotainer : « Comment vous dites ?, de l’eau de source ? Et pourquoi pas une baleine bleue… un éléphant, un bébé ours… sans plaisanter, restons sérieux… » un refrain que nous n’entendons pas… oui de l’eau de source, celle que nous ne savons même plus voir, la merveille, une couleur plus claire que la lumière. Notre vie.
Sur La route de Cormac Mac Carthy, nous nous lançons comme on lit ce livre, pour se rendre compte au détour des pages de l’envers de cette terre sans vie, de la beauté du monde que nous nous efforçons de détruire. Miroir. Nous sommes toxicomanes, dépendants d’un mode de vie insoutenable… et nous nous efforçons de ne pas y penser.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Lu dans Causette. Le portrait d’un directeur d’école à Marseille. Sa fille a été contrainte à boire une quantité énorme de vodka. « Inconsciente », « inerte » selon les termes de ses agresseurs, elle a été violée successivement par tous les membres du groupe. Elle est morte dans ses vomissements sous le regard de ses bourreaux qui ont craint d’avertir les secours.
Mais au cours des deux procès d’assises, ses violeurs ont continué de l’appeler « la chienne ». L’agenda de sa mère, qui s’inquiétait les derniers mois pour sa fille et notait les rencontres de cette dernière, a été utilisé aux procès pour montrer qu’elle rencontrait beaucoup d’hommes.
Il y a peu de temps, un procès s’est encore tenu en région parisienne, et les victimes ont été sommées de se taire.
Quand une vieille dame se fait voler son sac à main dans la rue, qui irait demander pourquoi elle porte un sac à main visible et facile à voler ?
Même la drogue, l’alcoolisation, la mort, ne parviennent pas à enlever le sceau du doute pour la femme violée. Elle a bien dû à un moment laisser le doute s’instiller. Flétrissure sur la victime. Flétrissure elle reste, cette marque sur la femme violée. Jusqu’à quand ?
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Dans le sud-ouest, l’été, le soleil tait la terre.
La chaleur tombe sur le sol, l’écrase, le craquelle. De grosses mottes sèches dans les champs. L’été enserre le vivant de silence. Seule la chaleur s’écoule sur les pierres ; seuls les pas résonnent sous le soleil brûlant. Des feuilles séchées tombent, seul bruit. L’eau de la rivière est muette, elle glisse plus qu’elle ne coule… jusqu’au Tarn, une nappe d’eau étale.
Dans le sud-est, l’été, la chaleur bruit. Le son continu des cigales, le bruit de la mer et des graviers sous les pieds, le vent iodé dans les oliviers.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Étonnant ce qu’on perd d’épaisseur dès qu’on se marie. A partir de cet instant, et bien que la notion de chef de famille n’existe plus, le ministère des Finances ne s’adresse plus à vous pour remplir la fiche d’imposition mais à votre conjoint. Peu importe que vous travailliez tous les deux ou non, la fiche d’imposition parviendra à Monsieur… Vous n’êtes plus censés avoir droit de regard sur la feuille d’impôt, sur la contribution fiscale à la nation qui vous concerne pourtant en qualité de citoyenne. Mais la citoyenne ne semble pas devoir être impliquée dans la déclaration familiale d’impôt bien qu’on puisse la poursuivre ensuite par solidarité avec son mari en cas de non paiement.
Un peu comme lorsque la femme était considérée comme une grande irresponsable sur les plans civil et politique, inaccessible à la raison citoyenne…. et pourtant reconnue responsable des crimes, délits et contraventions commis. Étonnantes contradictions !
Et cela se poursuit lorsque vous recevez un appel qui vous dérange dans votre travail, un appel comminatoire qui demande à parler au Docteur V.
- Ah ! Oui, et de la part de qui ? Vous en êtes presque à dire d’une voix aigüe, secrétariat du Docteur V., j’écoute !
- … de …, là, la voix devient incompréhensible, le débit, parti au galop, le ton monocorde, hachant tous les mots, a surtout permis à l’interlocuteur de ne rien comprendre. La fin seule peut être entendue, tranchante. Motif professionnel… pour parler au Docteur V.
- Ah ! Bon mais pour quel motif ? Vous savez faire la cruche, vous en abusez.
- Encore un mot incompréhensible, la voix est repartie de son allure folle. Puis cette voix mécanique, hautaine, demande à nouveau à parler séance tenante au Docteur V…. indiquant en vrac, loi Scellier, fiscalité, fiche d’imposition…
- Ah, si c’est pour l’imposition, vous pouvez m’en parler, je suis sa femme…
- Ah ! Bon, je croyais que c’était un numéro professionnel… A quelle heure pourrais-je alors parler au Dr V…
Eh ! Oui, encore une fois, la femme qui partage normalement toutes les joies et les difficultés avec son cher et tendre, se trouve évacuée, évaporée. Elle se transforme en vapeur inconsistante devant le fisc et les conseillers en patrimoine. Sans doute parce la gente éthérée ne comprend pas grand-chose à ce grand domaine viril de la fiscalité, à la notion de patrimoine et autres possessions matérielles. Les hommes font leurs affaires du patrimoine familial. Les femmes n’ont pas à s’en occuper, sauf lorsque surviennent des dettes en cas de difficultés. Et après la mort de l’homme. On pourra alors entendre un enfant, y compris sa fille, dire : « oui, ma mère n’avait pas l’habitude de remplir la feuille d’impôt, depuis la mort de Papa c’est Julien qui est obligé de l’aider… ».
Mais même si elle avait voulu la remplir cette fameuse fiche d’imposition, le fisc ne le lui demande pas et l’ignore… tout au moins pour remplir les cases.
La femme mariée est évanescente pour le fisc, elle est le gadget qui accompagne le détenteur du portefeuille d’actions pour les conseillers en patrimoine ou fiscaux.
Alors que dire des concessionnaires et garagistes. Bien que votre voiture soit à vos deux noms, bien que ce soit vous qui l’ameniez aux révisions et contrôles techniques, le garagiste ne connaîtra jamais que le nom de votre mari.
Tous ces symboles du mâle perdurent. Vous laissez couler, comme d’hab, mais ces symboles ont des conséquences comme votre évanouissement d’une certaine sphère de la vie publique. Ces manières de fonctionner vous énervent, elles sentent le suranné et pourtant elles restent caractéristiques encore de notre société.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Ce matin, 6h50 environ. J’entends à la radio une bonne nouvelle. Un homme israélien s’est filmé, sa petite fille dans les bras. Sur le film il explique qu’il ne souhaite pas la guerre avec l’Iran. Qu’il est homme, père, et qu’il aime les Iraniens. Il ne représente ni ne parle au nom de ses gouvernants mais il parle en tant qu’homme refusant la guerre et d’envoyer des bombes sur l’Iran. Il est membre d’un peuple aimant les Iraniens malgré des gouvernants gesticulant les uns contre les autres, menaçant…
Il a posté son film sur Internet. A sa suite, des dizaines d’Israéliens ont posté des films semblables, expliquant leur refus de la guerre contre un autre peuple, et puis…
Et puis des Iraniens ont à leur tour posté des films sur Internet dans lesquels ils témoignent eux aussi de leur amour pour l’autre peuple et de leur refus de lui faire la guerre…
J’étais en train de faire je ne sais plus quoi. Je me suis arrêtée et j’ai pensé : « il fait beau ce matin et le murmure des nouvelles est bon à entendre… Les personnes pensent par elles-mêmes, s’expriment, et elles peuvent faire avancer les choses au-delà de la bêtise de leurs dirigeants… » jusqu’à ce que la journaliste ajoute : « Biens, soyons un peu plus pragmatiques… » et elle a changé de sujet.
Pourtant cette manière de s’exprimer, de dire « non », de s’opposer à ce que les médias parfois annoncent comme inévitable, me parait très pragmatique… surtout lorsque le murmure enfle et fait écho à des milliers de km, entre pays dits ennemis.
Qu’appelle-t-on pragmatisme…. le cynisme ?
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
En attendant le RER le soir à Cergy-Préfecture, je lis L’intuition de l’instant de Gaston Bachelard. J’entends un murmure fredonné. Un chant susurré, quasi religieux, chemine. Je lève les yeux. Je ne sais d’où il vient. L’air revient, danse encore. Je me lève, à sa recherche.
Et je vois la femme. Assise bien droite sur le banc devant, serrée dans un chemisier blanc et un tailleur, ses lèvres s’entrouvrent à peine, son regard se porte ailleurs, sur un point fixe au loin. Chant léger, interstice d’un temple ouvert sur l’intérieur…
Le RER arrive dans un crissement épouvantable. L’odeur du caoutchouc brûlé, systématique. Le bruit des freins couvre la voix frêle, sa voix mélodieuse, sa voix réelle. Elle se lève et part rapidement vers l’avant du train, emportant son murmure et l’instant…
Le RER suit la voie…
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Chère Madame,
En tant que directeur de la nouvelle DCTJSLP* j’ai pris le temps de vous recevoir une fois l’année dernière, le 30 novembre précisément, pendant près d’une heure pour que nous envisagions ensemble les objectifs de votre service. Vous savez combien mon emploi du temps est chargé en représentations, petits fours et mondanités, sans oublier mes abonnements à l’opéra et mes vacances à Courchevel. J’ai tout de même sacrifié une bonne heure à vous recevoir, sans en attendre d’ailleurs le moindre remerciement de votre part. Vous m’avez immédiatement fait remarquer par votre regard peu amène que vous attendiez depuis environ heure trente dans le couloir. Mais dois-je vous rappeler qu’un directeur de la DCTJSLP est amené à régler des tâches de la plus haute importance, comme celle de connaître les décorations accordées aux autres directeurs et membres distingués de notre chère organisation. Vous pouvez comprendre qu’un directeur ne maîtrise pas toujours son temps. La directrice adjointe ne vous-a-t-elle pas d’ailleurs permis de passer agréablement ce temps d’attente en allant lui chercher un yaourt à la cantine ?
J’ai pu constater à cette occasion une certaine inadaptation de votre part à la nouvelle organisation, qui suppose comme l’a clairement rappelé la directrice de la communication une capacité d’adaptation à toutes les situations, une souplesse de caractère et un enthousiasme indéfectible.
Mais ne m’attachant pas à ce premier regard courroucé, je vous ai reçue très cordialement. A cette occasion je vous ai accordé toute ma confiance pour que vous puissiez fixer les objectifs de votre service en toute liberté. Vous avez pu m’entendre vous encourager à la responsabilité et à l’autonomie dans le choix de vos actions et dans les modalités de leurs réalisations. Je me souviens même avoir vanté votre intelligence et votre sens du service public. Malgré mes compliments sur votre dynamisme et votre volonté d’agir pour le bien de l’organisation, vous avez cru bon de vouloir entrer dans le détail des activités que vous avez à accomplir avec vos agents. Vous avez même commencé à contester les principes de la nouvelle organisation en mettant en avant un faux problème. Certaines activités auraient donc du mal à être réalisées compte tenu de la réduction drastique des effectifs depuis plusieurs années ? Voyons, soyez réaliste et ouvrez les yeux : cette vision archaïque du « toujours plus » ne peut raisonnablement être poursuivie. La nouvelle organisation s’est attachée à réformer toutes ces vieilleries, afin de faire mieux avec moins, de faire autrement comme le bon chef de famille qui préside dans notre code napoléonien. Si je vous accorde ma totale confiance, ce n’est pas pour que vous m’entreteniez de questions prosaïques sur les difficultés de tel ou tel établissement à faire face, ni même sur les défaillances de votre service à accomplir certaines activités. Vous ne semblez pas saisir le nouvel organigramme, et notamment les répartitions de fonctions entre stratégie et communication d’un côté et pragmatisme-exécution de l’autre. Cette incapacité à cerner les acteurs sur l’échiquier et leurs fonctions est très préjudiciable à l’organisation. - Soyez pragmatique, vous ai-je donc dit, et exécutez simplement ce que l’on vous demande, je m’occupe de la stratégie, du cadre et des fonctions. - Vous êtes libre - ai-je ajouté, de fixer vos objectifs comme vous l’entendez dans ce cadre. L’organisation vous fait confiance. Adressez-moi vos objectifs pour l’année prochaine, avec l’échéancier d’ici mardi prochain. Et n’oubliez pas d’y intégrer le rattrapage des fonctions non réalisées sur les quatre derniers mois du fait de la vacance de votre poste.
Mes propos étaient volontaires, directs, destinés à vous mobiliser davantage dans l’organisation réformée que vous veniez de réintégrer après plusieurs années à l’extérieur de nos frontières.
Aussi quelle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai lu vos objectifs le mardi suivant ! Vous n’aviez pas même intégré les fonctions si capitales d’analyse financière des 67 établissements du département… Vous sembliez oublier les orientations majeures de l’Organisation, à savoir, dois-je encore vous le rappeler, parvenir à la rentabilité financière de ces établissements et sortir de leur assistanat ! Adoptant votre ton plaintif, vous avez encore mis en avant l’insuffisance des effectifs pour réaliser cet objectif majeur, mais vous avez consenti à positionner prioritairement trois agents sur cette tâche en délaissant parallèlement une autre fonction qui est bien plus secondaire pour l’Organisation, celle du contrôle.
J’en arrive à soupirer devant tant de naïveté, Madame. Je n’ose dire de bêtise… Vous ne vivez pas dans le monde des Bisounours. Il est temps de vous en rendre compte. L’Organisation ne vous autorise pas à abandonner certaines tâches sous le fallacieux prétexte que vous n’avez pas les moyens de les remplir. J’ai donc été encore contraint de passer du temps à vous expliquer, comme à une enfant un peu idiote, que vous devez inscrire l’objectif de contrôle, quelle que soit la situation de votre service. Il s’agit d’un affichage indispensable pour l’organisation. Bien sûr cet affichage est essentiel pour moi puisque je devrais le présenter au directeur du YATIUPDL** pour validation. Le directeur ne comprendrait pas qu’il n’y figure pas puisque cela entre dans nos attributions, comprenez-vous ?
Vous serez de votre côté tout simplement responsable de l’exécution du contrôle avec les moyens dont vous disposez, vous comprenez ? Vous êtes entièrement libres de vous organiser dans ce cadre et vous contestez une telle autonomie de travail ? Je ne vous comprends pas.
Et après plusieurs éclats du même acabit de votre part, vous venez de m’écrire que vous ne voulez plus avoir honte de votre travail et « accepter l’inacceptable ». Mais de quoi parlez-vous donc ? Avez-vous pensé à votre sécurité ? Et à celle de vos enfants ? Combien de fonctionnaires payés à vie accepteraient de changer, d’abandonner leur sécurité pour un pseudo confort moral ?
Vous ne tiendrez guère longtemps, Madame, sur un marché du travail qui ne vous attend pas. Connaissez-vous les difficultés pour vous recaser à votre âge ?
Et que lui reprochez-vous d’être devenu à la fin à votre travail ? Il me semble que vous êtes bien exigeante. Il n’a plus de sens et vous ressentez une cassure entre ce que vous pensez qui doit être et ce que vous devez faire. Mais que cela veut-il donc dire ? Vous n’êtes là que pour imposer un retour à l’équilibre à toute force et sans prise avec les réalités et les personnes qui traversent les établissements ? Et alors ? N’êtes-vous pas contente de toucher votre salaire à la fin du mois ? Vous accusez la nouvelle organisation de n’être que médiocrité, mais vous me semblez bien présomptueuse. Le principe de réalité, vous connaissez ? Je vous avais dit de faire le gros dos, d’attendre encore un an ou deux que les choses se tassent mais vous êtes trop impatiente et finalement inadaptée au pragMMatisme demandé.
Oui, nous appuyons dans l’organisation sur les M pour souligner leur importance. Vous ne semblez pas bien maîtriser le vocabulaire, ni même la grammaire de la nouvelle organisation.
Je vous annonce donc Madame, que je vais me trouver dans l’obligation de rompre notre contrat si vous entendez vivre et travailler autrement que selon nos conventions. Je vais devoir rompre le contrat de servitude volontaire qui nous liait, si vous refusez les conventions majeures, celles qui imposent d’avoir peur du lendemain, d’obéir sans poser de questions et de ne pas avoir de réflexion commune avec les autres. Madame, vous refusez les règles de l’Organisation en vous interrogeant sur ses modes de fonctionnement. Alors veuillez trouver ci-joint le formulaire de rupture de votre contrat avec chauffage intégré au service d’on ne sait plus qui ni quoi.
Mr Edouard Commun
Directeur de DCTJSLP
Post-Scribouillard : vous serez bien obligeante de remplir également la fiche d’évaluation sur cette séquence rupture, avec vos appréciations libres sur les attitudes de la directrice des ressources humaines à cette occasion. En effet, cette évaluation des ruptures avec l’organisation doit servir à l’évaluation des objectifs de la directrice des ressources humaines, donc à sa notation et à son avancement. Je pense que vous comprendrez donc tout son intérêt.
La directrice de la logistique me demande de vous préciser que le formulaire doit être envoyé en trois exemplaires dans la mesure où nous ne disposons plus de papier depuis janvier et ce, jusqu’à la prochaine commande annuelle au siège en novembre. Merci aussi de remplir les trois formulaires au crayon, compte tenu des éventuelles modifications de dernière minute que nous serions amenés à faire dans l’intérêt commun.
* Direction c’est très joli sur le papier
** Y a-t-il un pilote dans l’avion
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Dans son ouvrage « Des gens très bien », Alexandre Jardin nous interroge sur notre conception du bien, sur le danger à s’accaparer ces notions de bien ou de « moindre mal » (cf. Livres).
Le sentiment de faire le bien ne doit-il pas toujours être questionné, ainsi que la société qui formule ses notions de bien et d’honnêteté ? Ce sentiment bien joufflu et tranquille n’est-il pas le plus dangereux des somnifères, celui qui nous permet de fermer les yeux sur les conséquences inhumaines de nos actes ? N’est-il pas le digestif qui nous permet en toute bonne conscience d’avaler les pires infamies ? En refermant ce livre, mes pensées se bousculent. Je ne peux m’empêcher de penser aux discours de Reagan sur l’« Empire du mal » pour désigner l’union soviétique ou ceux de Bush sur « l’axe du mal » pour pointer les pays dits terroristes et justifier le recours à la surveillance, à l’enlèvement et à la torture à l’échelle mondiale. Ces discours incarnaient le bien. Ils ont conduit à des atrocités. Pourtant ils étaient ingurgités en toute bonne conscience par la population américaine et une grande partie du reste de la population occidentale. N’avez-vous pas entendu après les attentats de 2001 des personnes autour de vous estimer qu’il est parfois utile d’avoir des interrogatoires un peu « musclés » pour éviter des catastrophes bien plus graves ? La torture deviendrait ainsi le moindre mal. Les images tournant en boucle, les médias affolés ne vous ont-ils pas vous-mêmes interrogé sur le danger et les moyens de le faire cesser ? La peur n’a-t-elle pas déferlé et redéfini les notions du bien et du moindre mal dans une partie du monde, en toute bonne conscience ?
Mais je ne peux m’empêcher aussi de penser aux discours actuellement entendu, ces propos qui instillent un état d’esprit, qui redéfinissent encore une fois les frontières du bien et du « moindre mal », du mal acceptable pour aller mieux ensuite. Les discours sur l’assistanat, qui pointent le méchant chômeur qui profiterait du système pour refuser un travail, qui n’aurait pas la dignité d’accepter n’importe quel travail alors qu’il est rémunéré pour son non travail. Ces propos font l’impasse des cotisations versées par le chômeur pour faire face au risque chômage quand il travaillait encore. Ces mêmes discours se positionnent comme le gentil donateur qui fait la charité et qui est bien bon. Ils n’oublient jamais de souligner le besoin de soutenir les « plus fragiles », d’assurer donc l’assistance de ces « bras cassés ». Les auteurs de ces propos répétés à satiété expriment toujours le sentiment de bien faire pour ces Autres, pour ces êtres déjà écartés, en perte de l’humanité dont dispose le gentil donateur.
Lorsqu’un ministre indique en public que « les civilisations ne se valent pas », qu’un président ajoute qu’il ne s’agit que d’une question de bon sens et qu’un ancien ministre renchérit qu’ « évidemment » elles ne se valent pas, faut-il encore une fois entendre une nouvelle définition du bien à travers une « civilisation » qui présenterait toutes les valeurs acceptables face à l’odieux barbare, c’est-à-dire l’étranger qui n’aurait pas atteint notre degré d’humanité ? Affirmer en toute bonne conscience son humanité en dévalorisant celle de l’autre serait le nouveau bien, le bon sens face à un « relativisme » qui serait gauchiste et prétendrait à un égal respect des cultures. Pour l’ancien ministre, entre grande littérature et sociétés sans écriture, il n’y aurait pas lieu de tergiverser et il faudrait accepter que tout individu puisse établir un degré différent de « civilisation » entre le Don Giovanni de Mozart et les « tambourins » des indiens Nambikwara. A noter d’ailleurs que les indiens Nambikwara n’utilisent pas d’instruments à percussion selon l’étude de Claude Lévi-Strauss « La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara », Journal de la Société des Américanistes. Tome 37, 1948. pp. 1-132. Établir ces distinctions de cultures, de degrés de civilisation est déjà s’arroger le regard sur l’autre, le droit de le mésestimer, c’est le bon sens. Ce bons sens qui définit une nouvelle normalité, celle d’estimer sa culture supérieure à celle de l’autre, de considérer l’autre moins humain que soi-même. Ce bon sens permet de considérer l’anormalité comme normale et d’accepter l’inacceptable.
Comme le souligne fort justement Alexandre Jardin dans son livre « Des gens très bien », « l’exceptionnel, dans le crime de masse, suppose le renfort de la normalité. Le pire exigea la mise en place de croyances patriotardes et sacrificielles sincères propres à dissoudre la culpabilité. La criminalité de masse reste par définition le fait d’hommes éminemment moraux. Pour tuer beaucoup et discriminer sans remords, il faut une éthique. » Il faut avoir le renfort d’une normalité affirmée dans le fait de considérer l’autre comme inférieur. Il faut que cette pensée pleine de bon sens s’enracine profondément et évidemment dans les esprits. Il faut que la chosification de l’Autre soit normalisée pour ne pas casser son équilibre moral. Il faut avoir foi dans sa plus grande humanité pour considérer en toute bonne foi que l’autre présente un moindre degré d’humanité. Pour justement continuer sans flancher dans cette morale du bon sens. C’est une éthique à fond renversé qui commence à s’établir ainsi.
Alexandre Jardin ne rappelle pas dans son livre toutes les germinations de haine antisémite qui ont précédé la solution finale et l’acceptation en toute bonne conscience de cette solution comme un moindre mal… parce que tel n’est pas le propos de son livre. Mais restons toujours vigilants et refusons les germes d’une folie toujours possible qui serait proclamée comme du bon sens.
Les discours sur ces vilains grecs tricheurs et feignants qui doivent donc assumer aujourd’hui les conséquences de leurs actes par des politiques de rigueur pullulent et permettent de ne pas interroger les origines exactes de la situation grecque, de l’écarter. Mais ces discours du bien ne permettent-ils pas de ranger les Grecs dans une autre humanité que nous ne voudrions pas pour nous-mêmes, donc de leur imposer en toute bonne conscience la misère et l’accroissement inexorable des inégalités, d’accepter qu’un peuple puisse vivre des poubelles alors même que nous prônions notre union dans l’Europe hier encore. Les pays du sud de l’Europe unie avant-hier sont devenus des « PIGS » dans le vocabulaire de certains journalistes. Transformer un peuple en cochon est-il admissible ? Est-ce que ce discours qualifié de la responsabilité et du moindre mal sent très bon ? Tout en se situant dans une autre histoire, le livre d’Alexandre Jardin renforce mes interrogations actuelles parce que les rouages peuvent se répéter à l’infini dans la mécanique de l’humain et de la déshumanisation en toute bonne conscience et avec le meilleur des « bon sens ».
Les mots ont un sens. Et Alexandre Jardin rappelle ceux prononcés par son grand-père et qui lui ont pour la première fois de sa vie donné froid devant cet homme-là. Le Nain jaune était alors devant la fenêtre et parlait à sa maîtresse Zouzou en évoquant la « petite juive » qui avait mis le grappin sur l’un de ses fils. « Oh rien de bien méchant… de l’antisémitisme “convenable”, celui qui paraît acceptable et légitime entre soi, ce racisme bourgeois qui considère implicitement le Juif comme l’intrus des sociétés, des nations et des bonnes familles ». Les mots assignent. Les mots construisent les places respectables, les strapontins et les linceuls.
Comme l’écrit Alexandre Jardin « quand on tolère l’idée que des êtres ne font pas partie d’une commune humanité, le processus du pire s’amorce. La chosification d’autrui permet tout. Cela commence par le SDF que l’on enjambe un soir d’hiver sur un trottoir et cela se termine à Auschwitz ».
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Je viens de finir un roman (voir Livres) qui me laisse un goût un peu amer en bouche. Cette amertume correspond à l’état d’esprit que l’on instille dans l’hexagone depuis plus de dix ans. Le livre, lui, s’intitule « Tout, tout de suite » et son auteur s’appelle Morgan Sportès.
Exposé apparemment objectif de l’enlèvement, de la séquestration pendant vingt-quatre jours, de la torture et de l’assassinat d’Ilan Halimi, ce roman-enquête entend saisir au jour le jour l’effroyable histoire de ce qui a ensuite été appelé « le gang des barbares », ou plutôt un groupe composé de bric et de broc en banlieue parisienne. Le chef de ce groupe hétéroclite veut « tout, tout de suite ». Et pour cela il imagine un enlèvement improbable afin d’obtenir une rançon de la famille. Ce chef improvisé, dominant un groupe de « petits » de sa cité qu’il terrorise, tremblant devant les « grands » du 93 venus lui apporter un soutien, se révèle un piètre stratège affolé et un individu dangereux. Persuadé que tous les juifs sont riches et que s’ils ne le sont pas, ils constituent une communauté soudée qui s’entraidera pour payer la rançon, ce piteux chef emmène son groupe soudé par la peur dans sa démence. Chosifiant l’« Autre », celui auquel ont été enlevés les vêtements et dont le visage a été emmailloté, ils le déshumanisent jusqu’à le tuer.
Certes, Morgan Sportès nous permet de suivre pas à pas le parcours de ces jeunes pris dans un engrenage de folie. Il nous fait saisir à travers les trajets et les dialogues de chacun des protagonistes la bêtise et l’inconscience des actes, tout autant que la lâcheté des adultes qui se taisent lorsqu’ils savent. Morgan Sportès a souhaité décrire seulement.
Mais peut-on écrire sans poser son propre regard sur cette histoire ? Morgan Sportès porte des jugements incessants sur les personnes de ce groupe et la société qui conduisent à indisposer le lecteur. Lorsqu’il relate l’histoire du chef du groupe, il ne peut s’empêcher d’y ajouter une vision déterministe. « Ses parents se contentent de leur sort, pas Yacef ». A partir des propos de Yacef, il réinvente sa pensée même. Ainsi lorsque Yacef dit « ça fout la haine de voir sa mère torcher les chiottes », Morgan Sportès en déduit que « le sort des siens lui fait « honte » ». De même que ce Yacef ne semble pas avoir « le sens des limites » (selon les termes de Sportès) lorsqu’il a déclaré « Mieux vaut mourir comme un lion que de vivre comme un chien ». Mais si le chef du groupe présente une nette tendance à la domination, à la manipulation et à l’insensibilité par ses actes, les propos rapportés par Morgan Sportès témoignent-ils d’une absence de sens des limites ou d’une volonté de sortir du carcan social ? Le regard porté ici, juste à ce niveau-là, par Morgan Sportès est celui d’un censeur gardien de l’ordre social qu’il est convenable de ne pas vouloir changer ni perturber.
Ce déterminisme commence même à envahir les pages. Et certaines descriptions présentées comme purement objectives commencent à faire monter notre pression sensorielle du côté énervement. Ainsi lorsque Morgan Sportès écrit comme si de rien n’était : « A Bagneux, quelques heures plus tard, Yacef retrouve Mam’ dans un hall de la cité du Cerisier, face au terrain de basket où s’ébattent une dizaine de gamins, garçons, filles, renois, noichs et patos : futurs cailleras peut-être ? Petits Yacefs en herbe ? »
Morgan Sportès se croit obligé d’emprunter un vocabulaire qui ne lui appartient pas en l’utilisant avec sa propre pensée. Surtout il pose un regard qui enferme et limite toute une cité au parcours d’un individu et d’un groupe halluciné. Et l’esquisse ratée d’une banlieue parisienne en trois coups de fusain assassine tous ses habitants dans le langage de domination qui fleurit aujourd’hui : « Bagneux (…) Depuis les années trente, et surtout à partir des années soixante, des cités aux immeubles d’une quinzaine d’étages, en mauvais matériaux ont proliféré, s’encastrant dans les zones résidentielles. C’est là que s’entassent les “pauvres” dont parle Mam’. Aux fenêtres, du linge qui sèche, des antennes paraboliques permettant de capter Al-Jazira. Certains appartements de deux pièces sont occupés par dix personnes, avant tout des immigrés, et quelques Gaulois : des casoces (cas sociaux). Quart-monde et tiers monde se mêlent. Le chômage, surtout chez les jeunes, y est bien plus élevé qu’ailleurs. Quelques-uns vivent d’allocations diverses, d’autres de trafic : essence siphonnée dans les réservoirs, pièces détachées de voitures volées désossées, cigarettes en contrebande, shit. On touche le RMI et on travaille au noir. La mairie, depuis le Front populaire, est communiste. » Mais ces peintures au couteau peu affuté insupportent non seulement le lecteur mais aussi le citoyen car elles semblent utiliser une histoire sordide pour lui faire dire autre chose. Morgan Sportès présente son analyse politique des banlieues à travers cette histoire. Il nous assène par exemple que la principale cause des émeutes de 2005 aurait été la menace portée pour « l’équilibre économique des banlieues » du fait de la « razzia implacable exercée par la police contre le bizness du cannabis ? » Plus loin encore Morgan Sportès nous impose son analyse sur le CPE à propos de deux personnages du groupe, sans que le lien soit bien évident. Surtout l’auteur semble vouloir nous montrer que la barbarie se situe bien là, au fond de ces banlieues. Morgan Sportès semble nous montrer l’Autre, le vrai barbare, qui serait si éloigné de nous, sans vocabulaire, sans compréhension ni culture suffisante pour saisir le monde. Mais le Barbare ne s’est jamais limité dans ces zones-là, et le plus grand barbare peut avoir une culture suffisante et même très raffinée pour organiser une solution finale. En pointant ainsi notre barbare moderne, Morgan Sportès englobe un groupe, le pointe et lui fait perdre son appartenance au groupe humain. Il le chosifie tout autant que le chef du « gang des barbares » a imanigé l’« Autre ». Il n’apporte donc rien. Sauf une analyse politique conservatrice plaquée sur une histoire sordide. Morgan Sportès aurait mieux fait d’écrire un essai, les choses auraient été plus claires.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Ce matin j’écoute la radio. Un chroniqueur raconte le parcours d’un militaire américain, un Texan élevé à la dure par son père, formé pour devenir un soldat. Il était frappé dans son enfance lorsqu’il commettait des bêtises. Il le revendique. Il estime que ça l’a bien éduqué. Il est loin d’être le seul. Je connais aussi un homme qui clamait que sa mère l’avait bien dressé en le frappant. Il le revendiquait lui aussi, surtout après avoir frappé ses enfants. J’ai encore entendu ces propos ailleurs, ici et là, y compris dans des bouches qui refusaient la violence faite aux enfants. Ainsi s’exclamait-on, « elle l’a élevé à la dure » ou « elle n’était pas tendre c’est sûr, mais en même temps, cela a évité qu’il tourne mal… ».
Mais ce Texan élevé à la dure a en outre été le sniper américain tant redouté des rebelles pendant la guerre d’Irak. Il raconte avoir tué la première fois une femme « à l’esprit retors » qui se trouvait à plusieurs mètres de lui. Ce sont ses termes. Et il affirme ensuite l’avoir haï et la haïr encore aujourd’hui. Puis il raconte avoir « dégommé » à la file les individus présents, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus personne dans le viseur. A l’entendre, on l’imaginerait dans un jeu vidéo. Il a tué et il le revendique comme un acte patriotique. Il a ainsi « sauvé des vies américaines ». Il a tué préventivement. Raisonnement de légitimation face à une légitimité contestée. Mais comment pourrait-il vivre autrement qu’en s’accordant ce raisonnement de légitimation décalé sur des actes de tuerie ? Et la construction de ce raisonnement suffit-elle pour vivre ? Son raisonnement parvient-il à un accord au-delà de l’affirmation extérieure, avec sa pensée et son regard internes ?
On peut en douter quand on sait que ce soldat a été rapatrié en urgence, marqué par des troubles obsessionnels, ne parvenant pas à dormir, enfermé dans des peurs paniques. On peut encore en douter lorsque sa femme raconte qu’il se réveille, plusieurs années après, en sueur, et qu’il a failli un jour lui casser le coude dans son sommeil. Mais l’homme au raisonnement construit ne veut pas entendre parler de troubles. L’homme ne veut pas écouter ce qu’il ressent, ce qui pourrait dire une faiblesse dans son langage ou un décalage avec lui-même dans un autre langage. Son éducation et son raisonnement ont écarté toute idée de vie interne. Il ne peut être que le soldat en service, le bon soldat fidèle à sa patrie, celui des films américains. Il ne peut être que le fils de son père.
Cette question de l’intégrité avec soi-même me taraude depuis quelques temps. Elle prend un éclairage particulier avec cette histoire tragique du soldat américain. Je repensais au livre de Mario Vargas Llosa « Le rêve du celte » sur les massacres commis par les agents européens de la force publique et leurs auxiliaires africains dans l’État indépendant du Congo. Le Congo était la perle du roi des Belges. Le Congo était cet immense territoire que Léopold II s’était fait reconnaître lors du Congrès de Berlin de 1885. Le Congo belge était placé sous la coupe des compagnies concessionnaires. Il était en coupe réglée. Les structures commerciales exploitaient le caoutchouc dans des conditions effroyables. Cette situation honteuse est dénoncée au début du XXe siècle. Et notamment par Roger Casement, le consul anglais, le Celte dont Vargas Llosa a fait le personnage principal de son roman. Les compagnies privées exigeaient des villages africains une quantité de caoutchouc, sans compter la nourriture destinée aux agents de la force publique. Les quotas toujours plus élevés en caoutchouc épuisaient les forêts. Elles obligeaient les villageois africains à s’enfoncer toujours plus loin. Elles faisaient saigner les arbres et les hommes. L’exploitation du caoutchouc était placée sous le régime de la chicotte et de la mutilation. Et le responsable de la force publique qui encadre ces exactions, le capitaine Massard, est interrogé par le consul Roger Casement lors de son enquête de terrain en 1903. Au cours d’un entretien très alcoolisé, ce même capitaine Massard se désole de la situation tout en la justifiant. Selon lui, la faute des massacres et des mutilations incombe à la sauvagerie des auxiliaires africains. Et le capitaine de raconter que ces auxiliaires africains détournaient à leur profit, pour tuer singes ou serpents, les cartouches distribuées pour garantir l’« ordre public ». Le commandement avait alors été donné que les auxiliaires ramènent le doigt ou le sexe de celui à qui était destinée la cartouche afin de justifier de cet emploi. Selon le même capitaine, les auxiliaires africains continuant à utiliser les cartouches à leur profit mutilaient alors des personnes dans les villages pour prouver le bon usage des cartouches… Le capitaine Massard construit un discours de légitimation de ses propres ordres et actes de barbarie dont il semble étrangement extérieur. La barbarie est rejetée sur ceux qu’elle touche, les auxiliaires tout autant que les villageois, avant que le discours ne parte du côté des femmes africaines et de leurs dents trop limées pour certaines pratiques sexuelles... La barbarie de ce capitaine européen est renvoyée vers ceux et celles qui en sont les victimes. La haine affleure avant d’exploser dans ce raisonnement comme dans celui du militaire américain. Le dédoublement personnel entre raisonnement et regard sur soi-même semble inéluctable. Cette impossibilité de se voir et de se reconnaître soi-même est reportée sur l’extérieur, sur celui ou celle qui est à l’origine de sa propre barbarie, à l’origine de son dédoublement, sur la victime. Elle est haïe non pour elle-même mais pour ce qu’elle révèle de cette cassure intérieure. Corruption du raisonnement tout autant que corruption interne ou corruption morale selon les termes de Mario Vargas Llosa.
Cette question de l’intégrité envers soi-même atteint ici le paroxysme mais on pourrait se la poser à un moindre niveau, dans notre vie quotidienne actuelle.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
18 heures.
« Cachez la femme », une émission d’Interceptions sur France Inter…
L’émission porte sur les juifs hassidim du quartier Mea Shearim de Jérusalem qui veulent imposer les règles de la Torah et la ségrégation entre les femmes et les hommes dans la société israélienne.
Une femme entre dans un bus. Elle est orthodoxe. Vêtue d’une robe longue et d’un pull à manches également longues, elle s’assoit à l’avant du bus, juste derrière le chauffeur.
Un homme lui dit qu’elle devrait plutôt se mettre à l’arrière, qu’elle risque d’avoir des problèmes parce que c’est pour les hommes à l’avant tandis que les femmes doivent aller au fond….
Elle lui répond qu’elle ne dérange personne et que rien n’indique que les places sont réservées dans le bus.
Puis elle se rend compte par la suite que cette mise en garde avait été faite avec beaucoup de gentillesse, pour la protéger, lorsqu’ensuite vient un groupe d’homme ultra-orthodoxes qui l’admonestent pour qu’elle aille à l’arrière, qui l’insultent et la menacent en l’entourant. Elle a peur, elle sent la violence la toucher. Mais elle refuse de changer de place. Elle dit au journaliste de la radio que si elle avait obtempéré à ce moment-là, si elle avait cédé à la peur et aux menaces en allant à l’arrière, elle se serait perdue. Elle aurait à ses yeux abandonnée toutes ses valeurs, tout ce pour lequel elle se battait depuis toujours. Cette femme associait sa manière d’agir au combat de Rosa Park aux Etats-Unis contre la ségrégation.
Sa voix dans la radio était calme mais elle rappelait aussi que la menace verbale du groupe d’hommes ultra-orthodoxes était sur le point de se transformer en menace physique et que cet affrontement a duré plus d’une heure. Sa voix renvoyait à la peur qu’elle a eu un instant d’être lynchée…
Une autre femme est interrogée. Elle est présidente des parents d’élèves dans une école de filles installée récemment à côté d’un immeuble ultra-orthodoxe. Elle raconte que l’école s’est installée ici faute de place ailleurs… l’école est religieuse et les filles sont habillées « modestement », c’est-à-dire qu’à l’exception de leur visage, leur corps ne laisse apparaître aucun carré de chair ni de coquetterie…
Dès que l’école a ouvert, les ultra-orthodoxes venaient à l’ouverture insulter les gamines. Ils priaient devant l’école et parfois jetaient des pierres… mais contre qui prient ces religieux ? Contre des enfants qui sont nées avec un sexe féminin ? Quel est le sens de leur prière ? Quelles sont leurs peurs à l’égard de leur propre sexe ?
Le journaliste radio avance dans la rue. Les bruits, on entend un enfant crier à tue-tête une phrase en hébreu. Il la crie, la répète. Le journaliste demande à son accompagnant ce qu’elle veut dire. L’homme du quartier répond qu’il s’agit d’une école ultra-orthodoxe et que l’enfant crie : « Revis seigneur » ou quelque chose comme cela. L’homme raconte qu’auparavant le quartier (nom d’un quartier autre que Mea Shearim, le nom ressemble à Maravi) était il y a environ 12 ans un quartier laïc, plutôt libéral et de gauche. Mais depuis de nombreux ultra-orthodoxes se sont installés. Ils ont procédé comme pour créer une colonie en arrivant massivement et en imposant ainsi progressivement leur loi à la communauté préexistante.
A la question du journaliste au grand Rabbin Kahn : « je me fais l’avocat du diable, mais comme le disait Hillary Clinton, craignez-vous qu’Israël devienne l’Iran, c’est-à-dire une théocratie appliquant et imposant la loi religieuse à la société civile ? », la réponse du grand Rabbin Kahn avait été : « Non ! Mme Clinton ne comprend rien : Israël n’est pas l’Iran… » Pour lui, les Juifs se sont vus imposer depuis 2 000 ans des lois étrangères. Dans son esprit, Israël, après avoir vécu sous les lois britanniques, françaises vit toujours et encore sous une législation étrangère, comme une colonie sous impérialisme étranger… Pour lui, il est temps que les Israéliens renouent avec leur loi ancienne, la loi de la Torah qui est leur seule vraie loi… Non, il ne s’agit pas d’une Théocratie imposée dans son esprit mais d’un juste retour à la nature originelle de l’État d’Israël !
Israël devrait s’occuper de discuter, de régler les questions avec ses murs érigés, avec ceux qu’elles pensent laisser derrière, avec les Palestiniens. Mais elle est attaquée en interne, enfin elle est minée par ces extrêmes religieux auxquels les hommes politiques ont laissé la porte ouverte depuis plus de 20 ans, en acceptant la création de colonies religieuses, en acceptant de négocier avec les religieux sur la séparation entre les hommes et les femmes, en acceptant de négocier sur ses valeurs fondamentales.
Les responsables politiques semblent être allés au fond du bus en laissant les ultras prendre les commandes…
Un peu comme nous, dans un ordre non religieux, avec les ultra libéraux qui sont au volant de notre bus depuis plus de 20 ans, au risque de nous plonger dans la folie…
Il est temps de reprendre les commandes sur ce que nous voulons de notre bus, de notre vie, où que nous soyons…
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
18 heures. Il fait nuit. Je vais chercher le pain à pied. Une montée un peu raide, une petite-demi heure de marche aller-retour. Les flots de voitures descendent, montent. C’est fonction de l’alternance des feux. Je ne vois que les phares. Mais je sens les échappements. Sur le trottoir, deux adolescents à l’aller, une femme promenant son chien au retour. Ce n’est vraiment pas à pied qu’on peut rencontrer le plus de gens.
Un espace sépare la ville nouvelle et le village. Il semble infranchissable.
Un grand immeuble est en construction en montant vers la place du cœur cognant, dans le nouveau centre ville de Morale. Plus de 200 habitations si je me souviens bien, plusieurs étages, un centre commercial… Là-bas, ça ne gêne personne. Ou personne ne le dit.
Environ 30 ou 40 petites résidences sont prévues près du cimetière, en bas dans le village. Mais le cœur bat différemment rue de Sainte-Gueule d’Amour. Ici, il devient inadmissible de construire. Des bannières ont fleuri sur les portails, aux murs des jolies maisons. L’une d’entre elle proclame : « On construit la ville sur la ville et non sur le village » (quelque chose comme ça, il faudrait que je vérifie). Le voisin a ajouté qu’il ne s’agissait pas de « NIMBY, not in my backyard ». Ah, bon ?
Même la matière et le support employés pour s’exprimer diffèrent entre le haut et le bas. En bas, les slogans sont joliment dessinés sur des draps ou des cartons décorés. Des couleurs, des explications, des photos. On lit les panneaux comme un long poème. Un brin de créativité, et même d’humour… Les mots sont légers. Les maux sont-ils si lourds qu’annoncés ? Ici on s’oppose, on résiste dans la joie. On fait des dimanche matin crêpes, des soirées apéritives auprès des arbres en danger. On fait du lieu une aire de jeux pour les enfants, 100% naturelle.
En haut, les arbres ont déjà été coupés. Pas de slogans colorés, pas de draps joliment dessinés. Juste une grande palissade grise autour. Un seul panneau : « chantier », avec le montant de l’opération et sa durée. Là-bas on accepte, on fait avec.
La pente sépare. La forêt répartit les places. Le bas s’exile. Serait-il l’unique détenteur du droit à la nature ? Il faut construire la ville sur la ville, là-haut, et laisser le bas se claquemurer derrière ses murs de verts.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
En revenant du centre commercial aujourd’hui, en voiture. Lucas est allé chez le coiffeur, il est 17h. Une publicité à la radio sur les mœurs de la grenouille puis sur ceux de LA femme… la consommatrice de chaussures, l’acharnée des soldes qui se tenait jusque là tapie au fond de son trou. Ça y est, le top est donné. Elle se précipite, LA femme, sur les chaussures Samemanquaitrop, avec le léger nom italien si sexy. Un parallèle plus que douteux entre la grenouille coassante et la femme agaçante. Et la grenouille sautillant de produit en produit, la consommatrice compulsive. La névrosée de l’achat. Et enfin le mot de la fin, une petite voix un peu éraillée : « - jé trouve cette publicité VRAIMENT désobligeante pour… les grenouilles »… avec le clin d’œil lourdingue à la chienne de garde qui n’a aucun sens de l’humour puisqu’elle ne rit pas à la blague… Waouwahhhh ! Épatant de novation ces publicitaires. À quand la publicité qui présente les mœurs de l’aï ou paresseux (l’animal bien sûr) et DU Corse qui ne bougerait que pour aller acheter un transat ? Et elle finirait par une grosse voix bien marquée : « Je trouve cette publicité VRAIMENT désobligeante pour… les paresseux ». Vous ne trouvez pas ça marrant ? Vous n’avez aucun sens de l’humour ou quoi ?
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Ce soir j’entends Claude L. invité par l’onctueux Busnel pour son grand entretien. Claude L., sûr de lui. Claude L. qui exhibe ses plaies :
- La souffrance des autres ne me permet pas de créer, déclame le romantique Claude L., seule la douleur subie dans ma chair me permet de réaliser, d’agir.
Les propos ne sont pas exactement rapportés, mais l’idée est là. Claude L. étale ses souffrances. Mais il n’est pas dans le larmoiement. Car il s’empresse d’ajouter qu’il est avant tout un homme d’action. Et l’essentiel est d’agir, selon la mythologie présidentielle déployée depuis 2007.
Qu’importe le sens !
Le souffreteux Claude L. qui nous impose depuis 50 ans les vicissitudes de sa quotidienneté la plus insignifiante finit par cette phrase :
- Avant les hommes pleuraient, maintenant ils pleurnichent. Avant les gens riaient, maintenant ils ricanent.
L’enfant gâté du cinéma français qui n’a connu après son premier succès qu’un long fleuve tranquille de films le plus souvent acclamés. Cet enfant gâté crache à la gueule d’une grande partie de la population « pleurnicheuse ».
Pleurnicheurs les SDF ! Pleurnicheurs les ouvriers licenciés d’industries délocalisés ! Pleurnicheurs les femmes et leurs enfants qui vont aux Restos du cœur pour pouvoir manger au 15 du mois ! Pleurnicheurs les vieux dans les maisons de retraite, oubliés de tous ! Pleurnicheurs les Chibanis auxquels on supprime la pension de retraite sous prétexte qu’ils ont passé trop de temps dans leur pays d’origine où ils ne pouvaient jamais se rendre parce qu’ils passaient l’essentiel de leur vie derrière un marteau-piqueur !
J’ai honte pour Claude L. qui ne sait apparemment que disserter sur ses pansements et son mercurochrome. J’ai honte pour Claude L. qui ne sait pas voir la misère autour de lui, ni le SDF dans le métro. Sûrement un pleurnicheur lui aussi. M. Claude L., voyez-vous l’homme agenouillé dans le métro, un panneau devant lui où est inscrit : « une pièce pour manger, SVP » ? Pourquoi ne lui faites-vous pas un bisou ? Vous pourriez alors lui dire au pleurnicheur : « ça y est, fini le bobo ! Guéri ! »
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Petite pierre au chantier de la rénovation de la vie démocratique.
Dans le contexte d’une dévalorisation du volontarisme politique, les questions de l’existence et de la qualité de la vie démocratique me paraissent en effet essentielles. Si les marchés économiques et financiers sont jugés plus efficients que la délibération démocratique, car « plus raisonnables », « moins marqués par la démagogie », et exempts de toute « idéologie », alors nous assistons dans le même temps à un affaissement du débat et du respect de la délibération démocratique [1]. C’est la participation elle-même à la vie politique qui s’effrite peu à peu. Les constats sur le fossé entre les élus et les citoyens et sur la croissance de l’abstentionnisme à chaque élection sont rabâchés, sans que cette désespérance ne pousse à des propositions fondatrices d’un nouveau rapport politique [2].
Parallèlement, notre course à la croissance et au développement perpétuel dans un contexte de ressources limitées peuvent rapidement nous conduire vers une catastrophe écologique et humaine. Et on imagine aisément dans un tel scénario « des régimes autoritaires imposant des restrictions draconiennes à une population affolée et apathique » [3]. Pour ne pas parvenir à une telle situation, l’intégration de la composante écologique dans un projet politique démocratiquement conçu et discuté est indispensable.
Comme le soulignait Ivan Illich, « l’installation du fascisme technobureaucratique n’est pas inscrite dans les astres. Il y a une autre possibilité : un processus politique qui permette à la population de déterminer le maximum que chacun peut exiger dans un monde aux ressources manifestement limitées… » [4].
Enfin, comme l’exprimait le réalisateur du film « L’exercice de l’État », le temps n’appartient plus à l’homme politique… La démocratie a pourtant besoin de temps, elle en est même dévoreuse, afin de former les citoyens à la prise de décision, de les faire participer, d’identifier les problèmes et de formuler les idées et propositions. Or le phénomène actuel d’accélération du temps implique des décisions dans des délais de plus en plus courts, à la vitesse de rédaction et d’envoi des mails… Vitesse de décision des marchés financiers, vitesse des décisions des dirigeants d’entreprise, rapidité des gouvernants dans leurs décisions … qui parfois se contredisent.
Si nous pensons qu’un autre monde est souhaitable et possible, la question de la vie démocratique est en son cœur. Parce que cet autre monde possible passe par un choix fait par les citoyens dans le contexte d’un réel débat et d’une délibération de qualité.
Mais comment peut-on contribuer à refonder la démocratie ? En effet, la participation de tous les citoyens est délicate et même les démocraties directes, comme Athènes, ne sont jamais parvenues à impliquer tous les « citoyens », déjà peu nombreux lorsqu’on en écarte les femmes, les esclaves et les étrangers. Pour autant, je ne pense pas que les populations souhaitent un système antidémocratique. Alors, « comment aménager la désirabilité de la démocratie en prenant en compte les routines, les intermittences de l’implication ou les attentions obliques » [5] des citoyens ?
La démocratie représentative n’est pas une panacée mais elle n’est pas non plus l’incarnation du mal. Et des aménagements de la représentation sont envisageables comme le droit de révocation des élus, l’organisation d’états généraux, le référendum d’initiative populaire, le recours à la participation directe dans certains cas ou le bon usage des conférences de citoyens, etc., comme le souligne Serge Latouche. Pour cela, il faut des propositions et des débats.
Le pacte civique participe de ce débat en proposant de promouvoir l’éthique du débat et de la décision par la création d’un observatoire de la qualité de la vie démocratique. Cet observatoire devrait mettre en place une pédagogie de l’éthique du débat, présenter un rapport annuel sur les conditions du débat public et de la délibération, faire des recommandations sur l’utilisation des outils et des méthodes favorisant le débat et examiner l’implication des différentes catégories sociales et générations. Dans cette phase de démarrage, les animateurs du projet privilégient l’observation de la vie publique par des collectifs locaux volontaires qui pourraient notamment suivre selon leurs possibilités et volontés : le travail des députés suite aux contacts pris lors de la campagne législative, recenser les pratiques nouvelles sur leurs territoires et interpeller les maires dans la perspective des municipales de 2014. Ainsi est-il notamment mentionné l’observation concrète et ciblée du travail de quelques élus menée par le collectif de Lyon (suivi de 6 députés du département du Rhône).
Initiatives à suivre et à lancer…
Je partage avec d’autres l’idée que la revitalisation démocratique se réalise davantage dans la proximité que dans des structures nationales ou transnationales.
En effet, la démocratie peut d’autant mieux fonctionner que la communauté est de petite dimension et ancrée dans un cadre commun de vie. Elle est en lien avec les mouvements de relocalisation qui se développent sous la forme des AMAP, des Villes en mutation, etc.
L’initiative du collectif de Lyon paraît pertinente. Elle pourrait être poursuivie dans d’autres départements pour suivre :
- d’une part la participation au débat et à la délibération parlementaire de quelques-uns de nos députés,
- et d’autre part les modalités mises en œuvre par nos députés pour rendre compte de leur activité et recueillir les avis de leurs électeurs, donc de faire vivre la vie démocratique nationale sur un plan local.Plusieurs outils sont en cours de construction pour faciliter cette démarche. Au-delà du site de l’assemblée nationale lui-même, Regards citoyens a mis en ligne Nosdeputes.fr qui permet de suivre l’activité parlementaire de chaque député. Par ailleurs, une initiative, PWF (Parliament Watch France), est en cours de constitution en France. Il s’agit de s’appuyer sur les nouvelles technologies pour chercher à réduire la perte de confiance entre citoyens et élus. Le projet prévu pour le printemps prochain et déjà mis en œuvre en Allemagne prendra la forme d’une plateforme internet accessible aux citoyens pour poser des questions aux élus, dont les résultats sont relayés par les médias.
Enfin, certains sont impliqués à un niveau ou à un autre dans la vie politique de notre commune ou agglomération (municipalités, conseils de quartier, conseils élargis, associations, etc.). Comment fonctionnent le débat et la délibération publics en leur sein, quelles places sont faites à l’écoute et à la participation des citoyens ?
Des outils et des instances existent déjà mais bien des choses restent encore à inventer pour participer à la mesure de nos moyens à une observation et à une action pour la revitalisation de la vie démocratique, en cherchant aussi des partenaires mobilisés en ce sens.
(1) L’irrespect politique à l’égard du « non » au référendum sur le traité européen en 2005 en est un exemple déconcertant en France.
(2) Cornelius Castoriadis parle de « privatisation », c’est-à-dire de retrait de la population de la sphère politique : la population « vaque à ses affaires cependant que les affaires de la société lui semblent échapper de son action », Une société à la dérive. Entretiens et débats, 1974-1997, p. 14-15 ; 24-25.
(3) Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard/Pluriel, 2010, p. 268.
(4) Ivan Illich, « La convivialité », in Œuvres complètes, t. 1, p. 570. Et il ajoutait qu’« un tel programme peut encore paraître utopique à l’heure qu’il est [1973] : si on laisse la crise s’aggraver, on le trouvera bientôt d’un extrême réalisme. »
(5) Philippe Corcuff, « Le pari démocratique à l’épreuve de l’individualisme contemporain », Revue du Mauss, n° 25, 1er semestre 2005, p. 77.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
Tous les secteurs sont envahis par ce mot dévorant, la « crise » : crise de l’éducation, de l’économie, crise sociale, politique, etc. Un peu comme si ce terme était si évident qu’il en devient indémontrable. La crise entre dans un champ lexical « cosmétique » qui « vise à recouvrir les faits d’un bruit de langage » (Roland Barthes, Mythologies).
Mais comment expliquer l’inflation dans l’usage de ce mot, qui du coup le rend indéchiffrable ?
La première crise pétrolière se conjugue avec l’émergence d’une crise économique. Or ces crises remettent en cause ce qui semblait inimaginable depuis 1945, le retour du chômage et la fin de la prospérité obligatoire, du « progrès ». On assiste parallèlement à une prise de conscience écologique qui remet en cause l’idée de croissance infinie (rapport du club de Rome de 1972).
Trois coups portés à la confiance dans la croissance et le développement technique, censés mener vers un monde plus sûr et plus prévisible. À ce contexte s’ajoute une politique de l’information qui démultiplie les sentiments de crise et d’insécurité. Chaque nouvel élément qui se produit devient le révélateur d’une crise.
L’idée de progrès se vidant de sa substance, entraîne un enlisement dans le présent qui récuse le passé et perd de vue l’avenir. « Non seulement nous vivons dans un monde en crise mais nous vivons sous le surplomb de la crise », comme l’écrit M. Revault d’Allonnes (La crise sans fin). Il n’y aurait plus rien à décider. D’où le désespoir et le sentiment d’impuissance.
Mais si on allait chercher le sens du mot…
Selon l’étymologie grecque, la krisis est le moment décisif d'une maladie, son paroxysme. Celui où se dessinent deux possibilités, guérir ou périr. Mais krisis a aussi le sens de jugement.
En effet, que ce soit en médecine ou en droit, les grecs pensaient la krisis à la fois comme une lutte et un choix. Ainsi y-a-t-il crise lorsque deux tendances se combattent ou lorsqu’il faut bien séparer ce qui est confus, décider et agir. La krisis met fin à la krasis (confusion). Elle prend alors le sens positif de jugement qui distingue et rétablit un ordre. C’est le moment décisif du processus, celui qui le réoriente.
C’est ce sentiment confus qui semble actuellement dominer. Nous sommes à un moment décisif d’un processus, coincés sur la crête, concentrés entre l’avant et l’après. Et surtout englués dans une absence de perspective, non pas seulement de progrès mais aussi d’espoir.
Or à cet instant décisif… ne devons-nous pas justement garder l’espoir ?
Dans son ouvrage « Une autre vie est possible », J.C. Guillebaud s’insurge contre cette désespérance qui habite nos sociétés, ce « gaz toxique que nous respirons chaque jour » à travers le flux médiatique, le désenchantement de nos contemporains qui adoptent le ton de la dérision, de la raillerie, qui revient à « capituler en essayant de sauver la face ».
Cela conduit à accepter l’idée d’une « fin de l’histoire », selon l’expression du philosophe Fukuyama en 1992, après l’effondrement du communisme… un triomphe de la liberté et de la démocratie, mais un ébranlement de l’espérance. Comme si aucune perspective ne pouvait exister en dehors d’un capitalisme dérégulé et triomphant, porté par Reagan aux États-Unis et par Thatcher en Grande-Bretagne, et auquel se sont convertis tous les pays européens. Thatcher elle-même ne déclarait-elle pas : « There is no alternative ». Vous n’avez pas le choix. Abandonnez l’espoir de tout changement, devenez réaliste.
Cela conduit aussi à abandonner les aspirations qui ont traversé l’histoire européenne, notamment celle d’une plus grande égalité sociale. Parce que cette aspiration à l’égalité a été corrompue par le régime communiste elle deviendrait suspecte. Ainsi, lorsque fut abordée pendant la campagne présidentielle début 2012 la question de taxer les très riches, Michel Cicurel économiste de la Cie Rotschild déclarait : « l’impôt sur les hyper riches conduit à l’union soviétique puis au goulag » (cf. J.C Guillebaud).
Enfin, cela conduit à abandonner le volontarisme politique qui a prévalu depuis le XVIIIe siècle. Parce que ce volontarisme s’est trouvé nié dans sa valeur par les politiques volontaires et totalitaires, nazie ou communiste. La chute du communisme serait alors le symbole de l’échec de la volonté politique.
La conséquence de cet abandon de toute volonté politique, est que « le marché prend durablement le pas sur la démocratie. Le marché est jugé plus « raisonnable » que la politique, toujours soupçonnée de démagogie » (J.C. Guillebaud). Puisque l’intérêt général ne serait rien d’autre que la somme des intérêts individuels, il faudrait ramener l’État à un niveau minimal d’intervention, donc réduire le champ du politique et toute possibilité d’intervention dans la société (puisqu’une société ça n’existe pas, disait Thatcher, qui ne voyait qu’une somme d’individus).
Si les marchés sont jugés plus efficients que la délibération démocratique, alors l’idéologie dominante conduit aussi à un abaissement de la démocratie.
L’absence de projets politique et social, le fatalisme, dominent. Au « à quoi bon ? » répond la recherche du plaisir immédiat et personnel. L’espoir s’assimile à la naïveté, voire la bêtise : « Mais on ne vit pas dans le monde des Bisounours, tu sais ? »
Pourtant l’espoir et l’optimisme peuvent être un puissant moteur d’initiative, bien plus que la désespérance ou la jouissance immédiate et sans sens. Comme le souligne encore J.C. Guillebaud, « Espérer ne consiste pas à rêvasser ni à se priver de je ne sais quelle jouissance immédiate. Si l’espérance concerne l’avenir, elle se vit au présent, un présent qu’elle éclaire et enrichit. Loin de « soustraire » quelque chose au bonheur immédiat, comme le répète depuis 20 ans le philosophe André Comte-Sponville, elle lui ajoute une dimension. Et une saveur. Renoncer à l’espérance n’entraîne par conséquent aucun « bénéfice » en termes d’hédonisme. Si tel était le cas, alors les sociétés rassemblées autour d’un projet d’avenir et d’une espérance seraient moins heureuses que celles, qui n’espérant plus rien, se vouent à l’ébriété du présent. La sagesse grecque - hédoniste ou stoïcienne – procède par adaptation à un monde qu’elle renonce à transformer. Faire aujourd’hui retour à ce stoïcisme, c’est consentir à baisser les bras ».
Mais comment garder espoir ?
Garder sa capacité à espérer n’est-ce pas tout d’abord une condition essentielle pour vivre ? J.C. Guillebaud parle d’une disposition de l’âme, une sensibilité à mettre en mouvement. Il la met en relation avec le petit matin, le mois d’avril, l’idée d’un commencement ou d’une remise en route, pour ne pas se complaire dans les nostalgies d’un passé.
Espérer n’est pas une attitude béate, c’est aussi émettre des choix pour l’avenir, vouloir modifier le présent, donc être capable de le regarder en face, de le refuser en l’état et non pas seulement le subir sans vouloir le modifier. Espérer est donc nettement plus anti-conformiste que rester sans espoir. Cette espérance du petit matin est capitale parce qu’elle est avant tout son choix personnel de croire.
Garder espoir, n’est-ce pas aussi exercer sa liberté ? Et tout d’abord sa liberté de penser. Exercer l’espoir, c’est aussi lutter quotidiennement contre la médiatisation actuelle en faveur du renoncement.
Si on prend l’exemple du travail, des personnes se sentent aujourd’hui aliénées dans leur travail, coincées dans une pièce confinée, où elles doivent réaliser un travail sans sens, éclaté, sans perspective, abandonné au fond d’un placard sitôt fait. D’autres se sentent dépossédées par un travail et des techniques qui évoluent chaque jour, ne le leur laissant pas le temps de les intégrer et réduisant leur capacité d’initiative. D’autres encore voient leur entreprise s’étioler et craignent pour leur avenir. Comment garder espoir dans ces situations ?
Il n’y a pas de breuvage miracle mais le seul fait de prendre du recul sur ce qui nous est présenté comme une fatalité peut être salvateur. Est-ce que le temps de notre vie ne peut être que subi lourdement, comme s’il ne pouvait comporter aucune espérance pour l’avenir qu’un lendemain planifié, sûr mais déjà mort ? Prendre conscience de la valeur totalitaire que la notion de « travail » (salarié cela va de soi) a acquis dans notre société ne résout pas toutes ses difficultés, mais permet de se libérer du poids de la doxa, de regarder avec plus de distance la pression sociale, de son environnement, et même celle que l’on se met soi-même sur le dos. Un peu comme sortir du rouleau compresseur pour essayer de faire ses choix de vie.
Un certain nombre de personnes se pose actuellement ces questions sur le sens de leur travail. Elles changent parfois de direction pour garder l’espoir et la liberté de choisir leur vie (cf. M. Crawford, Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail, et les expériences des uns et des autres). D’autres se posent les mêmes questions en essayant de bouger la machinerie en interne, en rappelant la solidarité et les valeurs au sein du collectif de travail. Quelles que soient les formes prises, c’est bien l’espérance qui permet de projeter ces changements et de dépasser les peurs qui nous font baisser les bras.
L’espoir est un moteur d’engagement personnel et librement choisi, dans le sens qu’on veut donner à la vie et au monde autour de soi. Il permet aussi de garder un esprit plus critique, plus ouvert à d’autres idées et modes de vie, parce que la contrainte du jugement social s’allège.
On en voit aujourd’hui les traces dans les multiples initiatives de la société civile, certes éclatées, mais porteuses de changements (cf. retour d’expérience du groupe sobriété heureuse, journaux alternatifs comme L’âge de faire (http://lagedefaire-lejournal.fr/), initiatives des Villes en transition (http://villesentransition.net/), les indignés, etc.). Magma d’expériences peu reliées entre elles, mais marquées par l’espoir d’un autre monde possible et par l’engagement.
Le choix de l’espérance peut alors être la libération d’une « créativité » endormie par le fatalisme. Il aide aussi à mieux regarder autour de soi et en soi. Pour voir les choses qu’on laisse parfois couler ou qu’on accepte, parce qu’on pense ne pas pouvoir les changer. Pour voir en soi et essayer tant bien que mal de se hausser à la hauteur de cette espérance.
Conserver ou retrouver sa capacité à espérer, c’est un peu comme ajouter de la saveur à sa vie, en refusant de renoncer. Et la crise peut être un stimulateur pour se mettre en mouvement.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
En renforçant le chômage, la précarité et les inégalités sociales, en détruisant le système d’éducation et en ne considérant pas le nécessaire lien pour former une société et non un marché de clients, les choix politiques néo-libéraux s’accompagnent d’une centralisation de la richesse entre quelques mains, de pratiques illégales et d’un sentiment d’insécurité par rapport à d’« autres » flous, inconnus et relégués dans des lieux fantasmés de bidonvilles ou de banlieue selon les États. Les lois se succèdent, les sanctions s’accumulent, les prisons sont sur-occupées, la société se pénalise, sans résultat. Ce constat n’est pas propre à la France depuis dix ans.
Les États-Unis constituent le prototype d’une société violente et qui détient le record de la plus forte population carcérale du monde, avec une croissance de 660% de l’enveloppe consacrée aux prisons entre 1982 et 2006 [1]. Le néo-libéralisme s’accompagne d’une « criminalisation des classes dangereuses » [2]. Et le carcéral est lui-même devenu un système privatisé qui s’est érigé en une industrie florissante et lucrative, financée par les recettes publiques et les prisonniers [3]. Ces derniers sont les « salariés » américains les plus flexibilisés compte tenu des rémunérations perçues.
Le profit introduit jusqu’au fond des cachots ne conduit-il pas à ébranler la logique pénale, interrogeant le choix et les modalités des sanctions qui servent la rentabilité d’entreprises sans répondre à lutter efficacement contre le crime et la délinquance ? La question est réellement posée lorsque deux juges exerçant dans une ancienne région minière et pauvre de Pennsylvanie admettent avoir reçu plus de 2,6 millions de dollars de la part de prisons privées pour condamner des mineurs à des peines de détention disproportionnées par rapport aux faits commis [4].
Mais au-delà même des États-Unis, d’autres pays connaissent des situations comparables. Ainsi face à l’accroissement de la pauvreté et des inégalités sociales liées à la mise en œuvre de l’ALENA au Mexique, le Sénat vota des dispositions anti-criminalité particulièrement répressives, avec une augmentation des effectifs policiers de plus 100 000, la création de prisons de haute sécurité, l’accroissement de la sévérité des sanctions [5]. Ces dispositifs pénaux se révèlent particulièrement coûteux alors même que les pays ont pu connaître des politiques d’ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque Mondiale et restreignant leurs politiques d’éducation ou de santé. Ces mesures répressives inefficaces sont avant tout des instruments de gestion et de contrôle de la pauvreté. Leur vote a d’ailleurs coïncidé avec le déclenchement de la révolte zapatiste.
(1) Jacques Sorbier, Enquête sur un marché de 150 milliards de dollars, qui ne cesse de progresser grâce à la montée de la criminalité, Capital, n°127, 2002 ; Joel Dyer, The Perpetual Prisoner Machine: how America Profits from Crime, Westview Press, 2000, 318 p. Cités dans http://sitecon.free.fr/prisons/capital.htm
(2) Loïc Wacquant, « De l’État social à l’État carcéral. L’emprisonnement des classes dangereuses aux Etats-Unis », Le Monde diplomatique, juillet 1998, http://www.monde-diplomatique.fr/1998/07/WACQUANT/10652
(3) Jacques Sorbier, Enquête sur un marché de 150 milliards de dollars, qui ne cesse de progresser grâce à la montée de la criminalité, Capital, 2002, n°127
(4) AFP, Etats-Unis: des juges corrompus envoyaient des jeunes dans des prisons privées, 16 février 2009, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h1prCS_vYBAIpPBH6-CF5Q1LPwWg
(5) Noam Chomsky, Le profit avant l’homme, op. cit., p. 190-191.
BBLR
 1 commentaire
1 commentaire
-
Fin 2011. Les plans de rigueur se succèdent en Europe. Ils sont imposés de manière autoritaire et en dehors de tout système démocratique en Grèce et en Italie [1] sous la pression des marchés par l’Union européenne, et tout particulièrement le couple franco-allemand. Le médicament de l’austérité se généralise dans les pays qualifiés de « PIIGS » (Portugal, Italie et Irlande, Grèce, Espagne) par des journalistes britanniques et américains [2] sans que l’Europe ne s’offense de traiter de « porcs » des États souverains alors que les médias et politiques français se révèlent offusqués d’entendre quelques opposants socialistes souligner l’existence de « diktats » allemands [3] à propos de la dirigeante Angela Merkel et non du peuple allemand. La rigueur se poursuit, avec des mesures de coupes dans les dépenses publiques au Royaume-Uni et en France, et une entrée en récession. Les mesures annoncées en Grèce mais aussi en Italie au titre dans ce dernier cas de la « relance » ne sont qu’un catalogue répété depuis trente ans de mesures néolibérales : flexibilisation du marché du travail, déréglementation des professions, privatisations, diminution des droits sociaux (retraite, salaires, horaires de travail, protection sociale), diminution des dépenses publiques, baisse des prélèvements sur les entreprises pour relancer la compétitivité, etc. Mais ces recettes n’ont pas fonctionné. Certes les déréglementations sur les marchés ont permis d’accroître momentanément la croissance économique en autorisant les spéculations et la formation de bulles à l’origine de multiples crises, dont la crise financière de 2007. Mais elles ont surtout accompagné une concentration des richesses entre quelques mains alors que les inégalités n’ont cessé de s’accroître. Et si le chômage est apparu plus faible durant la décennie 1980-1990 aux États-Unis ou actuellement en Allemagne, c’est au prix également d’une insécurité renforcée de l’emploi et d’une précarité salariale. Mais ces saignées appliquées comme remèdes à la crise actuelle continuent d’être invoqués comme la seule solution « raisonnable ». Où se trouve la raison dans une économie tenue par de tels dogmes ?
Le néo-libéralisme implique une foi quasi religieuse dans ses principes et pratiques qui ne peuvent pas être remis en question. Il exige une croyance sacrée dans le caractère infaillible du marché dérégulé, en faisant appel à des théories du XIXe siècle très éloignées des réalités [4]. Le même constat peut être fait au sujet de la construction européenne. L’invocation à l’Europe, le dogme de sa construction pour la paix justifie d’adhérer au marché unique, à la libre circulation des marchandises et des capitaux tout en limitant celle des hommes, à une Europe purement marchande et libérale. Lorsque certaines populations européennes sont amenées à donner leur avis sur les traités européens, il ne leur est pas demandé de comprendre et d’analyser le texte mais de marquer un assentiment sans réserve. Si les peuples interrogés pour la forme ne s’y plient pas, on pourra les réinterroger jusqu’à ce qu’ils comprennent où se trouve leur intérêt et y adhèrent, comme en Irlande, ou alors le parlement adoptera ce texte remanié à l’abri de ses murs, en se prétendant être le représentant du peuple qui l’avait refusé, comme en France. Ceux qui voudraient s’opposer à ce mode de construction européenne ne sont dans les discours politique et médiatique que de dangereux nationalistes, conservateurs et qui ne maîtrisent pas l’enjeu des traités pour une Europe forte et pacifiée. Pourtant l’Europe n’a jamais paru si divisée, si affaiblie qu’en cette fin d’année 2011.
Selon la religion néo-libérale, il n’y a pas d’alternative. Cette maxime lancée par Margaret Thatcher et d’autant plus assénée qu’il n’existe plus d’opposition communiste au capitalisme depuis 1990, est serinée avec force depuis 30 ans pour marquer une sorte de « fin de l’histoire » (Fukuyama) à son stade de civilisation le plus élevé, celui de la démocratie libérale triomphante. Tout le reste serait un échec, y compris l’État social imaginée depuis la crise de 1929 et l’ère keynésienne. Mais démocratie et libéralisme ou plutôt néo-libéralisme ne riment pas automatiquement. Les exemples de la Chine, de la Russie et d’un certain nombre de pays d’Europe de l’Est sont là pour le prouver. La démocratie ne semble parfois qu’un masque formel dans nombre de pays occidentaux, comme cela est apparu lors des référendums successifs sur le traité européen en Irlande ou lors de l’adoption parlementaire d’un traité simplifié refusé par le peuple français. Où se trouve le masque démocratique lui-même lorsque les gouvernements grecs et italiens tombent sous la pression de l’Union européenne et des marchés financiers et en dehors de tout processus électoral ? Les médias justifient ces évictions, les politiques ne réagissent pas et soulignent la nécessité d’un gouvernement d’« union nationale », revendiqué en temps de « guerre » ou de « siège » et justifiant la mise entre parenthèses des libertés publiques. Où se trouve l’ennemi qui empêcherait de renforcer une politique d’austérité, si ce n’est le peuple lui-même, c'est-à-dire au final la démocratie ?
Les intérêts invoqués dans la crise actuelle rappellent les dangereux propos de Milton Friedman. Le grand chantre de l’École de Chicago soulignait dans son ouvrage « Capitalisme et liberté » que faire des profits serait l’essence même de la démocratie, et que tout gouvernement qui poursuit une politique contraire aux intérêts du marché serait donc anti-démocratique même s’il avait le soutien de la population [5]. La politique doit être au service du marché et du capital, y compris contre la volonté populaire. Les récents exemples européens en sont un témoignage. La démocratie est appelée à s’effacer devant la religion capitaliste.
La démocratie devient alors « formelle ». Fabrique d’illusions, elle se retrouve calquée sur les dogmes économiques néolibéraux très éloignés des réalités. Le débat public se trouve limité aux questions mineures tandis que les vraies questions d’organisation sociale et de redistribution des richesses sont déterminées par les forces du marché dans le cadre d’un rapport de domination économique non pensé [6]. Les alternatives politiques européennes des dernières années soulignent ce constat établi par Chomsky, tandis que la politique médiatique française menée depuis 2007 en est un exemple éclatant. Les gouvernements socialistes ou socio-démocrates en Espagne (gouvernement de Zapatero), au Portugal ou en Allemagne ou au Royaume-Uni, tout autant qu’en France pour la décennie précédente ont mené des politiques très libérales sur le plan économique, avec des baisses de cotisations sociales, le choix de privatisations, d’allongement du départ en retraite, etc. Au nom d’un principe de « réalité », ces gouvernements « socialistes » mènent tout autant que les conservateurs avec lesquels ils alternent une politique économique conforme aux dogmes néo-libéraux.
Quels sont alors les choix politiques et où se trouve le débat public ? Sur la scène française, ce débat est devenu squelettique depuis 2007. Volontairement centré sur les « étrangers » et « les délinquants », puis sur « les fous », « les musulmans », « les Roms », « les mineurs », « les fraudeurs sociaux », « l’insécurité » ou « l’identité nationale », avec des amalgames marqués du sceau de la division, il évacue toute discussion essentielle sur les choix de politique économique, sociale et environnementale. Exemple parmi tant d’autres, le pointage sur les « fraudeurs sociaux » dans le cadre des économies à mener sur les dépenses publiques. Bien que la fraude sociale soit bien largement liée à une fraude sur les prélèvements (travail dissimulé et fraude sur les cotisations sociales) tandis qu’elle concerne davantage les professionnels et établissements de santé que le quidam moyen au sein des fraudes aux prestations sociales [7], la parole politique vise le celui qu’il considère comme un « assisté » (le fraudeur aux minima sociaux) ou un « profiteur » (le fraudeur retraité étranger [8]). Cette politique de vindicte et de division permet de prendre des mesures visant les catégories pointées dans les médias tout en établissant un diagnostic qui souligne la part prépondérante d’autres populations non ciblées médiatiquement dans la fraude, comme les employeurs de travailleurs non déclarés. Ainsi la forme du débat démocratique, bien que limitée au cercle des parlementaires est-elle respectée, en ne relayant médiatiquement et politiquement que les mesures les moins efficaces dans la lutte contre la dette de la sécurité sociale. Plus largement, cette manière d’agir permet d’écarter tout débat sur la dette elle-même, son origine et les mesures réellement utiles pour la circonvenir.
Les médias dominants participent à cette fabrication d’illusions démocratiques. Présentant la situation actuelle comme sans alternative, ils ne dénoncent pas les illusions démocratiques, voire ses dénis. La faible critique relevée dans les journaux face aux gouvernements d’union nationale en Italie et en Grèce qui ont pris le pouvoir en dehors de toute élection est significative. Le Figaro indiquait le 7 novembre 2011 que « personne en Grèce n'estime qu'un recours aux urnes réglerait quoi que ce soit » [9] tandis que L’Express présentait le 6 novembre le futur gouvernement d’union nationale comme le résultat d’un « accord politique obtenu de haute lutte dans un pays très fortement polarisé politiquement » [10] Bref, le peuple n’a pas à s’exprimer sur son avenir, les médias dominants entérinent la question. Après avoir présenté le référendum proposé par le premier ministre grec sur leur avenir au sein de la zone euro comme un acte d’irresponsable, une grande part de journaux renchérissaient sur la crise politique aigüe et l’obligation pour les grecs d’accepter le plan d’aide européen et ses contreparties socialement très lourdes pour l’avenir des grecs. Ainsi L’Express déclarait-il : « Stupeur et indignation dominaient les réactions en Europe et dans le monde à l'annonce surprise, lundi soir, de ce référendum sur le plan de sauvetage par le Premier ministre grec Georges Papandréou, car un "non" des électeurs grecs pourrait être un prélude à une faillite du pays qui menacerait la viabilité de la zone euro », tandis que les milieux financiers ont été « surpris et choqués » par un recours au choix populaire [11] Le drame est annoncé et le ton est donné. Les Grecs sont appelés à obéir aux injonctions européennes, et principalement aux dirigeants franco-allemands bien décidés à appliquer le plan d’aide en dehors de toute considération de la volonté populaire grecque. L’Express ajoute que Nicolas Sarkozy a martelé à l’issue d’une réunion interministérielle à l’Elysée que « L'accord est "la seule voie possible pour résoudre le problème de la dette grecque ». La proposition de M Papandréou de recourir au référendum populaire est présentée comme un « coup de dés » par le président de la Banque mondiale Robert Zoellick ou comme un « coup de poker » par l’Express [12]. S’il paraît légitime de comparer l’idée du référendum sur l’accord européen à un chantage au pouvoir afin de ne pas recourir à des élections anticipées [13], l’idée référendaire n’était pourtant pas absolument nouvelle puisqu’elle avait déjà été évoquée par le premier ministre selon le rapport des Sénateurs français de juin 2011. Le journal Le Monde se montre lui aussi relativement réservé sur la question de la démocratie en Grèce. S’il souligne le 14 novembre la présence du nouveau premier ministre du gouvernement d’union nationale L. Papadémos comme président de la banque centrale grecque au moment du passage de la Grèce dans la zone euro et le maquillage des comptes publics sur les conseils de la banque Goldman Sachs, le même journal estime trois jours avant que « le profil du nouveau premier ministre grec va rassurer les dirigeants européens et les milieux économiques » [14].
Les décisions politiques apparaissent sur un mode univoque. Les mesures européennes d’aide économique (aide financière et mesures d’austérité) pourtant reconnues pour leur inefficacité par les parlementaires français (rapport Sutour-Humbert de juin 2011) sont présentées dans les principaux médias comme les solutions rationnelles, indispensables et bienveillantes. La mythologie néolibérale emplit la pensée des experts et journalistes qui disposent des principales audiences populaires. Elle marque ainsi de son empreinte le milieu culturel dominant, en laissant dans l’ombre les pensées contestataires.
La nécessité de repenser la place et les acteurs du débat démocratique dans nos sociétés
Les aspirations démocratiques des peuples sont essentielles. Le sentiment de faire face à la censure, au refus du débat, tout autant que l’absence d’information et de discussion sur les décisions prises pour son environnement immédiat asphyxient les individus. Comment interpréter autrement les réactions de comités de citoyens qui se sont constitués spontanément un peu partout en France, notamment dans le sud, suite aux permis d’exploitation du gaz de schiste délivrés en catimini par le gouvernement ? Ces décisions ont été adoptées sans prendre en compte les risques environnementaux connus aux États-Unis et dénoncés dans le film Gasland. Elles ont également été prises sans débat démocratique alors même qu’elles impactent durablement sur l’environnement des populations concernées. Lorsque le pouvoir politique allié aux grandes sociétés chargées de l’exploitation du gaz de schiste estiment que la population ne doit pas se voir permettre de contester ou de modifier les règles du jeu en accordant en dehors de tout débat public des permis d’exploitation, le système cesse de fonctionner selon un modèle démocratique. Il s’affirme comme le connaisseur des besoins de la majorité sans pouvoir les connaître. Ce faisant, il devient le complice d’une infime minorité, en l’occurrence les compagnies concessionnaires, et ne répond qu’à ses seuls besoins. C’est ce type de comportement qui paraît inacceptable et qui nécessite d’être repensé de manière générale et à tous les échelons des groupements, depuis l’association jusqu’à l’entreprise, le parti, l’administration et les institutions politiques, pour que le débat public et démocratique prime toujours et qu’aucun individu ou groupe d’individus ne puisse se positionner comme connaisseur et expert des besoins de la majorité.
Le culte du secret en démocratie est même valorisé comme fonctionnement politique. Le célèbre politologue Samuel Huntington estime que « le pouvoir demeure fort tant qu’il reste dans l’obscurité : exposé à la lumière du jour, il commence à s’évaporer » [15]. Comment encourager le secret dans une démocratie sans justifier dans les faits le gouvernement par une oligarchie ?
Non seulement certains politologues justifient le secret dans la démocratie mais les milieux d’affaire eux-mêmes veillent dans les démocraties occidentales à ce que les questions importantes, comme par exemple celles qui étaient relatives à l’Accord Multilatéral sur l’Investissement dans les années 1990, ne soient pas débattues publiquement. Il a fallu une forte mobilisation internationale et associative pour faire connaître ces discussions privées sur des questions intéressant tous les citoyens dans le monde [16].
Le même constat peut être fait sur la question énergétique. Sur le plan mondial, le développement a pu s’opérer depuis 1945 grâce à un pétrole bon marché et abondant. Ce faible niveau de prix a pu être maintenu grâce à l’usage de la menace ou de la force, comme par exemple avec l’intervention américaine en Iran en 1953 pour renverser le dirigeant démocratiquement élu Mossadegh qui avait nationalisé les sociétés pétrolières dans son pays. L’idée de carburants fossiles bon marché est donc « une pure fiction » si l’on intègre l’ensemble des frais destinés à maintenir son coût bas [17]. La même fiction peut être relevée sur le coût de l’énergie nucléaire en France. Les choix ont été faits dans les années 1960-70 hors de la place publique et des citoyens. La transparence n’existe pas sur la question du nucléaire et les chiffres les plus fantaisistes ont pu circuler, aussi bien en ce qui concerne le nombre de travailleurs du nucléaire (pensons au million de travailleurs récemment découverts par M Proglio) que le coût des centrales (établi sans prendre en compte le coût de la maintenance et du démantèlement) ou leur sécurité. Même la catastrophe de Fukushima qui a ébranlé les certitudes d’autres pays européens n’a pas entamé le dogme sur la sûreté du nucléaire français au sein du gouvernement. Les questions sont venues des citoyens et le débat pourra peut-être enfin avoir lieu sur la place publique grâce à cette mobilisation. Les mêmes débats méritent d’avoir lieu sur l’agriculture, l’alimentation, l’éducation, le travail et plus largement sur nos choix économique et politique de vie.
Mais le débat ne doit pas se limiter à constituer une formalité. Le vote ne peut seul résumer la démocratie s’il ne s’accompagne pas de débats réels et continus tout au long du mandat démocratique et non de simples meetings formatés au moment du seul processus électoral.
Or dans la démocratie actuelle, il n’est fait mention de l’avis et du positionnement populaire que par le « résultat des urnes », malgré d’énormes taux d’abstention, et par le biais de sondages. Les sondages sont devenus plus que les élections, le moyen de connaître l’avis de la population, voire de ses différentes catégories. Or cette « dictature des sondages » empêche le débat lui-même de s’exercer sur la place publique puisque quelques instituts, détenus par de grandes sociétés dont certains dirigeants président également le MEDEF (Laurence Parisot pour IFOP) vont chercher directement les avis des individus donnés isolément et sans discussion préalable. L’opinion générale sur des questions déterminées en dehors de toute question exprimée par la population elle-même prime sur le débat et l’échange publics. Quelques centaines de personnes interrogées sur des questions subsidiaires jouent un rôle déterminant pour la connaissance par les gestionnaires politiques de l’ « opinion publique ». L’interprétation et l’usage faits de ces mêmes sondages laissent songeurs. Ainsi un sondage réalisé tous les ans par BVA sur le sentiment des Français à l’égard de leurs services publics révélaient que les Français se montraient nettement plus attachés et positifs envers leurs services publics (éducation, police, justice, santé…) en 2011 par rapport aux trois dernières années. Mais l’interprétation de ce sentiment plus favorable était alors que finalement les Français n’avaient pas attachés d’importance au non remplacement d’un fonctionnaire sur deux et à la réduction des moyens, voire estimaient que ces réformes avaient eu un impact positif sur le fonctionnement des administrations. On pourrait penser aussi et de manière plus logique que les Français montrent ainsi leur attachement aux services publics au moment où ils sont menacés, mais cette possible interprétation n’est pas évoquée. Ces sondages d’opinion permettent en fait de faire avancer des idées, des interprétations parfois éloignées des questions initiales. Ces sondages interrogent sur les sentiments, les problèmes quotidiens ou la préférence pour telle ou telle personne. Aucun ne pose la question des éléments méritant d’être modifiés et le sens des modifications à avoir. Nous vivons le règne du sentiment et de l’avis, de l’émotion et de l’immédiateté, en écartant toute réflexion sur la contextualisation des problèmes et sur les évolutions à plus long terme.
La démocratie réelle impose un débat réel sur une place publique réelle, ouverte à tous et prenant en compte la parole de tous, y compris de ceux ayant des difficultés à l’exprimer.
Le premier point pour la démocratie réelle est donc l’existence d’une place publique large et ouverte à tous, réellement publique. La seule place publique actuellement effective et reconnue est constituée de l’isoloir lors des échéances électorales. Or les élections qui ne sont qu’un instant du fonctionnement démocratique et le seul actuellement en vigueur fonctionnent avec une très faible participation et un taux d’abstention record. Les comités de quartier fonctionnent en certains lieux mais encore faut-il avoir accès à l’information… Où se trouve la place publique dans notre démocratie actuellement ?
Le deuxième point pour la démocratie réelle concerne le contenu des éléments objets de débat. Or, avec la privatisation d’un nombre croissant de secteurs, depuis les transports jusqu’à l’énergie ou les télécommunications, les prises de décision dans ces domaines « publics » ont été transférés à des institutions privées n’ayant pas de compte à rendre aux citoyens mais seulement à leurs actionnaires, y compris l’État ou plutôt son oligarchie. Ainsi les décisions prises par les responsables de General Electric aux Etats-Unis [18], tout autant que celles retenues par le PDG de GDF-Suez en France affectent l’ensemble de la société sans que les citoyens ou le parlement n’y participent. Seul le gouvernement représentant de l’actionnaire principal l’État peut être informé et influer sur la politique de GDF-Suez. Or le gouvernement n’est pas élu et constitue une sorte d’oligarchie gestionnaire mais non une représentation citoyenne. Par conséquent le champ du débat public tend à se restreindre.
Le troisième point pour la démocratie réelle est que cette place publique si elle existe soit ouverte à tous et prenne en compte la parole de tous, y compris de ceux ayant des difficultés à l’exprimer. La question porte donc sur les acteurs de la démocratie. Selon Aristote, un citoyen responsable est « capable de gouverner et d’être gouverné » au sein d’une collectivité politique réflexive et délibérative. Or qui débat actuellement dans notre démocratie ? La seule scène démocratique électorale ouverte et connue ne fait intervenir qu’un faible nombre d’acteurs compte tenu du taux d’abstention. L’isoloir et le vote ne sont pas plus les lieux actifs de débat pour un citoyen actif et responsable. Ce lieu ne permet pas d’exprimer sa capacité à « gouverner et à être gouverné ». Mais hors de cette scène étroite, les acteurs sont en nombre encore plus limité. Les mouvements qui portaient un projet de réforme sociale et politique ont peu à peu disparu ou ont changé de nature. Les syndicats sont divisés et apparaissent comme des défenseurs d’intérêts sectoriels et souvent séparés de leur base tandis que les groupes catégoriels, bien que porteurs d’idées et de réforme, maintiennent cette défense fragmentaire de la société contenue dans le terme de « catégories », qu’ils s’agissent des femmes, des jeunes ou de groupes ethniques, culturels ou autres. Leur défense a mobilisé la société et a été indispensable pour la prise en compte de revendications non intégrées dans les discours dominants. Les mobilisations féministes ont ainsi été indispensables pour la prise en compte de la parole des femmes, pour la reconnaissance du viol comme un crime et du droit pour les femmes de disposer de leur corps. Indispensables, ces mobilisations de femmes mais aussi de différents groupes qui ne correspondent pas au modèle prédominant de l’homme blanc aisé et hétérosexuel, l’ont été et le demeurent encore, afin de faire avancer l’égalité. Mais ces mouvements multiples et légitimes ne peuvent constituer à eux-seuls un projet politique positif et mobilisateur pour l’ensemble de la société. Les partis politiques se révèlent en l’état actuel incapables de porter cette mobilisation. Comme le constatait Cornelius Castoriadis dès 1982, on assiste à une « privatisation de la société », c’est-à-dire à un désintérêt des individus pour leur « sort en tant que société » parallèlement à une décomposition des mécanismes de direction, notamment politiques, avec une vacuité dans les idées [19]. Selon le même Castoriadis, les méthodes de recrutement du personnel politique sont pour partie responsables de cette situation. En effet, faisant référence à la bureaucratisation des appareils politiques, il estime que « la sélection des plus aptes est la sélection des plus aptes à se faire sélectionner », tandis que le choix de candidats et de leaders pour les élections consiste à sélectionner comme dans un reality-show les personnalités les plus « vendables » auprès de citoyens-clients sur le marché du politique.
Cette tendance n’a cessé de se renforcer depuis 1982, avec la recherche de la personnalité politique « charismatique », qui sait endosser le rôle du chef. N’entend-t-on pas actuellement les journalistes répéter comme un refrain bien assimilé : « Est-ce que le candidat X dispose d’une carrure de président, saura-t-il endosser le costume présidentiel, etc. ». Or cette évolution témoigne d’une politique essentiellement médiatique. En d’autres termes, la place publique est contenue dans les lieux médiatiques. Elle est incarnée par un spectacle avec un scénario détenu par quelques acteurs influents de ce milieu des médias, combiné aux pouvoirs politiques et économiques. Les citoyens n’ont pas la parole dans cette politique spectacle, dans cette « société du spectacle », puisqu’il s’agit d’images, d’apparitions qui n’incluent pas la réplique ni le débat [20].
Comme l’indique Robert W. Mac Chesney, la démocratie réelle implique une « politique culturelle d’inspiration civique » [21]. En effet la démocratie néolibérale en augmentant les inégalités sociales rend plus difficile l’égalité devant la loi et dilue également le lien entre les individus. Cette démocratie formelle produit des consommateurs, non des citoyens, ce qui débouche sur une « société atomisée, peuplée d’individus désengagés, démoralisés et socialement impuissants » [22]. Les individus ont besoin de se sentir liés entre eux, avec une manifestation de ce lien par différents organismes ou institutions extérieurs au marché.
Comme le souligne fort justement Cornelius Castoriadis, les individus d’une société ont besoin de se penser en société : « il ne peut y avoir de société qui ne soit pas quelque chose pour elle-même, qui ne se représente pas comme étant quelque chose (…) ce qui revient aussi à dire que tout individu doit être porteur « suffisamment quant au besoin/usage » de cette représentation de soi de la société. C’est là une condition vitale de l’existence psychique de l’individu singulier et de la société elle-même » [23]. Cela signifie donc pour l’individu pouvoir dire « je suis quelque chose », qui constitue une volonté « pour faire être ou faire vivre l’institution de sa société ». Cornelius Castoriadis parle d’un « effondrement de l’auto-représentation de la société », du « fait que ces sociétés ne peuvent plus se poser comme « quelque chose » ou que ce comme quoi elles se posent s’effrite, s’aplatit, se vide, se contredit » [24]. Or les constats actuellement réalisés sur le retrait des individus de la sphère publique, qu’il s’agisse du travail, de la politique, de l’action syndicale ou sociale, pour investir leur sphère privé, qu’elle soit familiale, communautaire ou religieuse, est une manifestation des séparations entre les individus et une fragmentation de la société. Elle témoigne d’une crise de la signification de notre société pour les individus pour répondre aux questions suivantes : qu’est-ce que ma société et qui suis-je au sein de la société ?
Se penser en société implique une politique culturelle vivante, avec des lieux de rencontre publics fournissant aux citoyens les moyens de se rencontrer, de s’informer et de communiquer réellement ensemble. Se penser en société démocratique implique une éducation populaire et continue tout au long de la vie. En reprenant encore ici Cornelius Castoriadis, nous estimons en effet qu’« une société démocratique est une immense institution d’éducation et d’auto-éducation permanentes de ses citoyens, et qu’elle ne pourrait vivre sans cela. Car une société démocratique, en tant que société réflexive, doit faire constamment appel à l’activité lucide et à l’opinion éclairée de tous les citoyens » [25]. Soit tout le contraire d’opinions formatées par des « experts » auto-désignés dans un petit vivier peu renouvelé et très représentatif de la classe masculine, aisée et blanche dominante, des professionnels de la politique et des médias, des lobbys des grandes multinationales, des sondages formatés et des think tanks qui rassemblent tous ces individus en petits groupements bien cloisonnés. Cette invitation à l’éducation continue est une ouverture à la créativité de tout citoyen.
Culture, éducation et citoyenneté
L’imprégnation mais aussi le souci d’affirmer l’idéologie néolibérale dans la culture se manifestent notamment par une maîtrise du vocabulaire. Le choix des mots permet en effet d’assigner des places au sein de la société et de manifester les lieux de la légitimité. Tout comme le choix du terme de « droits de l’homme » a un sens particulier par rapport à celui de « droits humains », le choix du mot « anti-mondialisation » pour désigner les personnes dénonçant le système néo-libéral est significatif. En plaquant ce terme sur leurs opposants, les promoteurs du régime néolibéral s’approprient le terme de « mondialisation » et l’associe au régime capitaliste. Pourtant, ce mot désigne « tout simplement une intégration internationale. Aucune personne saine d’esprit ne peut être anti-mondialisation » [26]. Cette appropriation du terme « mondialisation » n’est pas anodine dans la mesure où elle témoigne de la volonté de faire prévaloir dans le langage commun sa propre version de l’intégration internationale, conçue comme une interdépendance économique hiérarchisée selon un modèle impérialiste. La terminologie de militants « anti-mondialisation » apparaît volontairement comme ridicule, anachronique et archaïque pour désigner ceux qui sont favorables à une forme juste de la mondialisation et qui ont choisi le terme d’« altermondialiste ».
Le même constat peut être fait pour tous les opposants même s’ils sont investis dans l’arène politique formelle. Ainsi François Fillon qualifie-t-il François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle de 2012, d’« irresponsable » parce que ce dernier indique qu’il ne se tient pas tenu par l’engagement européen signé par l’actuel président Nicolas Sarkozy pour renforcer le « pacte de stabilité » (terme impliquant l’instabilité et l’insécurité en dehors de ce cadre), c’est-à-dire pour imposer des sanctions aux États qui ne respecteraient pas le dogme de l’équilibre budgétaire et qui se verraient en conséquence imposer leur politique budgétaire par l’Union Européenne. Le vocabulaire choisi limite le cadre et l’espace du débat public puisqu’il exclut tout choix. Celui qui est contre la politique actuellement menée est un « irresponsable » alors même que la pertinence de cette politique n’est pas discutée. La politique d’austérité et les choix effectués dans cette politique d’austérité (supprimer les dépenses plutôt qu’accroître les recettes) ne sont pas discutés alors qu’ils apparaissent comme inefficaces en ne faisant que renforcer la récession économique.
Le vocabulaire se durcit encore à l’égard de contestataires hors champ politique classique. Ainsi, les altermondialistes sont-ils souvent présentés dans les médias dominants comme des jeteurs de pierre, des individus masqués et inquiétants qui cherchent à déstabiliser le système, voire comme des provocateurs de la police. Parallèlement les préoccupations et revendications des militants sont presque systématiquement passées sous silence. Ainsi lors d’un sommet mondial, de Davos au G7 ou G20 [27], et auquel s’opposent des altermondialistes, le journal télévisé s’ouvre sur des magasins fermés, dans une ville morte. Quelques commerçants ou riverains sont interviewés pour recueillir leurs inquiétudes face à des agitateurs qui restent fantomatiques. Mais le contenu des préoccupations des opposants dans le cadre du sommet en cours n’est presque jamais indiqué ni même interrogé. Les journalistes présentent la scène d’un théâtre, où les techniciens décrivent les décors, les costumes, l’espace. Mais la pièce se joue sans acteurs ni dialogues. Le journaliste offre du formel à son public aux heures de grande écoute.
Mais le vocabulaire se durcit depuis quelques années à l’égard de contestataires inscrits dans le cadre habituel de l’opposition, les manifestants ou grévistes, souvent présentés comme des privilégiés ou des fonctionnaires agrippés à leurs acquis. Ce glissement progressif mérite d’être noté.
Au-delà du vocabulaire proprement dit, l’imprégnation de l’idéologie libérale est telle qu’elle conduit à se considérer sans alternative possible. L’imaginaire et l’utopie se restreignent puisque le régime de la démocratie néo-libérale apparaît comme un stade ultime et indépassable, comme une « fin de l’histoire ». Cette démocratie néolibérale s’auto-proclame du pragmatisme. Elle rejette toute utopie (dans le sens d’un autre monde possible ou imaginé) au nom de la raison qu’elle incarne et au nom du risque de dérive totalitaire des différentes idéologies du XXe siècle. Ce faisant, la démocratie néo-libérale ne se pense pas comme une idéologie et elle ne conçoit pas ses propres dogmes. L’avenir paraît donc fermé, sans perspective d’évolution puisque la démocratie libérale serait une fin en elle-même. Le débat au sein d’une telle démocratie ne porte donc pas sur des enjeux d’avenir, de changements mais se concentre sur des éléments secondaires, annexes et sans intérêts. La démocratie néo-libérale ne peut donc offrir à ses citoyens qu’une « philosophie de la futilité », avec un débat sur la place publique relativement limité alors que les décisions politiques qui ne sont que de la pure gestion ou pragmatique sont l’objet de délibérations au sein du petit groupe dirigeant « l’entreprise » nationale. En effet, ces dirigeants se perçoivent comme des chefs d’entreprise ou de bons chefs de famille chargés de gérer leur usine ou leur patrimoine familial. N’est-ce pas d’ailleurs la comparaison actuellement faite par nombre d’élus ou de ministres entre le budget de l’État français et le budget familial ? La démocratie néolibérale se conçoit comme une entreprise de pure gestion réservée aux « ‘minorités intelligentes’ autoproclamées qui servent et administrent le pouvoir » [28].
Ces constats conduisent à constater une crise du sens critique actuellement. Un consensus apparaît indépassable autour de la raison libérale, d’une union européenne dont le mode de construction sur la libre circulation des capitaux et des produits ne peut être critiqué sous peine d’être un conservateur ou un nationaliste guerrier. La médiatisation constante de ce consensus empêche tout exercice critique et limite l’apparition d’« intellectuels » à la mise en scène d’un réseau de répétiteurs du consensus assurant la publicité de leurs productions réciproques grâce à de multiples complicités. Serge Halimi a très bien mis en évidence dans Les nouveaux chiens de garde (date) ce réseau de journalistes et pseudo-intellectuels qui se congratulent les uns les autres dans un copinage indécent, monopolisant et appauvrissant ainsi la sphère médiatique. Bien que répétant inlassablement les mêmes banalités consensuelles, voire revisitant le sens de l’histoire, ces « intellectuels » sont présentés comme la subversion ou la pensée révolutionnaire. Ainsi Elisabeth Badinter, porte-parole affirmée et auto-proclamée du féminisme dans les médias dominants, devient-elle la voix de la subversion lorsqu’elle met en parallèle le combat féministe pour la criminalisation du viol avec la parution d’un petit ouvrage qui souligne les difficultés des femmes à assumer parallèlement vie professionnelle et familiale. Lorsqu’elle affirme que « c’est donc moins le renforcement de la législation contre le viol en 1980 qui marque un tournant décisif….que le succès d’un petit livre drôle et dénué d’acrimonie « le ras le bol des superwomen » en 1987… » (Fausse Route).
Elisabeth Badinter compare et met sur le même plan les combats menées par les féministes pour la reconnaissance du caractère criminel du viol avec la parution d’un petit bouquin sans intérêt, à part celui qui lui a été accordé pendant quelques semaines ou mois par les médias !
(À suivre)
(1) Puisque de nouveaux gouvernements ont été formés dans ces deux pays sans qu’il y ait d’élections, sous la seule pression européenne et financière. Ces « sauveurs » grecs et italiens sont des technocrates étroitement liés à la faillite financière. Lucas Papadémos est l’ancien président de la banque centrale grecque au moment du passage à l’euro, c’est-à-dire lors du trucage des comptes grecs sur les conseils de la banque Goldman Sachs tandis que Mario Monti est un ancien conseiller de la banque Goldman Sachs.
(2) Par exemple, Von Reppert-Bismarck, Juliane : Why Pigs Can’t Fly, Newsweek (7-14 juillet 2008).
(3) http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2011/12/01/arnaud-montebourg-merkel-detruit-la-zone-euro_1611917_1471069.html, http://blog.lefigaro.fr/threard/2011/12/montebourg-et-le-social-nation.html
(4) Noam Chomsky, Le profit avant l’homme, p. 9.
(5) Ibid., p. 10. Rappelons que Milton Friedman a conseillé et soutenu l Pinochet au Chili pour mettre en œuvre son idéologie néo-libérale contre le gouvernement de Salvador Allende élu démocratiquement. Voir Naomi Klein, La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre, Actes Sud, 2008.
(6) Ibid., p. 16.
(7) M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, lors de son audition par la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), le 1er juin 2011, a déclaré que l’ensemble des fraudes aux prestations et aux prélèvements détectées en 2010 a représenté 458 millions d’euros. Sur ces 458 millions, 40% sont liés au travail dissimulé et 34% à la branche maladie tandis que 20% relèvent de la branche famille et 2% de la branche vieillesse. De même, le rapporteur estime que la fraude aux prestations sociales doit représenter 4 milliards d’euros (fourchette haute en se fondant sur un rapport relatif au Royaume-Uni) tandis que la fraude aux prélèvements sociaux (notamment le travail dissimulé) représenterait entre 13,5 et 15,8 milliards d’euros (fourchette plus élevée également de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale). L’orientation des propositions du rapport sur les fraudeurs aux prestations sociales alors que l’essentiel des fraudes relèvent du travail dissimulé est souligné par Jacqueline Fraysse au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, p. 109-113. Rapport d’information n°3603 déposé par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la lutte contre la fraude sociale, présenté par M le Député Dominique Tian (enregistré le 29 juin 2011), 453 p. URL : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3603.pdf.
(8) Reportage de France Culture, dimanche 25 mars 2011.
(9) http://www.lefigaro.fr/international/2011/11/06/01003-20111106ARTFIG00226-gouvernement-d-union-nationale-pour-la-grece.php
(11) L’Express, 1er novembre 2011, http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/referendum-seisme-dans-la-zone-euro-tempete-au-sein-du-gouvernement-grec_1046522.html
(12) Ibid.
(13) http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1127641-le-chantage-de-papandreou-pour-survivre
(14) Clément Lacombe, Alain Salles, « Lucas Papadémos, un partisan de la rigueur à la tête de la Grèce », Le Monde, 11 novembre 2011. http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2011/11/10/lucas-papademos-un-partisan-de-la-rigueur-a-la-tete-de-la-grece_1599862_1581613.html
(15) Propos tenus dans son ouvrage American Politics et cité par Noam Chomsky, Le profit avant l’homme, op. cit., p. 209.
(16) Noam Chomsky, Le profit avant l’homme, p. 17. introduction de Robert W.Mac Chesney. Pour les détails sur les dispositions de l’AMI, cf. pp. 219 et s. Cet accord prévoyait notamment une interdiction pour les Etats de restreindre les flux de capitaux, avec possibilité pour les investisseurs de poursuivre en justice les Etats qui violeraient les droits ainsi accordés sans effet de réciprocité, c’est-à-dire sans possibilité de saisine de la justice par les gouvernements ou les citoyens contre les investisseurs. Cet accord comprenait enfin un effet cliquet ou de non retour, rendant impossible de voter une loi contraire à l’AMI et imposant l’élimination des dispositions nationales qui lui seraient contraires.
(17) Ibid., p. 70.
(18) Noam Chomsky, Le profit avant l’homme, op. cit., p. 197.
(19) Cornelius Castoriadis, « La crise des sociétés occidentales » (texte de 1982), in La montée de l’insignifiance, Les carrefours du labyrinthe, tome IV, Paris, Le Seuil, 1996, p.14-15.
(20) Guy Debord, La société du spectacle, Paris, Editions champ libre, 1971.
(21) Noam Chomsky, Le profit avant l’homme, op. cit.. p. 11.
(22) Ibid. p. 12.
(23) Cornelius Castoriadis, « La crise… », op. cit., p.21.
(24) Ibid., p. 21.
(25) Cornelius Castoriadis, « Le délabrement de l’occident » (1991), in La montée de l’insignifiance…, op. cit., p. 72.
(26) Noam Chomsky, Le profit avant l’home, op cit., p. 24. Noam Chomsky donne également comme exemple l’absence d’informations publiques sur les résultats de l’ALENA au bout de dix ans de mise en pratique de ce traité de libre échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. La position du mouvement syndical américain et les conclusions du bureau de recherche du Congrès (OTA, Office of Technology Assessment) n’ont été diffusées que par des sources contestataires et ces sujets ont été exclus des débats électoraux. Ces rapports mettaient en évidence la croissance des investissements étrangers au Mexique parallèlement à la basse générale du total des investissements dans le pays tandis que l’économie passait aux mains des seules multinationales étrangères, p. 42-43.
(27) Le dernier exemple en date étant le sommet du G20 à Cannes en 2011, avec une ville mise sous « haute surveillance ».
(28) Noam Chomsky, op. cit., p. 47.
BBLR
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Cahiers de la guerre. Une photo noir et blanc de Marguerite Duras, les poings sur ses hanches, déterminée. Un véritable plaisir de découvrir ces fragments d’une écrivaine qui trempe les pages de ses tripes comme peu le font. Des parcelles de vérité crue et tendre éblouissent tout le long la lecture de ces Carnets écrits entre 1943 et 1949 et issus des « Armoires bleues » de sa maison de Neauphle-le-Château. Depuis l’« enfance » dans le monde colonial indochinois, sur un « cahier rose marbré » au vitriol, jusqu’à son réveil dans la rue Saint-Benoît, le sang qui coule dans les veines de Marguerite Duras palpite sur ces feuilles.
Cahiers de la guerre. Une photo noir et blanc de Marguerite Duras, les poings sur ses hanches, déterminée. Un véritable plaisir de découvrir ces fragments d’une écrivaine qui trempe les pages de ses tripes comme peu le font. Des parcelles de vérité crue et tendre éblouissent tout le long la lecture de ces Carnets écrits entre 1943 et 1949 et issus des « Armoires bleues » de sa maison de Neauphle-le-Château. Depuis l’« enfance » dans le monde colonial indochinois, sur un « cahier rose marbré » au vitriol, jusqu’à son réveil dans la rue Saint-Benoît, le sang qui coule dans les veines de Marguerite Duras palpite sur ces feuilles.« Rien de ce qu’écrit Marguerite Duras n’est laissé à l’abandon. Personnages, lieux, motifs circulent d’un texte à l’autre et se font écho », écrivent en préface Sophie Bogaert et Olivier Corpet.
L’idée de rassembler ici les « cahiers de la guerre » est excellente. Elle nous fait saisir dans sa continuité l’état de l’enfance et celui de la guerre qui, aux yeux de Marguerite Duras, « imposent l’expression de la soumission et poussent à la révolte ». Révolte que l’écriture de Marguerite Duras manie avec fracas.
Le mieux est encore de faire déguster ces carnets. Mais il est bien difficile de choisir un passage plutôt qu’un autre… tous se suivent et se répondent… alors j’en prendrai un comme ça, qui demande « c’est vous sœur Marguerite ? »
« - C’est vous, sœur Marguerite ?
- C’est moi.
- Où est mon enfant ?
- Dans une petite pièce près de la salle d’accouchement. Une petite morgue en somme. Il est là. […]
- Vous allez me chercher mon enfant. Vous me le laisserez un moment ?
- Vous n’y pensez pas sérieusement ?
- Si. Je voudrais l’avoir près de moi une heure. Il est à moi.
- C’est impossible. Il est mort. Je ne peux pas vous donner votre enfant mort. Qu’est-ce que vous en feriez ?
- Je voudrais le voir et le toucher. Si vous voulez, dix minutes.
- Il n’y a rien à faire. Je n’irai pas.
- Vous avez peur de quoi ?
- Que ça vous fasse pleurer Vous seriez malade. Il vaut mieux ne pas les voir dans ces cas. J’ai l’habitude.
- C’est de votre supérieure que vous avez peur. Vous n’avez l’habitude de rien.
- Dormez. Votre petit ange veillera sur vous.
- Il en meurt beaucoup ?
- Il y a quinze jours. Il en est mort un. C’est-à-dire…
- C’est-à-dire ?
- C’est-à-dire que c’était un nain, en somme, un petit monstre alors…
- Alors ?
- Alors on ne l’a pas ranimé. Mais il s’est ranimé tout seul. Il voulait vivre le pauvre petit chéri.
- Alors ?
- Alors on lui a enfoncé une serviette de toilette dans la bouche. Mais il voulait vivre ce pauvre petit chéri. Ca a été difficile.
- Et la mère pendant ce temps ?
- On lui disait qu’on le ranimait, qu’on faisait ce qu’on pouvait.
- Qui a fait ça ?
- C’est moi.
- Vous l’avez baptisé avant ?
- Bien sûr. Je les baptise toujours. Comme ça on est plus sûr.
- Vous l’avez baptisé et vous l’avez tué ?
- Je l’ai baptisé et je l’ai envoyé au ciel, tout droit. C’était mieux.
- Pourquoi souriez-vous ?
- Parce que vous avez l’air étonnée.
- Je crois que vous avez eu raison de faire ça. Mais ce qui m’étonne c’est que vous en soyez aussi sûre.
- Quand on porte Dieu dans son cœur, on est toujours sûr. Vous devriez prier avec moi et vous vous endormiriez.
- Mettez-vous dans la tête que je me fous de vos prières. Si vous avez tué un enfant, vous pourriez bien m’apporter le mien, dans mon lit, un moment.
- Je ne sais même plus s’il est là.
- Qu’est-ce que vous dites ?
- On ne les garde pas longtemps.
- Qu’est-ce que vous en faites ?
- Je n’ai pas le droit de vous le dire. Dormez.
- Dites-le.
- Vous voulez vraiment ? Chez nous, on les BRÛLE. Maintenant vous savez. Dormez.- Vous ne dormez pas encore ?
- Non. Il n’est plus là ?
- Je ne sais pas. Je n’y suis pas allée. Mais au bout de deux jours ça m’étonnerait…
- Alors vous les brûlez ?
- On les brûle. C’est très vite fait. Dans un four électrique.
- Pourquoi vous me l’avez dit ?
- Vous me le demandiez.
- Vous auriez pu mentir. C’est parce que je vous ai dit que je me foutais de vos prières. Jamais vous n’auriez dû le dire.
- Je vous plains beaucoup de ne pas croire dans le Bon Dieu et dans ses œuvres.
- Dans ses œuvres ?
- Si votre enfant est mort, ça veut dire que le Bon Dieu l’a rappelé à lui. Et c’est bien.
- Je voudrais que vous sortiez de cette chambre.- C’est la Mère supérieure. Réveillez-vous.
- Quoi ?
- Le prêtre est là. Vous voulez le voir ?
- Non.
- Vous ne voulez pas communier ?
- Non. Laissez-moi dormir, pour une fois que je dors.
- Appelez-moi ma sœur je vous prie. Ici vous êtes dans une maison religieuse. Alors même pas le prêtre, même sans communier ?
- Rien. Que vous tiriez les rideaux. Je suis à bout. Je veux dormir.
- Qu’est-ce que c’est que toutes ces fleurs qu’on vous apporte ?
- Pourquoi criez-vous comme ça ?
- Vous n’avez pas besoin de toutes ces fleurs. Vous allez au moins les donner à la Sainte-Vierge.
- Pourquoi pas besoin de ces fleurs ?
- Puisque votre bébé est mort, qu’est-ce que vous en faites ? Les visites vous sont même interdites, alors ? Je vais les faire prendre pour l’autel de notre chapelle.
- Je ne veux pas.
- Vous ne voulez vraiment pas ? Ni communier, ni le prêtre, ni même un bouquet à notre Sainte Vierge ?
- Ce n’est pas la peine de crier. Je ne veux pas.
- Et vous osez vous plaindre ? Ça ne veut même pas donner un bouquet à notre très Sainte Vierge et ça se plaint ? Et ça se plaint que son enfant soit mort ?
- Je ne me plains pas. Sortez.
- Je suis la Mère supérieure. Je sortirai quand ça me plaira. Vous ne vous plaignez pas ? Alors pourquoi pleurez-vous toute la journée ?
- Ça me plaît.
- Et qu’est-ce que je viens de voir sur votre table ? Une orange ? Qui vous a donné cette orange ?
- C’est mon dessert. C’est sœur Marguerite.
- Et vous croyez que nous avons des oranges à gâcher comme ça ? Par les temps qui courent ?
- Sortez.
- Les oranges chez nous on les donne aux mamans. Aux mamans qui ont leur bébé. Et qui les nourrissent. Ce n’est pas à tout le monde que nous donnons des oranges nous, sachez-le ».BBLR

 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires



